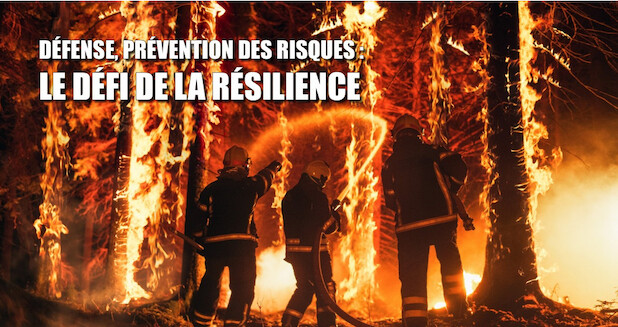En France, la Journée nationale de la résilience 2025 mobilise plus 11 000 initiatives locales : une approche participative unique.
#Résilience #Europe
Vers une culture du risque
Alignée sur la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes portée par l’ONU, cette initiative vise à diffuser une véritable culture du risque auprès de tous les citoyens. En 2024, plus de 11 000 actions locales ont été recensées : ateliers scolaires, exercices grandeur nature, conférences, simulations d’évacuation. L’édition 2025 poursuit cette dynamique, avec un accent particulier sur la préparation face aux aléas climatiques et technologiques.
Une mobilisation citoyenne et institutionnelle
Cette approche participative traduit une conviction forte : la résilience ne se décrète pas, elle se construit par l’expérience et la pédagogie.
La France et ses voisins : convergences et spécificités
La France n’est pas isolée dans cette démarche. Plusieurs pays européens ont développé des dispositifs similaires, mais avec des accents différents.
En Europe, chaque pays a développé sa propre manière de cultiver la résilience face aux crises.
En France, la Journée nationale de la résilience, instaurée en 2022, s’appuie sur un maillage territorial dense et une forte mobilisation citoyenne.
L’Italie privilégie depuis 2011 une pédagogie de terrain avec la campagne « Io non rischio », où des volontaires de la protection civile animent des stands en plein air pour sensibiliser la population.
L’Allemagne, de son côté, mise sur la technologie avec le « Warntag », journée nationale d’alerte qui teste simultanément sirènes, SMS et applications.
Aux Pays-Bas, le dispositif « NL-Alert » repose sur l’envoi de messages géolocalisés deux fois par an, complétés par des campagnes de préparation domestique.
L’Espagne adopte une approche décentralisée, laissant à chaque communauté autonome le soin d’organiser ses propres exercices et campagnes.
Entre pédagogie citoyenne et fiabilité technologique, la France se distingue par l’ampleur de son maillage territorial et sa volonté de transformer la résilience en réflexe collectif.
L’IHEDN et le défi de la résilience
Cette publication souligne combien la résilience dépasse le seul champ civil pour devenir un enjeu stratégique de défense et de sécurité nationale. Deux voix fortes y apportent leur éclairage.
Cédric Bourillet, directeur général de la prévention des risques (ministère de la Transition écologique), rappelle que le changement climatique met à l’épreuve la politique de prévention, avec une intensification des catastrophes naturelles. Il cite les inondations de 2023-2024 dans les Hauts-de-France ou encore les cyclones récents à Mayotte et La Réunion comme exemples de « chocs » à surmonter.
Sylviane Bourguet, haut fonctionnaire au développement durable et directrice des territoires, de l’immobilier et de l’environnement au ministère des Armées, insiste sur le lien entre résilience matérielle et résilience morale : la robustesse des infrastructures militaires et civiles constitue le socle de la force morale d’une nation.
L’IHEDN rappelle que la résilience, en physique, désigne la capacité d’un matériau à résister au choc. Transposée à l’échelle d’un pays, elle devient la faculté de tenir face aux crises, de s’adapter et de rebondir.
De la sensibilisation à l’action
Dans un contexte où deux Français sur trois sont exposés à un risque naturel majeur, la résilience devient un enjeu de sécurité nationale autant que de cohésion sociale.
À l’image de ses voisins européens, la France cherche à transformer la sensibilisation en culture durable, où chaque citoyen devient acteur de sa propre sécurité.

 Accueil
Accueil