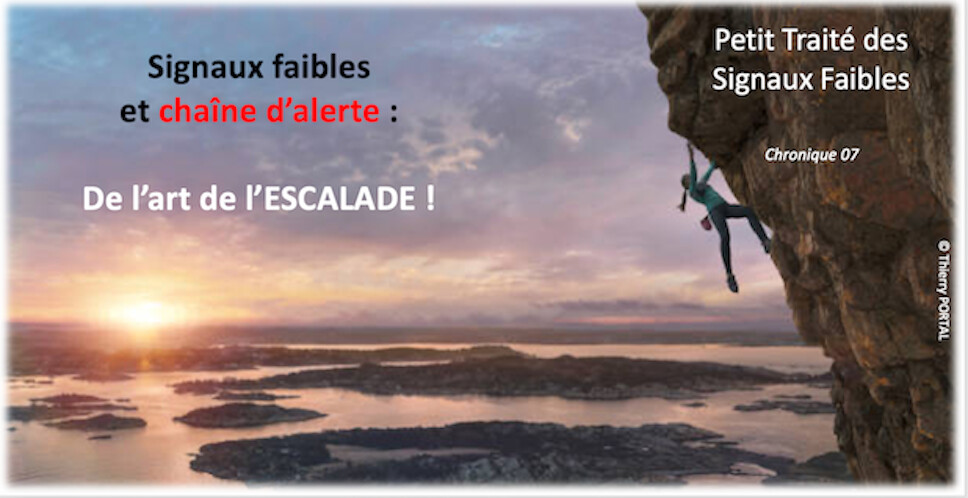
Alors qu’est-ce qu’une alerte ? Pour Le Robert, il s’agit d’un signal prévenant d'un danger : alerter a donc pour objectif d’attirer le plus rapidement possible l’attention d’un groupe cible précis sur une anomalie pouvant présenter des risques de danger. Il est donc recommandé d’élaborer un plan d’alerte et d’urgence approprié en « temps de paix » en attribuant à ces personnes les canaux et les outils d’alerte les plus adaptés. Ainsi, déployer une stratégie d’alerte permet de construire une chaîne d’interventions opérationnelles oeuvrant à la mise en place immédiate de mesures préventives appropriées.
Il y a donc le temps de l’avant où l’entreprise prépare ses chaînes d’alerte, sur la base de sa connaissance des crises plausibles. Et puis survient le temps de la crise réelle, pilotée « à chaud » grâce à ces schémas et canaux d’information pré établis : c’est le temps de l’escalade où la nature de l’événement exigera, peut-être, de faire monter en puissance le dispositif de réponse opérationnelle.
Il y a donc le temps de l’avant où l’entreprise prépare ses chaînes d’alerte, sur la base de sa connaissance des crises plausibles. Et puis survient le temps de la crise réelle, pilotée « à chaud » grâce à ces schémas et canaux d’information pré établis : c’est le temps de l’escalade où la nature de l’événement exigera, peut-être, de faire monter en puissance le dispositif de réponse opérationnelle.
1 – METHODOLOGIES GÉNÉRALES DES ENJEUX DE L’ALERTE
La chaîne d’alerte constitue la première mécanique du dispositif à actionner « à chaud » en situation inhabituelle, voire porteuse de risques. Son objectif est d’alerter rapidement et efficacement les strates hiérarchiques qui auront à décider de la nature de la situation rencontrée. De nombreuses méthodologies coexistent qui font de cette étape le premier point d’entrée d’une situation de crise.
A - La conformité
Dans la Chronique 7 consacrée aux lanceurs d’alerte, nous avons vu l’importance du signalement interne, outil indispensable à la conformité / compliance des organisations afin d’alerter sur un acte considéré comme contraire au code de conduite interne. Nous l’avons très récemment vu à l’œuvre chez Nestlé France dont le système d’alerte interne SpeakUp (un formulaire de signalement, un site internet et une ligne téléphonique dédiés) semble avoir contribué à dénoncer la relation intime du directeur général, licencié de suite, avec l’une de ses collaboratrices (Lundi 1er sept. 2025, Le Monde [[1]]).
L’efficacité d’une telle démarche repose donc sur la définition de seuils critiques à franchir pour être en non conformité, la formalisation de procédures simples et sécurisées (connues de tous) ainsi que sur la désignation d’une chaîne d’acteurs internes en charge de la vérification / validation / décision.
B – L’échelle de gravité des risques
Evidemment, tout incident, anomalie ou événement surprenant ne méritent pas de déclencher une alerte de crise. Il s’agit donc de définir des seuils clairs pour savoir quand activer les protocoles afin d’éviter des réponses disproportionnées ou, pire, des retards dans les situations critiques. D’où l’utilité d’une matrice qui présente, de manière simple pour chaque catégorie identifiée de risque, son niveau de probabilité (cas d’événements peu graves mais dont la répétition pose problème : événements annonciateurs possibles d’un événement plus grave, impact sur l’organisation et les pratiques, coûts accrus), et son niveau de gravité (repérer les événements indésirables devant faire l’objet d’un traitement ciblé prioritaire).
- Si l’on prend le risque industriel, celui-ci est défini comme la combinaison de la probabilité d’occurrence d’un évènement redouté (incident ou accident) sur un site industriel, et de la gravité de ses conséquences sur le personnel, les riverains, les biens matériels et l'environnement... Un risque industriel « majeur » est caractérisé par une probabilité faible et une gravité importante. Afin d’en limiter la survenue et les conséquences, les installations industrielles présentant des risques sont encadrées par une réglementation spécifique et sont soumises à des contrôles réguliers, entre autres sur leurs plans de réponse opérationnelle (POI et PPI) à une situation inhabituelle, voire dégradée.
- On pense ici d’abord aux sites Seveso dont les mesures de sécurité et les procédures prévues par la directive éponyme varient selon le type d'établissement (seuil haut ou seuil bas). Un système d’astreinte existe pour que la direction et les responsables d’équipes puissent être contactés et intervenir en cas d’alerte la nuit ou le week-end.
- On pense également au nucléaire civil, EDF disposant sur chaque site de production d’électricité nucléaire d’une équipe pouvant déclencher les plans de sécurité (PUI et PPI) et entraîner – si besoin - la montée en puissance de l'organisation nationale de crise d'EDF et de l’ARSN (fusion début 2025 de l’Autorité de sûreté nucléaire ASN et de son appui technique, l'Institut pour la Radioprotection et la Sûreté Nucléaire IRSN).
- Pourtant, le domaine de la gestion de crise s’est construit autour d’échecs retentissants de pilotage. Des auteurs comme P. Lagadec (X) ou C. Gilbert (Cerat Grenoble) ont stimulé plusieurs générations de chercheurs et acteurs spécialisés dans l’étude des risques et des crises. Grâce à ces décennies de travaux et d’échanges, on sait aujourd’hui que les organisations disposant de batteries de réponses opérationnelles se heurtent souvent à des obstacles qu’elles n’avaient pas prévu : un faux sentiment de préparation ; une organisation de gestion de crise « hors sol » rapidement dépassée par l’évolutivité et la cinétique rapide des évènements ; une hyper centralisation des décisions qui peuvent empêcher la créativité du « terrain ». Récemment, des auteurs issus des sciences sociales comme O. Borraz et al.[[2]] (2020) ont analysé avec rigueur la conduite de la crise du Covid-19 par les acteurs de l’Etat et ont exposé avec clarté les raisons du retard de l’alerte : « mauvaises leçons tirées du passé, faux sentiment de sécurité, confiance aveugle dans les outils de planification… ». L’ouvrage de l’ancienne ministre de la santé A. Buzyn (2023) apporte d’ailleurs sur ce thème du réveil tardif un témoignage poignant[[3]] .
C – La permanence ou l’astreinte
Qui n’a pas entendu dire de la part d’un ami : « je suis d’astreinte ce we » ? Les périodes d'astreinte sont vitales pour toute entreprise qui vise à garantir une continuité constante dans ses services et assurer ainsi une stabilité organisationnelle. Grâce aux astreintes, une organisation est capable d'intervenir rapidement face à des situations imprévues ou exceptionnelles nécessitant une action immédiate. La gestion d'astreinte est devenue un véritable levier de succès pour les entreprises, garantissant réactivité et continuité des services face aux imprévus.
De fait, l’analyse des premières informations devient une phase délicate, celles-ci étant toujours incomplètes. Après avoir défini les éléments indispensables d’information permettant de qualifier l’événement, le responsable d’astreinte doit être – en théorie - en capacité de comprendre le niveau de gravité de ce dernier. L’une de ses fonctions majeurs sera donc, en collectif, de décider du mode de gestion de l’événement et d’entrer – ou pas- dans une logique de gestion de crise.
D – La veille De fait, l’analyse des premières informations devient une phase délicate, celles-ci étant toujours incomplètes. Après avoir défini les éléments indispensables d’information permettant de qualifier l’événement, le responsable d’astreinte doit être – en théorie - en capacité de comprendre le niveau de gravité de ce dernier. L’une de ses fonctions majeurs sera donc, en collectif, de décider du mode de gestion de l’événement et d’entrer – ou pas- dans une logique de gestion de crise.
Détecter les signaux annonciateurs de crise et de rupture constitue l’un des sujets des « veilleurs ». La détection des signaux faibles passe par une veille stratégique proactive et « anticipative » : nouveaux marchés, startups, publications scientifiques, mouvements sociaux, changements culturels… En bref, l’organisation doit avoir construit un réseau de correspondants, véritables « sentinelles » pour identifier des informations porteuses d’opportunités ou de menaces, partageant les même méthodes et outils de recueil de l’information et d’alerting.
Sur ce dernier point, les outils de veille consistent en des plateformes de veille stratégique, des systèmes de scoring, des alertes automatiques, des outils d’analyse sémantique, de cartographies numériques pour mieux visualiser les tendances naissantes (datavisualisation). Leur utilisation doit être partagée par le plus d’acteurs en interne, afin de faire monter le réseau en « intelligence collective ».
Sur ce dernier point, les outils de veille consistent en des plateformes de veille stratégique, des systèmes de scoring, des alertes automatiques, des outils d’analyse sémantique, de cartographies numériques pour mieux visualiser les tendances naissantes (datavisualisation). Leur utilisation doit être partagée par le plus d’acteurs en interne, afin de faire monter le réseau en « intelligence collective ».
E – La formation des acteurs
La gestion d'astreinte ne saurait être efficace sans une équipe bien formée pour faire face à des problèmes complexes et urgents, requérant non seulement une expertise technique, mais aussi des compétences en matière de communication et de prise de décision rapide. Plusieurs catégories de formations peuvent être proposées pour garantir l'efficience du personnel d’astreinte.
- En premier lieu, des sessions techniques approfondies sont indispensables pour maîtriser les outils utilisés lors des interventions. De même, il est crucial que chacun comprenne son rôle au sein du dispositif d'astreinte et sache comment interagir efficacement avec ses collègues grâce à une initiation aux procédures internes. Il peut enfin s'avérer utile d'inclure un volet sur la gestion du stress ou le développement personnel afin que chaque intervenant puisse gérer sereinement les situations difficiles qui peuvent survenir pendant l'astreinte.
Pour des auteurs comme E. Perreault-Pierre et B. Vraie (2025)[[4]], « l’apprentissage par la routinisation des compétences (…) et les mises en situation » doit permettre la réduction du stress aigu et l’amélioration continue.
- Les plans d’alerte doivent donc décrire, en détail, les chaînes et processus d’alerte pour chaque scénario potentiel. Afin d’apporter un soutien rapide et efficace, les systèmes d’alerte utilisés doivent permettre de cartographier clairement les scénarios d’alerte définis afin qu’ils soient faciles à comprendre par les individus. Par exemple, chez Toyota, les responsables qualité ont le pouvoir de déclencher une alerte en cas de problème détecté sur une chaîne de production. Ce système a permis d’identifier rapidement les anomalies lors des rappels de véhicules. D’une manière générale, ces dispositifs doivent être régulièrement testés en conditions réelles, afin d’évaluer leur pertinence et leur fiabilité, et être mis à jour (exercices de simulation). C’est la seule façon de repérer les faiblesses et de définir les potentiels axes d’amélioration. Des formations et des exercices de simulation réguliers (formation sur les processus et les procédures, formation sur le comportement à adopter par le personnel) doivent être mis en place afin de consolider un processus d’alerte professionnel pouvant détecter de manière précoce les premiers signes d’une anomalie, porteuse de crise potentielle.
Il convient toutefois de noter que les acteurs ne bénéficient pas tous de formations ad’hoc. Les enquêtes de l’ENSOP (Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs pompiers) démontrent régulièrement que de très nombreux acteurs de la gestion de crise ne disposent d’aucune formation : ils apprennent sur « le tas / tard ». Plus encore, près de la moitié des personnes qui ont été formées l’ont été par des stages et séminaires d’une semaine maximum.
F – La vigilance et l’alerte
La vigilance est un « état de veille et de suivi. Son but est d’attirer l’attention sur l’occurrence probable de phénomènes potentiellement dangereux sur une zone donnée et de permettre de se mettre en situation d’agir de manière appropriée si le danger se précise. Si tel est le cas, l’état de vigilance peut déboucher sur une alerte »[[5]] .
- Le concept de vigilance a d’abord été mis en œuvre pour les aléas météorologiques avec la création, en 2001, de la carte de vigilance météorologique produite par Météo-France. Dans ce cadre, une confusion est très souvent faite entre les termes de vigilance et d’alerte. Le changement de couleur de la carte ne correspond pas à une alerte de la population par les autorités, mais à une diffusion d’information par Météo France. C’est ensuite aux maires et préfets qu’il revient de décider des actions à réaliser en fonction du contexte local du risque, information ou déclenchement si nécessaire d’une alerte des populations exposées.
- Du côté du secteur privé cette fois, s’il est bien un domaine qui semble avoir intégré les « signaux faibles », c’est le domaine du HSE (santé, sécurité et environnement) qui, sur la base de travaux fondateurs comme ceux de D. Vaughan (1996), de C. Morel (2002) et M. Llory (2003) et plus récemment de S. Dekker (2011), tend à développer une véritable attention aux détails, autre terme pour évoquer la culture de la vigilance. Comme l’exprime le guide HSE[[6]] , « c’est dans les interactions humaines, les tensions culturelles et les dysfonctionnements invisibles que résident les plus grandes fragilités ».
D’où l’utilité de sensibiliser les équipes à « voir ce qui ne saute pas aux yeux » par la co construction d’une culture de la vigilance face aux indices inhabituels, par la mise en place d’une organisation fiable dans la remontée d’informations et l’analyse des causes profondes, par un retour d’expérience permanent facilitant l’intégration, en transparence, des signaux faibles dans une analyse réellement partagée des risques.
- Une fois détectés, les signaux doivent permettre d’enclencher des réponses opérationnelles avec tous les acteurs concernés.
- Dans le domaine de la santé publique enfin, « le terme système d’alerte (ou parfois système d’alerte précoce) définit la composante d’un système de surveillance épidémiologique qui vise à détecter le plus précocement possible tout événement sanitaire anormal représentant un risque potentiel pour la santé publique, quelle qu’en soit la nature. L’objectif d’un système d’alerte est de permettre une réponse rapide sous forme de mesures de protection de la santé de la population » [[10]] . Le mode opératoire suit alors la logique suivante, étape par étape : recueil de signaux de toute nature ;
vérification d’informations ; analyse de données sanitaires ; mise en place de mesures de contrôle immédiates au niveau local ; mise en œuvre de moyens de diagnostic étiologique ;
confirmation et investigation des épidémies ; transmission de l’alerte au niveau national et parfois international…
- Par exemple, une alerte alimentaire correspond à la mise en évidence d’une anomalie sur un aliment, c’est-à-dire une non-conformité qui témoigne d’un danger potentiel pour les consommateurs (germes, contaminants chimiques, odeur anormale...) : « l’alerte est très généralement détectée suite à la réalisation de contrôles et d’analyses par les professionnels ou par les autorités, mais fait parfois suite à l’apparition de malades pour lesquels une cause alimentaire est identifiée [[7]] . Ainsi, plusieurs acteurs doivent agir de concert : les producteurs et distributeurs ; les services de contrôle du Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire (MASA), les consommateurs et la direction générale de la santé. Au sommet de ce dispositif, la Mission des urgences sanitaires (MUS) de la Direction générale de l’alimentation du Ministère de l’agriculture joue un rôle de chef d’orchestre : en cas d’alertes alimentaires, la MUS coordonne au niveau national les investigations et les contrôles des services du MASA, en lien étroit avec le CORRUSS[[8]] . La MUS est aussi le point de contact national du réseau d’alerte rapide de l’Union européenne pour les alertes alimentaires (Rapid Alert System for Food and Feed- RASFF [[9]] ).
- Dans le domaine de la santé publique enfin, « le terme système d’alerte (ou parfois système d’alerte précoce) définit la composante d’un système de surveillance épidémiologique qui vise à détecter le plus précocement possible tout événement sanitaire anormal représentant un risque potentiel pour la santé publique, quelle qu’en soit la nature. L’objectif d’un système d’alerte est de permettre une réponse rapide sous forme de mesures de protection de la santé de la population » [[10]] . Le mode opératoire suit alors la logique suivante, étape par étape : recueil de signaux de toute nature ;
vérification d’informations ; analyse de données sanitaires ; mise en place de mesures de contrôle immédiates au niveau local ; mise en œuvre de moyens de diagnostic étiologique ;
confirmation et investigation des épidémies ; transmission de l’alerte au niveau national et parfois international…

II – SIGNAUX FAIBLES ET CHAÎNE D’ALERTE : DE L’ART DE L’ESCALADE
L’intérêt d’une chaîne d’alerte est de permettre à l’organisation d’agir rapidement selon un principe d’escalade par effets de seuils successifs : le signal faible laissera la place à une remontée d’information qui, selon les cas, peut devenir une alerte / alarme nécessitant l’ouverture de la cellule de crise.
Ainsi, la détection des signaux constitue la première étape d’un plan de gestion de crise, structuré selon plusieurs agendas temporels, méthodologiques et technologiques. Avec ce nouvel enjeu que l’intrusion de l’IA rend brûlante : celui de l’alliance Homme / Machine dans la réponse précoce aux situations de crise…
Ainsi, la détection des signaux constitue la première étape d’un plan de gestion de crise, structuré selon plusieurs agendas temporels, méthodologiques et technologiques. Avec ce nouvel enjeu que l’intrusion de l’IA rend brûlante : celui de l’alliance Homme / Machine dans la réponse précoce aux situations de crise…
A – Le Plan d’alerte, base fondamentale de la gestion de crise
En cas d’événement imprévu ou d’urgence, les personnes concernées ou l’ensemble du personnel sont informés dans les plus brefs délais par un flux structuré d’informations.
Un plan d’alerte précise clairement qui notifie quoi, quand et comment. Il définit précisément quels canaux d’alerte / de signalement et quelles mesures doivent être prises en cas d’incident. Les responsabilités doivent être les plus claires possibles et le processus d’alerte doit être simple et connu de tous afin qu’aucune ambiguïté ne subsiste :
Un plan d’alerte précise clairement qui notifie quoi, quand et comment. Il définit précisément quels canaux d’alerte / de signalement et quelles mesures doivent être prises en cas d’incident. Les responsabilités doivent être les plus claires possibles et le processus d’alerte doit être simple et connu de tous afin qu’aucune ambiguïté ne subsiste :
- Dans de nombreux cas, l’urgence consiste à alerter les services de secours compétents, à organiser l’évacuation des personnes présentes dans le bâtiment. Mais il y a simultanément la première phase de retour sur l’événement, qui est réalisée par écrit aux fins de traçabilité : l’origine de l’information, le lieu de l’événement et la zone d’impact, la cause suspectée et les effets attendus. Cette information servira à diffuser l’information essentielle aux personnels concernés, limiter les risques de malentendus et mobiliser les équipes et acteurs clefs. Pour ce faire, des canaux rapides (appels, sms, plateformes…) seront utilisés pour réunir ces acteurs (physiquement ou virtuellement), vérifier les premières informations et lancer les premières actions rectificatives. Par exemple, lors d’une panne majeure, Amazon a adressé des alertes internes indiquant l’impact sur les services, les équipes concernées et les prochaines étapes, garantissant ainsi une communication fluide entre départements. Autre exemple, aux USA cette fois-ci lors des gigantesques incendies de Californie, où des entreprises utilisent régulièrement des applications d’alerte (sms massifs) pour prévenir les employés, voire parfois des partenaires, d’évacuation ou d’interruptions d’activités.
- Cette première étape, la plus difficile semble-t-il, consiste donc à réunir les pièces pour comprendre la nature précise d’un événement « puzzle », évolutif, aux formes inattendues et auquel l’entreprise est finalement peu préparée, quels que soient ses efforts. Avec le risque d’être entrainé sur de mauvaises pistes : s’agit-il d’une perturbation, d’une urgence ou d’une crise ? Alors que toutes les défaillances à court terme entrent dans la catégorie des perturbations (à faibles impacts), une urgence s’entend d’une défaillance à moyen terme de processus associée à des dommages considérables. La crise est associée à des problèmes existentiels à long terme et dans toute l’entreprise/organisation. Il s’agit donc d’organiser les remontées d’information avec des messages simples, compréhensibles de tous, pour évaluer les conséquences potentielles de l’événement indésirable puis d’en qualifier la nature. Par exemple, lors de la 1ère cyber attaque Wannacry en 2017[[11]] , certaines entreprises avaient des protocoles bien rodés pour activer leurs cellules IT, leur permettant d’isoler les systèmes infectés avant que les dégâts ne s’étendent.
- Les crises émergent d’ailleurs souvent par des canaux inattendus. Par exemple, les autorités, un prestataire spécialisé, un réseau social, l’environnement immédiat ainsi que les médias peuvent être à l’origine d’un message alarmant pour votre entreprise. Ainsi, quelque soit l’origine de l’événement subit, il s’agit d’utiliser une chaîne de transmission des messages : le premier point de contact doit être connu de tous les employés, qui peut-être le service responsable qui vérifiera l’information, un agent d’urgence et de crise spécifique, le chef d’équipe, le service d’astreinte ou un prestataire externe qui a pour tâche de transmettre l’information. Le plan d’alerte doit définir la manière dont la chaîne de messages est structurée et prévoir les modalités de l’information interne (employés, familles si besoin…)..
- A cet effet, une cellule de crise doit être programmée dans ce schéma d’alerte pour gérer les effets majeurs et durables de l’évènement. Certaines parties prenantes externes devront être averties par des canaux spécifiques de communication, comme les partenaires critiques, les régulateurs, les clients et fournisseurs impactés. Par exemple, la crise du Covid-19 fut l’occasion pour certaines entreprises de prévenir très vite certains partenaires prioritaires des retards de production / livraison. Une fois lancée, l’alerte doit être suivie afin de vérifier son efficacité, quitte à ajuster en fonction de la cinétique de l’événement grâce à des tableaux de bord permettant de suivre les réponses.
En résumé, l’alerte constitue la première ligne de défense de l’organisation face à un événement surprenant, potentiellement critique.
B – Le principe de l’escalade
Ainsi, un événement potentiellement crisogène fait l’objet, grâce à la remontée d’informations, d’un traitement rapide. C’est le principe même de « l’escalade » qui permet à l’organisation de monter en puissance en fonction de la nature supposée du risque, du danger. Certaines organisations ne déclenchent une crise que s’il y a des morts, d’autres s’il y a une atteinte potentielle à la réputation : chaque organisation définit ses propres niveaux d’activation de la cellule de crise (Exemple : Incerfa pour incident – Alerfa pour alerte – Detresfa pour détresse in Guide ERP de la DGAC, juillet 2023) [[12]] .
Dans les situations d’urgence, l’alerte active automatiquement votre cellule de crise, la mettant en état d’agir au niveau le plus approprié. En cas de crise exigeant l’activation de plusieurs cellules de crise dans des organisations impliquées dans la gestion de l’évènement, « l’un des aspects importants à prendre en compte est la concomitance et donc la nécessaire coordination entre ces équipes activées » (Cf. note 6).
- Par exemple, l’organisation de la gestion de crise du groupe EDF est fondée sur le principe de subsidiarité : la gestion de la crise se fait au niveau approprié (celui-ci étant réajusté en tant que de besoin), et ce « dans le respect des délégations de pouvoirs des différents responsables du Groupe, sauf circonstances exceptionnelles ou urgences avérées ». Ainsi, une crise locale engageant une seule unité de production sera du ressort du directeur d’unité / filiale. A l’autre bout du spectre, un événement jugé suffisamment grave au niveau du groupe EDF (touchant plusieurs entités ou présentant des impacts sur les enjeux majeurs du groupe) fera l’objet « d’un signalement oral direct et immédiat par les métiers et filiales touchés auprès du cadre de permanence » près de la Présidence et sera donc de la responsabilité de la direction de crise Groupe.
- Autre exemple, celui du Groupe Véolia (eau), où l’alerte est émise quand apparaît clairement un risque de compromission du Groupe (éthique, image, responsabilités contractuelles et pénales). Cette alerte permettra de simplifier les circuits d’information, de décision et d’améliorer la réactivité d’ensemble tout en laissant l’initiative au « terrain ». Les coordinateurs de crise agissent à plusieurs niveaux (régional, national et groupe), constituant les points d’entrée de l’information, diffusant l’information utile aux acteurs clefs, servant d’officiers de liaison entre les différents strates, organisant la cellule de crise et consolidant les informations utiles avec les pilotes de l’alerte ou de la crise.
C - Chaîne d’alerte et entrée en crise : vers une alliance Homme / Machine
À l’ère du numérique, les fournisseurs de solutions et les prestataires spécialisés expliquent que l’alerte manuelle est « un processus plus que désuet : lorsqu’une situation devient critique, l’automatisation permet à l’équipe d’urgence de se concentrer sur les tâches les plus importantes »[[13]]. Toutefois, l’alerte automatisée n’exclut pas la possibilité d’intervenir de façon flexible en fonction de l’évolution de la situation. Des modifications doivent pouvoir être apportées facilement à toutes les étapes de la configuration de l’alerte afin de permettre à l’organisation de réagir immédiatement en fonction de l’évolution de la situation…
- Avant de lancer le processus d’alerte automatisé, il est pertinent de configurer des niveaux d’escalade, c’est-à-dire des situations spécifiques où des alertes de suivi doivent être envoyées aux niveaux supérieurs. Cela peut être utile, par exemple, si trop peu de personnes ont été initialement prévenues ou si une situation de crise s’aggrave, nécessitant alors que le scénario d’alerte soit ajusté. Des niveaux d’escalade supplémentaires peuvent d’ailleurs être mis en place pour alerter d’autres groupes cibles si besoin.
- Dans le monde « technique » de la gestion d’astreinte, un moyen de communication automatisé peut, il est vrai, s'avérer décisif. Les avancées technologiques offrent plusieurs possibilités : téléphones fixes, smartphones, radios bidirectionnelles ou logiciels dédiés. Sur la base des scénarios d’évènements les plus plausibles, le choix du canal de communication varie selon la nature de l’alerte et des préférences de l’organisation d’astreinte. Néanmoins, une stratégie multi-canal s’avère généralement la plus efficace car elle garantit, de nuit comme de jour, la réception du message tout en permettant une « mémoire » des actions entreprises. La sélection des outils doit prendre en compte les exigences du service d’astreinte comme les groupes cibles, les niveaux de confidentialité, de rapidité, de fiabilité et de clarté attendus. Ainsi, un choix approprié assure une transmission fluide des informations essentielles :
- SMS : L’envoi de SMS offre une notification immédiate et ciblée, puisque son taux de réception est élevé, ce qui assure que le message parvient même sans connexion internet. Les SMS sont particulièrement adaptés pour les alertes concises qui nécessitent une action immédiate.
- Appel vocal : Un appel téléphonique permet une communication plus personnalisée et directe, ce qui le rend parfait pour communiquer des informations complexes ou exigeant un échange immédiat. Il peut s’agir d’appels en cascade, d’appels simultanés, de numéros verts d’informations mis à jour en temps réels… La confirmation de réception peut être obtenue directement auprès de la personne d’astreinte. Si l’appel n’est pas reçu, un dispositif de rappel et des mécanismes d’escalade deviennent indispensables. Si la personne d’astreinte ne répond pas, le système peut contacter automatiquement une autre personne ou envoyer des messages par mail ou SMS.
- Mail (ou Fax) : L’envoi de mail est approprié pour les alertes nécessitant des informations détaillées ou des documents joints, permettant une consultation a posteriori et une traçabilité des informations. Les mails sont utiles pour les incidents moins urgents mais exigeant une trace écrite.
- Message répondeur : Le dépôt d’un message sur le répondeur joue alors le rôle de notification secondaire en cas de non-réponse aux autres canaux, garantissant l’enregistrement et la « consultabilité » a posteriori de l’alerte. Cette méthode est particulièrement utile pour renforcer les appels et SMS.
- Notifications Push : Les notifications push offrent une rapidité de distribution comparable aux SMS, mais elles requièrent une application spécifique et l’acceptation de recevoir des messages. Elles permettent d’envoyer des alertes détaillées et des mises à jour en temps réel. Les notifications par SMS offrent une grande efficacité en situation critique. Heureusement, la réception des SMS d’alerte repose sur la redondance des antennes des opérateurs.
- SMS : L’envoi de SMS offre une notification immédiate et ciblée, puisque son taux de réception est élevé, ce qui assure que le message parvient même sans connexion internet. Les SMS sont particulièrement adaptés pour les alertes concises qui nécessitent une action immédiate.
Les systèmes d’alerte reposant sur des structures redondantes, à la disponibilité élevée et respectant la règlementation sur la protection des données garantissent un transfert sécurisé des informations parmi les plus sensibles.
Améliorer les procédures d’alerte du personnel d’astreinte par SMS, mails ou appels contribue à réduire les risques tout en sécurisant l’activité. Une gestion rigoureuse des alarmes et des plannings s’avère donc cruciale puisqu’elle permet d’anticiper les problèmes et de maintenir une continuité de service.
Améliorer les procédures d’alerte du personnel d’astreinte par SMS, mails ou appels contribue à réduire les risques tout en sécurisant l’activité. Une gestion rigoureuse des alarmes et des plannings s’avère donc cruciale puisqu’elle permet d’anticiper les problèmes et de maintenir une continuité de service.
D – Chaine d’alerte, applications mobiles et réseaux sociaux
Dans l’alerte face à un événement grave et subit, la place des applications mobiles et des réseaux sociaux se confirme au fil des catastrophes.
- C’est au début des années 2010 que sont apparus les premières fonctionnalités sur les réseaux sociaux pour alerter les populations.
- En octobre 2012, l’Est des États-Unis était dévasté par « Sandy », un ouragan meurtrier et dévastateur qui plongeait alors plusieurs états dans une crise de sécurité civile d’ampleur. Dans son rapport à destination du Secrétariat Général de la Défense et de la Sûreté Nationale, le Haut Comité Français pour la Résilience Nationale (HCFRN) confirmait un constat déjà posé par P. Lagadec après l’ouragan Katrina (2005) : « On notera désormais, la place incontournable des réseaux sociaux tout au long de la crise avec l’emploi interactif des nouvelles technologies qui se sont révélées essentielles dans l’information des populations et dans la bonne gestion de crise ». Ainsi, les réseaux sociaux ont permis de diffuser rapidement et largement des informations préventives et curatives concernant les coupures d’électricité : informations sur la situation, les consignes de sécurité, avant, pendant et après l’ouragan. Par exemple, Twitter a participé à la diffusion des informations en mettant en place une procédure de diffusion d’information automatique sur certaines zones géographiques, y compris vers les smartphones ne disposant pas de l’application dédiée.
- On se souviendra aussi de la fonction Safety Check de Facebook lors des tragiques attentats de Paris en 2015, puis de Bruxelles (2016)…
- En octobre 2012, l’Est des États-Unis était dévasté par « Sandy », un ouragan meurtrier et dévastateur qui plongeait alors plusieurs états dans une crise de sécurité civile d’ampleur. Dans son rapport à destination du Secrétariat Général de la Défense et de la Sûreté Nationale, le Haut Comité Français pour la Résilience Nationale (HCFRN) confirmait un constat déjà posé par P. Lagadec après l’ouragan Katrina (2005) : « On notera désormais, la place incontournable des réseaux sociaux tout au long de la crise avec l’emploi interactif des nouvelles technologies qui se sont révélées essentielles dans l’information des populations et dans la bonne gestion de crise ». Ainsi, les réseaux sociaux ont permis de diffuser rapidement et largement des informations préventives et curatives concernant les coupures d’électricité : informations sur la situation, les consignes de sécurité, avant, pendant et après l’ouragan. Par exemple, Twitter a participé à la diffusion des informations en mettant en place une procédure de diffusion d’information automatique sur certaines zones géographiques, y compris vers les smartphones ne disposant pas de l’application dédiée.
- Plus tardives, les applications mobiles font l’objet aujourd’hui de vraies attentes, de tests grandeur nature comme en juillet 2024 (juste avant Paris 2024), d’exercices d’évacuation en cas de submersion du littoral (Nice, janvier 2024
- Après l’échec relatif de SAIP [[14]] , le système FR-ALERT et l’obligation européenne d’un système d’alerte géolocalisé reposèrent sur le fait que plus de 80 % de la population possède un smartphone… et c’est encore plus vrai pour les jeunes générations ! FR-ALERT combine deux technologies : la diffusion cellulaire (Cell-Brodcast) ; des SMS géo-localisés. Ces technologies permettent de diffuser des messages d’alerte sur les téléphones des individus localisés en temps réel, ciblés selon un territoire donné, y compris les personnes de passage et les touristes. Ainsi, dans un rayon de 5 km autour d’un important incendie industriel, un message va donner une consigne, par exemple un confinement ou une évacuation. Au-delà de ce rayon de 5 km, un message et une consigne différents seront adressés.
- Alors que la première version STOPcovid n'avait suscité que 2,5 millions de téléchargements maximum en cinq mois, l'application TousAntiCovid (sortie le 22 octobre 2020) comptabilisait en mars 2021 déjà 13,5 millions de téléchargements. Les raisons de ce succès furent multiples : accès à l'attestation de sortie et au Pass sanitaire ; conseils personnalisés ; informations pratiques ; confidentialité. TousAntiCovid intègre depuis juin 2021 un nouvel outil de traçage par QRCode. En tant que solution complémentaire aux carnets de rappel, il fût affiché à l’entrée des bars, restaurants et salles de sport lors de leur réouverture : le but est ainsi d’envoyer une alerte à tous les utilisateurs, si l’un d’entre eux se révèle positif au Covid-19. ayant scanné le même QR Code au même moment.
- Après l’échec relatif de SAIP [[14]] , le système FR-ALERT et l’obligation européenne d’un système d’alerte géolocalisé reposèrent sur le fait que plus de 80 % de la population possède un smartphone… et c’est encore plus vrai pour les jeunes générations ! FR-ALERT combine deux technologies : la diffusion cellulaire (Cell-Brodcast) ; des SMS géo-localisés. Ces technologies permettent de diffuser des messages d’alerte sur les téléphones des individus localisés en temps réel, ciblés selon un territoire donné, y compris les personnes de passage et les touristes. Ainsi, dans un rayon de 5 km autour d’un important incendie industriel, un message va donner une consigne, par exemple un confinement ou une évacuation. Au-delà de ce rayon de 5 km, un message et une consigne différents seront adressés.
Ces applications contribuent fortement à la recomposition d’un marché devenu très dynamique, à l’image de la cascade d’achats de Résiliency (2018) puis Crisotech (2020) par Deveryware (expert de la géolocalisation en temps réel), racheté lui-même en 2022 par Chapsvision, leader du traitement des données volumineuses dans la cybersécurité et le renseignement, principalement au service de l’Etat[[15]] .
E – Quid de l’intelligence artificielle dans un système/chaîne d’alerte
Nous partirons du principe que l’IA permet d’analyser à la vitesse de la lumière une grande masse d’informations. Ainsi, elle est d’un grand soutien pour « anticiper rapidement les risques avant qu’ils ne se transforment en urgence », autant par l’extraction des éléments saillants dans une masse documentaire souvent imposante et leur datavisualisation grâce aux scénarios d’évolutions défavorables que par le soutien à la décision en temps réel par priorisation des choix et des actions selon un mode d’apprentissage continu, adaptatif.
Toutefois, des écueils persistent qui exigent un encadrement humain tel que mentionné dans un billet du cabinet EH&A. En effet, l’IA ne garantit pas que ses données, toujours confidentielles en période de crise, ne soient pas réutilisées dans un autre cadre, malgré les assurances des industriels du secteur en termes de sécurité et confidentialité. Surtout, elle ne comprend pas les émotions liées à un contexte crisogène : or, la lecture d’un événement tragique ne peut s’abstraire de ses dimensions cultu(r)elles, sociales et politiques. Enfin, l’IA peut multiplier les erreurs, en procédant exclusivement par automatisme sans réelle intuition, par l’intégration systématique de datas biaisées au détriment du bon pilotage de la crise, ou encore lorsque son cadre comportemental sans aspérités se situe à mille lieux d’une véritable conduite d’urgence…
C’est la raison pour laquelle l’IA doit être encadrée par des spécialistes en mesure d’en connaître les opportunités mais surtout les limites. L’avenir nous dira à quelles conditions ce retour du facteur humain s’imposera, ou pas…
Toutefois, des écueils persistent qui exigent un encadrement humain tel que mentionné dans un billet du cabinet EH&A. En effet, l’IA ne garantit pas que ses données, toujours confidentielles en période de crise, ne soient pas réutilisées dans un autre cadre, malgré les assurances des industriels du secteur en termes de sécurité et confidentialité. Surtout, elle ne comprend pas les émotions liées à un contexte crisogène : or, la lecture d’un événement tragique ne peut s’abstraire de ses dimensions cultu(r)elles, sociales et politiques. Enfin, l’IA peut multiplier les erreurs, en procédant exclusivement par automatisme sans réelle intuition, par l’intégration systématique de datas biaisées au détriment du bon pilotage de la crise, ou encore lorsque son cadre comportemental sans aspérités se situe à mille lieux d’une véritable conduite d’urgence…
C’est la raison pour laquelle l’IA doit être encadrée par des spécialistes en mesure d’en connaître les opportunités mais surtout les limites. L’avenir nous dira à quelles conditions ce retour du facteur humain s’imposera, ou pas…
Bienvenu(e)s en Terra Incognita…
Sources
[[2]] Borraz O., Castel P., Dedieu F., Bergeron H., Covid-19 : une crise organisationnelle, 1ère édition 2020, Presses de Sciences Po
[[3]] Lire aussi l’ouvrage d’Agnès Buzyn, ancienne Ministre de la santé : Journal, janvier-juin 2020 chez Flammarion.
[[4] Perreault-Pierre E., Vraie B., Mobiliser les facteurs humains dans la gestion de crise, Interéditions 2025
[[8]] Corruss : Centre opérationnel de régulation et de réponses aux urgences sanitaires et sociales – Lien : https://sante.gouv.fr/prevention-en-sante/securite-sanitaire/article/la-gestion-des-alertes-et-des-crises-sanitaires
[[10]] Marano F., Zmirou-Navier D., Commission spécialisée sur les risques environnementaux, HCSP, « Signaux, signalement, alerte » - ad1060821 (1).pdf
[[11]] WannaCry est l'une des pires cyberattaques de tous les temps, avec plus de 200 000 victimes dans le monde et plusieurs milliards de dollars de dégâts. Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont accusé la Corée du Nord d'être à l'origine de l'attaque, au même titre que de nombreux experts en sécurité. Toutefois, le pays totalitaire asiatique a toujours nié. [[12]] https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/Plan_de_gestion_de_crise_ERP.pdf
[[13]] www.F24.com à titre d’exemple
[[14]] Les prémices de l’alerte par une Appli Mobile remonte, en France, au service SAIP en 2016, dédié aux alertes terroristes (Post nov 2015). Toutefois, le manque de formation des équipes internes, le faible nombre de téléchargements, certains bugs techniques ou des déclenchements inopportuns furent, semble-t-il, les raisons de son échec.
[[15]] Mais aussi pour les entreprises du B2B avec des solutions de Data Intelligence, un CRM et des outils de Marketing Automation, entre autres
[[15]] Mais aussi pour les entreprises du B2B avec des solutions de Data Intelligence, un CRM et des outils de Marketing Automation, entre autres
A propos de Thierry Portal
Gardez le lien
Lecturer, auteur primé FNEGE, direction pédagogique (Management des crises), chargé d’enseignement, Consultant senior Crisis Management, trainer et co-scénariste. Je suis passionné par le sujet des crises / risques depuis plus de trente ans : « indépendant, je forme, écris et conseille ».
Entre 2022 et 2024, j'ai co dirigé la pédagogie du MBA Management et communication de crise chez De Vinci Exedec (Prix Innovation 2022 et le Prix du Lancement Eduniversal 2023). Avant cela, j'intervenais déjà dans de nombreux établissements d'enseignement supérieur (Master 2) dont : Paris Saclay (Sciences Po et droit), Panthéon Sorbonne (Ecole de Management / Gestion globale Risques et Crises), Ileri (Institut Libre des Relations Internationales et des Sciences Politiques), Université Technologique de Troyes (UTT) et diverses autres écoles et universités spécialisées en Cybersécurité, Ressources Humaines, Environnement, Communication, Commerce...
De 2001 à 2024 : près d'agences et cabinets conseils en communication sensible/crise, plus de vingt (20) années passées à décrypter les jeux d’acteurs dans l’écologie des organisations (exemple : intelligence économique - due diligence des parties prenantes), débroussailler les sujets complexes (ex : tendances puis scénarios à risques) et déminer les terrains délicats (ex : anticipation et signaux faibles annonciateurs de crise).
Auparavant, j’étais membre de plusieurs cabinets d'élus locaux avec comme mission essentielle la coordination municipale et la communication locale, en lien étroit avec le politique, les services et les administrés.
Ancien chargé de mission près du Ministère de l’écologie pour mettre en place les premières expérimentations d’information préventive sur les risques majeurs (ex : dicrim).
Lecturer, auteur primé FNEGE, direction pédagogique (Management des crises), chargé d’enseignement, Consultant senior Crisis Management, trainer et co-scénariste. Je suis passionné par le sujet des crises / risques depuis plus de trente ans : « indépendant, je forme, écris et conseille ».
Entre 2022 et 2024, j'ai co dirigé la pédagogie du MBA Management et communication de crise chez De Vinci Exedec (Prix Innovation 2022 et le Prix du Lancement Eduniversal 2023). Avant cela, j'intervenais déjà dans de nombreux établissements d'enseignement supérieur (Master 2) dont : Paris Saclay (Sciences Po et droit), Panthéon Sorbonne (Ecole de Management / Gestion globale Risques et Crises), Ileri (Institut Libre des Relations Internationales et des Sciences Politiques), Université Technologique de Troyes (UTT) et diverses autres écoles et universités spécialisées en Cybersécurité, Ressources Humaines, Environnement, Communication, Commerce...
De 2001 à 2024 : près d'agences et cabinets conseils en communication sensible/crise, plus de vingt (20) années passées à décrypter les jeux d’acteurs dans l’écologie des organisations (exemple : intelligence économique - due diligence des parties prenantes), débroussailler les sujets complexes (ex : tendances puis scénarios à risques) et déminer les terrains délicats (ex : anticipation et signaux faibles annonciateurs de crise).
Auparavant, j’étais membre de plusieurs cabinets d'élus locaux avec comme mission essentielle la coordination municipale et la communication locale, en lien étroit avec le politique, les services et les administrés.
Ancien chargé de mission près du Ministère de l’écologie pour mettre en place les premières expérimentations d’information préventive sur les risques majeurs (ex : dicrim).

 Accueil
Accueil

