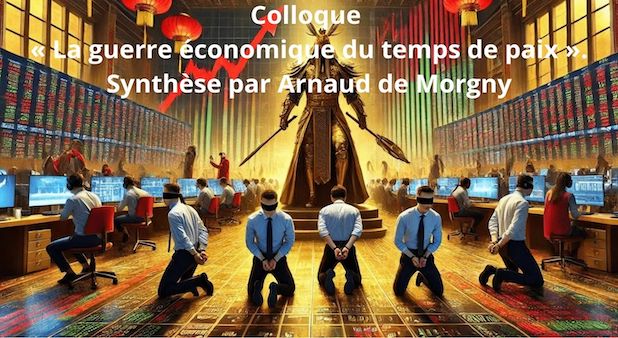
Organisé par la sénatrice Gisèle Jourda et le Centre de recherche appliquée de l'École de Guerre Économique (CR451), cet événement a rassemblé des chercheurs, praticiens et responsables politiques afin de structurer une analyse approfondie des rapports de force économiques contemporains, dans un monde marqué par la martialisation de ces rapports.
En ouverture, Mme Jourda a dénoncé l’absence d’une politique de sécurité économique cohérente en France face à des menaces hybrides mêlant ingérence étrangère, captation stratégique d’actifs et pression informationnelle.
Christian Harbulot (directeur de l’Ecole de guerre économique et du CR451) a ensuite défini les trois champs constitutifs de la guerre économique : l’économie de guerre (mobilisation industrielle au service d’un conflit), la guerre économique en temps de guerre (perturbation logistique ennemie), et la guerre économique en temps de paix c’est-à-dire la stratégie d’accroissement de la puissance par l’économie.
Les interventions académiques ont permis de cartographier ces dynamiques.
Le professeur Greg Kennedy (King’s College, Londres) distingue une guerre économique chaude (embargos, blocus) et froide (sanctions, normes), soulignant le rôle stratégique du domaine maritime et les filiations historiques des méthodes.
Le Professeur Yves Tiberghien (Université British Columbia, Vancouver (Canada)) met en lumière la fin de la séparation entre économie et sécurité tout en précisant que les principaux acteurs mondiaux intègrent tous une dimension offensive dans la notion de sécurité économique. Il caractérise aussi l’émergence d’un capitalisme d’État offensif en Asie.
Le professeur Nicolas Moinet (IAE, Poitiers, CR451) quant à lui, développe la notion de « machine de guerre économique », insistant sur l’impératif d’une stratégie française intégrée, offensive, et fondée sur l’analyse des échiquiers invisibles de confrontation.
Le professeur Jacques Sapir (ancien directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales), retrace la longue histoire du protectionnisme comme outil d’émancipation économique, et souligne l’importance des stratégies indirectes de puissance.
Le Professeur Yves Tiberghien (Université British Columbia, Vancouver (Canada)) met en lumière la fin de la séparation entre économie et sécurité tout en précisant que les principaux acteurs mondiaux intègrent tous une dimension offensive dans la notion de sécurité économique. Il caractérise aussi l’émergence d’un capitalisme d’État offensif en Asie.
Le professeur Nicolas Moinet (IAE, Poitiers, CR451) quant à lui, développe la notion de « machine de guerre économique », insistant sur l’impératif d’une stratégie française intégrée, offensive, et fondée sur l’analyse des échiquiers invisibles de confrontation.
Le professeur Jacques Sapir (ancien directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales), retrace la longue histoire du protectionnisme comme outil d’émancipation économique, et souligne l’importance des stratégies indirectes de puissance.
Les contributions empiriques illustrent l’ampleur des enjeux.
Jean-Philippe Eglinger (Maitre de conférences, INALCO, Paris) montre que le Vietnam a su concilier intégration mondiale et intelligence économique, dans une approche pragmatique de « développement sous contrôle » et de « stratégie du bambou » : plier devant la puissance chinoise pour ne pas y céder.
Le professeur Mehrdad Vahabi (université Sorbonne Paris Nord) indique que de manière générale, les sanctions économiques n’atteignent pas leurs objectifs initiaux. Il analyse la manière dont les sanctions ont renforcé la prise de contrôle de l’économie iranienne par les instances religieuses dans le cadre de l'Anfal. Il s’agit de l'un des principes sous-jacents des finances publiques chiites selon lequel tous les biens publics sans propriétaire appartiennent exclusivement au Prophète et, en son absence, à l'imam.
Dmitri Kuvaline (directeur adjoint et chef du laboratoire d'analyse et de prévision des processus microéconomiques de Moscou) met en avant l’adaptabilité du système économique russe, capable de redéployer ses capacités productives sous contraintes.
Le cas marocain, présenté par Ali Moutaïb (directeur des programmes de l’Ecole de Guerre Economique au Maroc) démontre comment une puissance moyenne peut construire une machine de guerre économique fonctionnelle, articulant souveraineté énergétique, logistique et influence régionale.
L’entretien avec John Perkins (auteur de Confessions of an Economic Hitman) a fourni un témoignage édifiant sur les formes les moins connues et étudiées de la guerre économique, révélant l’usage des institutions financières internationales pour contraindre les États à l’endettement stratégique, à la privatisation de secteurs clés ou à l’alignement géopolitique.
Le professeur Mehrdad Vahabi (université Sorbonne Paris Nord) indique que de manière générale, les sanctions économiques n’atteignent pas leurs objectifs initiaux. Il analyse la manière dont les sanctions ont renforcé la prise de contrôle de l’économie iranienne par les instances religieuses dans le cadre de l'Anfal. Il s’agit de l'un des principes sous-jacents des finances publiques chiites selon lequel tous les biens publics sans propriétaire appartiennent exclusivement au Prophète et, en son absence, à l'imam.
Dmitri Kuvaline (directeur adjoint et chef du laboratoire d'analyse et de prévision des processus microéconomiques de Moscou) met en avant l’adaptabilité du système économique russe, capable de redéployer ses capacités productives sous contraintes.
Le cas marocain, présenté par Ali Moutaïb (directeur des programmes de l’Ecole de Guerre Economique au Maroc) démontre comment une puissance moyenne peut construire une machine de guerre économique fonctionnelle, articulant souveraineté énergétique, logistique et influence régionale.
L’entretien avec John Perkins (auteur de Confessions of an Economic Hitman) a fourni un témoignage édifiant sur les formes les moins connues et étudiées de la guerre économique, révélant l’usage des institutions financières internationales pour contraindre les États à l’endettement stratégique, à la privatisation de secteurs clés ou à l’alignement géopolitique.
"L’Europe comme « incubateur » ou « accélérateur » de guerre économique"
Enfin, la dernière table ronde, animée par Arnaud de Morgny (directeur-adjoint CR451), a posé la question de l’Europe comme « incubateur » ou «accélérateur » de guerre économique. Ce dernier a mis l’acc ent sur un changement de paradigme précisant que la guerre économique constituait la situation usuelle des relations entre Etats y compris européens et que la guerre militaire en était un pic de violence. La seconde n’éteint pas pour autant l’existence de la première mais lui ajoute un niveau supplémentaire de conflictualité et de violence et en modifie les formes.
Nicolas Ravailhe (avocat) a critiqué l’approche ordo-libérale dominante dans l’Union, qui favorise certaines puissances comme l’Allemagne au détriment d’États moins combattifs comme la France.
Le général Pascal Legai (conseiller principal en sécurité à l'Agence spatiale européenne (ASE)) a illustré la tension entre solidarité européenne et compétition nationale au sein de l’ASE, plaidant pour un juste retour fondé sur la compétitivité.
Mme Jourda a conclu sur la nécessité d’une réponse stratégique commune européenne à la guerre économique menée par des acteurs systémiques comme la Chine.
Nicolas Ravailhe (avocat) a critiqué l’approche ordo-libérale dominante dans l’Union, qui favorise certaines puissances comme l’Allemagne au détriment d’États moins combattifs comme la France.
Le général Pascal Legai (conseiller principal en sécurité à l'Agence spatiale européenne (ASE)) a illustré la tension entre solidarité européenne et compétition nationale au sein de l’ASE, plaidant pour un juste retour fondé sur la compétitivité.
Mme Jourda a conclu sur la nécessité d’une réponse stratégique commune européenne à la guerre économique menée par des acteurs systémiques comme la Chine.
En conclusion
Le colloque a confirmé que la guerre économique du temps de paix n’est ni une métaphore, ni une exception, mais une modalité contemporaine et fondamentale du conflit entre puissances. Christian Harbulot a conclu en appelant à un changement de paradigme stratégique, intégrant pleinement cette réalité dans les doctrines de puissance et les politiques publiques nationales et européennes.
A propos du CR451
Le CR451 est le Centre de Recherche Appliquée de l’École de Guerre Économique (EGE), fondé en janvier 2022.
Dirigé par Christian Harbulot, expert en intelligence économique, le CR451 se concentre sur l’étude des conflits informationnels, de la guerre économique et des rapports de force géopolitiques. Il vise à développer des grilles de lecture innovantes pour comprendre les dynamiques de puissance modernes, notamment face à l’influence des GAFAM et aux nouvelles formes de confrontation économique.
Le centre mène des recherches appliquées, organise des séminaires, produit des podcasts et publie des études de cas.

 Accueil
Accueil

