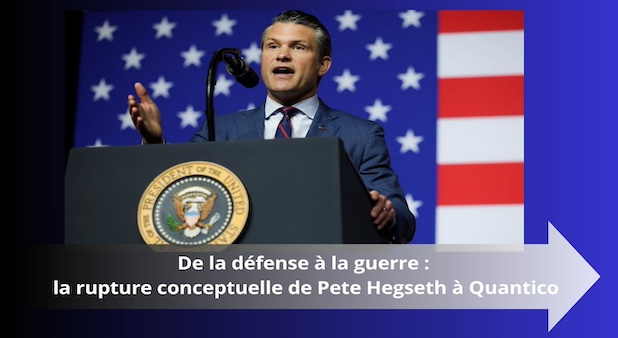
Toutes les autorités militaires réunies à Quantico
Lorsque Pete Hegseth a annoncé, le 30 septembre 2025, à Quantico, devant un aréopage de généraux et d’amiraux venus sur convocation de toutes les bases militaires américaines dans le monde, pour leur a assurer que le « Department of Defense » réputé « woke » était désormais un «Department of War » robuste et viril, il n’a pas seulement ressuscité une appellation d’avant 1947 : il a reconfiguré un paradigme.
Cette posture rhétorique, à la fois politique et anthropologique, marque un basculement du rapport américain à la puissance et à la légitimité.
Cette posture rhétorique, à la fois politique et anthropologique, marque un basculement du rapport américain à la puissance et à la légitimité.
Un changement de philosophie
Sur le plan philosophique, la substitution du terme défense par guerre opère un renversement de finalité.
Là où la défense présuppose la préservation des intérêts d’un État par la dissuasion ou la proportionnalité de la réponse à une agression, la guerre engage une ontologie de l’action et du conflit.
Carl von Clausewitz rappelait déjà que « la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens » (Vom Kriege, 1832) mais, en replaçant la guerre comme moyen d’exercice du pouvoir, voire comme finalité, Pete Hegseth inverse la hiérarchie : ce n’est plus le politique qui encadre la guerre, mais les objectifs de guerre qui (re)définissent la politique.
Hannah Arendt, dans Du mensonge à la violence (1972), soulignait le danger d’une confusion entre pouvoir et violence : la violence est un instrument, le pouvoir une relation consentie.
Revenir à un « ministère de la guerre », c’est accorder une légitimité de principe à l’usage de la force, non plus comme exception, mais comme expression ordinaire de la souveraineté.
La philosophie du droit naturel — de Hobbes à Kant — s’en trouve annihilée : on ne cherche plus à sortir de l’état de guerre, on le réintègre comme condition essentielle, incontournable, de l’existence.
On se rapproche des conceptions d’Héraclite, Hegel, Schmitt ou Agamben qui conceptualisent une guerre perpétuelle ayant pour fonction structurante de préserver la sécurité et le leadership d'un État.
Là où la défense présuppose la préservation des intérêts d’un État par la dissuasion ou la proportionnalité de la réponse à une agression, la guerre engage une ontologie de l’action et du conflit.
Carl von Clausewitz rappelait déjà que « la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens » (Vom Kriege, 1832) mais, en replaçant la guerre comme moyen d’exercice du pouvoir, voire comme finalité, Pete Hegseth inverse la hiérarchie : ce n’est plus le politique qui encadre la guerre, mais les objectifs de guerre qui (re)définissent la politique.
Hannah Arendt, dans Du mensonge à la violence (1972), soulignait le danger d’une confusion entre pouvoir et violence : la violence est un instrument, le pouvoir une relation consentie.
Revenir à un « ministère de la guerre », c’est accorder une légitimité de principe à l’usage de la force, non plus comme exception, mais comme expression ordinaire de la souveraineté.
La philosophie du droit naturel — de Hobbes à Kant — s’en trouve annihilée : on ne cherche plus à sortir de l’état de guerre, on le réintègre comme condition essentielle, incontournable, de l’existence.
On se rapproche des conceptions d’Héraclite, Hegel, Schmitt ou Agamben qui conceptualisent une guerre perpétuelle ayant pour fonction structurante de préserver la sécurité et le leadership d'un État.
Un changement sociologique
Sur le plan sociologique, cette mutation correspond à une « remilitarisation » des codes et des corps.
Le sociologue Erving Goffman, dans Asylums (1961), décrivait la manière dont les institutions totalitaires façonnent les identités par le contrôle des gestes et des apparences.
La réintroduction de normes plus strictes sur les barbes, les tests physiques ou l’uniformité vestimentaire dans l’armée américaine, telle qu’évoquée à Quantico, s’inscrit dans cette logique : le corps devient le premier champ de bataille du contrôle idéologique.
Michel Foucault, dans Surveiller et punir (1975), montrait comment le pouvoir disciplinaire s’exerce à travers la normalisation des conduites : la guerre institutionnelle contre la “décadence” ou le “wokeism” n’est pas un conflit d’idées, mais de conformations.
Le « ministère de la guerre » devient alors non seulement un appareil militaire, mais un dispositif de régulation sociale et sociétale.
Norbert Elias, dans La dynamique de l’Occident, rappelait que la civilisation consiste précisément en la canalisation des pulsions agressives des groupes sociaux violents par la réaffirmation des normes sociales et des institutions régulatrices.
Réintroduire le lexique guerrier dans la sphère politique, correspondrait à la conviction, in fine paradoxale, que la lutte contre la décivilisation se gagne par plus de violence institutionnelle.
Le sociologue Erving Goffman, dans Asylums (1961), décrivait la manière dont les institutions totalitaires façonnent les identités par le contrôle des gestes et des apparences.
La réintroduction de normes plus strictes sur les barbes, les tests physiques ou l’uniformité vestimentaire dans l’armée américaine, telle qu’évoquée à Quantico, s’inscrit dans cette logique : le corps devient le premier champ de bataille du contrôle idéologique.
Michel Foucault, dans Surveiller et punir (1975), montrait comment le pouvoir disciplinaire s’exerce à travers la normalisation des conduites : la guerre institutionnelle contre la “décadence” ou le “wokeism” n’est pas un conflit d’idées, mais de conformations.
Le « ministère de la guerre » devient alors non seulement un appareil militaire, mais un dispositif de régulation sociale et sociétale.
Norbert Elias, dans La dynamique de l’Occident, rappelait que la civilisation consiste précisément en la canalisation des pulsions agressives des groupes sociaux violents par la réaffirmation des normes sociales et des institutions régulatrices.
Réintroduire le lexique guerrier dans la sphère politique, correspondrait à la conviction, in fine paradoxale, que la lutte contre la décivilisation se gagne par plus de violence institutionnelle.
Un changement psychologique
La dimension psychologique de cette reconfiguration ne doit pas être sous-estimée.
Pete Hegseth parle « d’instaurer une peur salutaire » pour restaurer la discipline et l’esprit combatif et va même plus loin, il exprime clairement que la formation militaire de base doit retrouver ce qu'elle aurait toujours dû être : « scary, tough, and disciplined », effrayante, difficile et disciplinée.
Il entend ainsi se donner les moyens d'inculquer cette « peur salutaire » aux nouvelles recrues, afin de garantir la formation de futurs combattants ».
Cependant, comme le soulignait Stanley Milgram dans Obedience to Authority (1974), l’obéissance sous contrainte émotionnelle déplace la responsabilité morale vers le commandement, favorisant la banalisation des transgressions du cadre moral, autorisant toutes les dérives.
L’usage stratégique de la peur, décrit par Martha Nussbaum dans The Monarchy of Fear (2018), altère la perception de la menace et alimente la fragmentation sociale : l’ennemi extérieur est intériorisé, la loyauté devient défensive.
Le militaire, soumis à ce régime émotionnel, n’est plus seulement un serviteur de l’État ; il devient l’agent d’une psychologie collective façonnée par la peur de l’effondrement, la honte de la faiblesse et la glorification de la force.
Le risque, comme l’avait anticipé Erich Fromm dans La peur de la liberté (1941), est de substituer à la liberté, un refuge dans l’autorité : la soumission volontaire devient le moteur de l’ordre.
Pete Hegseth parle « d’instaurer une peur salutaire » pour restaurer la discipline et l’esprit combatif et va même plus loin, il exprime clairement que la formation militaire de base doit retrouver ce qu'elle aurait toujours dû être : « scary, tough, and disciplined », effrayante, difficile et disciplinée.
Il entend ainsi se donner les moyens d'inculquer cette « peur salutaire » aux nouvelles recrues, afin de garantir la formation de futurs combattants ».
Cependant, comme le soulignait Stanley Milgram dans Obedience to Authority (1974), l’obéissance sous contrainte émotionnelle déplace la responsabilité morale vers le commandement, favorisant la banalisation des transgressions du cadre moral, autorisant toutes les dérives.
L’usage stratégique de la peur, décrit par Martha Nussbaum dans The Monarchy of Fear (2018), altère la perception de la menace et alimente la fragmentation sociale : l’ennemi extérieur est intériorisé, la loyauté devient défensive.
Le militaire, soumis à ce régime émotionnel, n’est plus seulement un serviteur de l’État ; il devient l’agent d’une psychologie collective façonnée par la peur de l’effondrement, la honte de la faiblesse et la glorification de la force.
Le risque, comme l’avait anticipé Erich Fromm dans La peur de la liberté (1941), est de substituer à la liberté, un refuge dans l’autorité : la soumission volontaire devient le moteur de l’ordre.
Une transformation de la perception du risque
Du point de vue cindynique — la science des dangers conceptualisée par Georges-Yves Kervern et développé par Guy Planchette — le glissement lexical n’est pas neutre : il produit une transformation de la perception du risque et l’élargissement des vulnérabilités.
Ces points ont été développés lors de la Journée d'étude "The Nature of War" organisée par le
Pr Alan James (King's College de Londres et IEA de Paris) notamment lors de la contribution « Conceptualisations cindyniques de la guerre » consultable ici.
En se nommant “ministère de la guerre”, l’institution réactive une dynamique de risque systémique.
Selon Patrick Lagadec (La civilisation du risque, 1981), les sociétés modernes se caractérisent par une prolifération d’incertitudes que seule une gouvernance réflexive peut contenir. Or, substituer une logique d’affrontement à une logique de régulation, c’est fragiliser les mécanismes de prévention et abaisser le seuil de déclenchement de ceux de réaction.
Les cindyniques montrent que le danger n’est pas seulement dans la menace externe, mais dans la construction même du système de réponse.
En désignant la guerre comme horizon, le pouvoir crée un cadre auto-réalisateur : plus la guerre devient permanente, plus les conditions de paix deviennent inaccessibles. L’effet domino est institutionnel : affaiblissement du contrôle civil, militarisation du discours public, normalisation de la coercition.
Cette logique a déjà été décrite par Ulrich Beck (La société du risque, 1986) : lorsque la gestion du danger devient la matrice de l’action publique, la société entre dans un état d’urgence prolongé. Le “ministère de la guerre” matérialise ce basculement de la prévention vers la confrontation comme mode de gouvernement.
Ces points ont été développés lors de la Journée d'étude "The Nature of War" organisée par le
Pr Alan James (King's College de Londres et IEA de Paris) notamment lors de la contribution « Conceptualisations cindyniques de la guerre » consultable ici.
En se nommant “ministère de la guerre”, l’institution réactive une dynamique de risque systémique.
Selon Patrick Lagadec (La civilisation du risque, 1981), les sociétés modernes se caractérisent par une prolifération d’incertitudes que seule une gouvernance réflexive peut contenir. Or, substituer une logique d’affrontement à une logique de régulation, c’est fragiliser les mécanismes de prévention et abaisser le seuil de déclenchement de ceux de réaction.
Les cindyniques montrent que le danger n’est pas seulement dans la menace externe, mais dans la construction même du système de réponse.
En désignant la guerre comme horizon, le pouvoir crée un cadre auto-réalisateur : plus la guerre devient permanente, plus les conditions de paix deviennent inaccessibles. L’effet domino est institutionnel : affaiblissement du contrôle civil, militarisation du discours public, normalisation de la coercition.
Cette logique a déjà été décrite par Ulrich Beck (La société du risque, 1986) : lorsque la gestion du danger devient la matrice de l’action publique, la société entre dans un état d’urgence prolongé. Le “ministère de la guerre” matérialise ce basculement de la prévention vers la confrontation comme mode de gouvernement.
Ce qu’il faut retenir
En requalifiant la mission de l’appareil militaire, Pete Hegseth et ses soutiens ne font pas qu’ajuster une politique de défense : ils réécrivent une grammaire du pouvoir.
- Philosophiquement, ils substituent à la raison d’État une raison de guerre.
- Sociologiquement, ils reforment la cohésion par l’uniformisation et l’exclusion.
- Psychologiquement, ils mobilisent la peur comme ciment de loyauté.
- Cindyniquement, ils accroissent les vulnérabilités systémiques qu’ils prétendent maîtriser.
La sémantique n’est jamais innocente.
Elle induit les notions et les représentations qui façonnent la perception du réel. Et dans ce cas précis, c’est le fondement même de la civilisation qui est challengé/interrogé.
Elle induit les notions et les représentations qui façonnent la perception du réel. Et dans ce cas précis, c’est le fondement même de la civilisation qui est challengé/interrogé.
A propos de Jean-Marie Carrara
Né en 1958 à Rabat (Maroc), Jean-Marie CARRARA a effectué toutes ses études à Lille (France). D’abord attiré par la santé de l’Homme, il devient Docteur en Pharmacie et diplômé de Biologie Humaine.
Comme la santé des entreprises et des organisations sont essentielles pour l’Homme, il compléta sa formation par un DESS d’Administration des Entreprises et un DESS de Finance et de Fiscalité Internationales.
Il est auditeur en Intelligence Economique et Stratégique à l'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN
En collaboration avec
Dr Jan-Cédric Hansen
Praticien hospitalier, expert en pilotage stratégique de crise, vice-président de GloHSA et de WADEM Europe, Administrateur de StratAdviser Ltd - http://www.stratadviser.com/
Frank van Trimpont
Médecin anesthésiste-réanimateur et urgentiste. Chercheur et chargé de cours à l'Université Libre de Bruxelles. Président du Collège Européen de Médecine de Catastrophe, président du chapitre Européen de la WADEM et président de Counter Terrorism Medicine Europe.
Sevan Gérard
EMT-P, BSc, MA, est un expert en risques et résilience qui dirige l'innovation en matière de santé en cas de catastrophe en tant que directeur de la santé et de la recherche à l'université médicale Paracelsus, vice-président du Disaster Health Institute et président de l'European Disaster Alliance.

 Accueil
Accueil



