Le paradoxe français
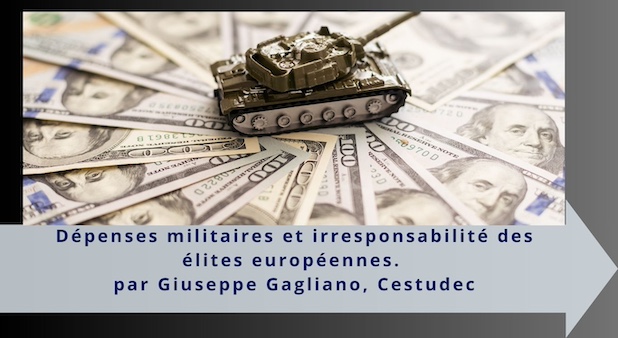
Le ratio dette/PIB est passé de 98 % en 2018 à 115 % en 2025, et les seuls intérêts représentent presque 2 % du PIB. Pourtant, malgré cet état d'urgence financier, la dépense militaire a bondi de 35 milliards d'euros en 2018 à plus de 50 milliards en 2025, avec une trajectoire fixée à 413 milliards d'ici 2030.
La "grandeur" française se bâtit donc sur une base économique de plus en plus fragile.
La "grandeur" française se bâtit donc sur une base économique de plus en plus fragile.
L'Italie sur la même voie
Cette dynamique n'est pas propre à la France. L'Italie affiche un ratio dette/PIB de 135 % et des charges d'intérêts avoisinant 4 % du PIB, le niveau le plus élevé en Europe. Et pourtant, le gouvernement italien prévoit lui aussi d'accroître ses dépenses militaires, suivant le même modèle : comprimer l'État social pour financer l'appareil de défense.
Une stratégie qui interroge la logique des classes dirigeantes européennes, prêtes à fragiliser leurs finances publiques pour répondre à une logique d'alignement géopolitique, plus qu'à une nécessité de sécurité nationale.
Une stratégie qui interroge la logique des classes dirigeantes européennes, prêtes à fragiliser leurs finances publiques pour répondre à une logique d'alignement géopolitique, plus qu'à une nécessité de sécurité nationale.
Le contre-exemple russe
Le contraste est frappant avec la Russie, qui maintient un ratio dette/PIB limité à 16,4 %.
Malgré des taux d'intérêt élevés, le coût du service de la dette reste maîtrisé. Moscou concentre ses efforts sur l'effort de guerre en Ukraine sans compromettre la soutenabilité de ses finances.
Ce constat, qui ne saurait être lu comme une apologie, souligne néanmoins la différence de trajectoire entre un pays engagé dans un conflit militaire direct et des États européens qui s'endettent massivement pour préparer une éventuelle guerre.
Malgré des taux d'intérêt élevés, le coût du service de la dette reste maîtrisé. Moscou concentre ses efforts sur l'effort de guerre en Ukraine sans compromettre la soutenabilité de ses finances.
Ce constat, qui ne saurait être lu comme une apologie, souligne néanmoins la différence de trajectoire entre un pays engagé dans un conflit militaire direct et des États européens qui s'endettent massivement pour préparer une éventuelle guerre.
Le choix politique des élites européennes
Derrière ces chiffres se cache une vérité dérangeante : les dirigeants européens placent la dépense militaire au-dessus des besoins sociaux et de l'équilibre financier.
Il s'agit moins d'une stratégie de défense rationnelle que d'un choix idéologique et politique. L'obsession de contenir la Russie, même au prix d'un appauvrissement progressif de la population, devient la ligne directrice. Le sacrifice n'est pas seulement économique mais social : écoles, hôpitaux et services publics se voient amputés, tandis que le complexe militaro-industriel prospère.
Il s'agit moins d'une stratégie de défense rationnelle que d'un choix idéologique et politique. L'obsession de contenir la Russie, même au prix d'un appauvrissement progressif de la population, devient la ligne directrice. Le sacrifice n'est pas seulement économique mais social : écoles, hôpitaux et services publics se voient amputés, tandis que le complexe militaro-industriel prospère.
Vers une Europe affaiblie
Cette fuite en avant révèle une profonde irresponsabilité. À vouloir rivaliser sur le terrain militaire, l'Europe risque de compromettre sa propre cohésion sociale et sa stabilité économique.
Les coupes budgétaires fragiliseront l'État providence, moteur de paix intérieure depuis 1945, et renforceront les tensions politiques internes.
Ce choix ouvre un paradoxe : au nom de la sécurité, on met en péril les fondements mêmes de la sécurité sociale et économique des citoyens.
Les coupes budgétaires fragiliseront l'État providence, moteur de paix intérieure depuis 1945, et renforceront les tensions politiques internes.
Ce choix ouvre un paradoxe : au nom de la sécurité, on met en péril les fondements mêmes de la sécurité sociale et économique des citoyens.
Conclusion
L'explosion des budgets militaires en pleine crise de la dette démontre que les élites européennes ont perdu le sens des priorités. Alors que la population subit l'inflation, la stagnation salariale et le recul des protections sociales, les gouvernements choisissent de financer la guerre et la "projection de puissance".
L'Europe, au lieu d'incarner un modèle d'équilibre et de diplomatie, semble s'engager sur une voie d'appauvrissement volontaire, où la grandeur affichée masque une fragilité croissante.
L'Europe, au lieu d'incarner un modèle d'équilibre et de diplomatie, semble s'engager sur une voie d'appauvrissement volontaire, où la grandeur affichée masque une fragilité croissante.
A propos de l'auteur
Giuseppe Gagliano a fondé en 2011 le réseau international Cestudec (Centre d'études stratégiques Carlo de Cristoforis), basé à Côme (Italie), dans le but d'étudier, dans une perspective réaliste, les dynamiques conflictuelles des relations internationales. Ce réseau met l'accent sur la dimension de l'intelligence et de la géopolitique, en s'inspirant des réflexions de Christian Harbulot, fondateur et directeur de l'École de Guerre Économique (EGE).
Il collabore avec le Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R) (Lien),https://cf2r.org/le-cf2r/gouvernance-du-cf2r/ et avec l'Université de Calabre dans le cadre du Master en Intelligence, et avec l'Iassp de Milan (Lien).https://www.iassp.org/team_master/giuseppe-gagliano/
La responsabilité de la publication incombe exclusivement aux auteurs individuels.

 Accueil
Accueil