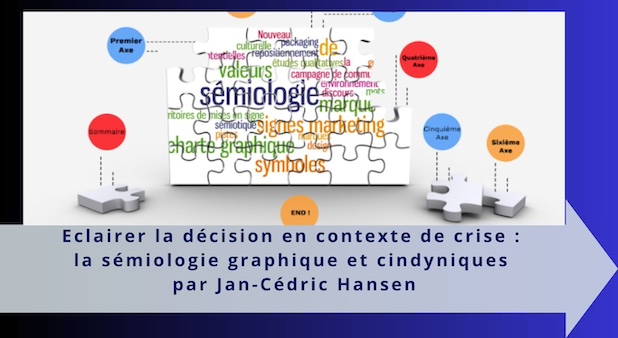
Dans cette lignée, Jacques Bertin a marqué un tournant avec sa Sémiologie graphique, véritable grammaire visuelle, fondée sur les variables de taille, de couleur, de texture, de position ou d’orientation, visant à montrer que l’image pouvait devenir un langage rigoureux, non pas décoratif mais opératoire, capable d’organiser les données et de les rendre partageables.
Réduire les interprétations erronées
Ce geste, en apparence technique, a une portée philosophique : il s’agit de réduire l’arbitraire des interprétations pour permettre à une communauté d’accéder à une forme commune de vérité.
Jacques Bertin soulignait un point crucial : le choix d’une représentation n’est jamais neutre.
La détermination d’une limite, le recours à une échelle chromatique, la simplification d’un diagramme peuvent fabriquer des « frontières » qui n’existent pas.
La carte colore une zone, et soudain une opposition paraît évidente, alors qu’elle est le produit d’une convention visuelle.
Les décideurs risquent alors de prendre des options qui paraissent sensées, mais sont en réalité dénuées de fondement.
Jacques Bertin soulignait un point crucial : le choix d’une représentation n’est jamais neutre.
La détermination d’une limite, le recours à une échelle chromatique, la simplification d’un diagramme peuvent fabriquer des « frontières » qui n’existent pas.
La carte colore une zone, et soudain une opposition paraît évidente, alors qu’elle est le produit d’une convention visuelle.
Les décideurs risquent alors de prendre des options qui paraissent sensées, mais sont en réalité dénuées de fondement.
Tous les domaines sont concernés
Cette vigilance vaut dans de nombreux contextes actuels.
Une carte sanitaire peut exagérer une disparité territoriale et conduire à une allocation inadaptée des ressources.
Un tableau de bord en entreprise, simplifié à l’excès, peut donner l’illusion d’une performance homogène tout en masquant des vulnérabilités critiques.
Jacques Bertin alertait d’ailleurs contre les représentations trop « évidentes », celles qui offrent un sentiment de clarté immédiate mais induisent des biais de perception.
Pour les responsables et décideurs, cette conscience est essentielle : minimiser les biais cognitifs induits par les représentations visuelles est une condition de la pertinence de la décision.
Une carte sanitaire peut exagérer une disparité territoriale et conduire à une allocation inadaptée des ressources.
Un tableau de bord en entreprise, simplifié à l’excès, peut donner l’illusion d’une performance homogène tout en masquant des vulnérabilités critiques.
Jacques Bertin alertait d’ailleurs contre les représentations trop « évidentes », celles qui offrent un sentiment de clarté immédiate mais induisent des biais de perception.
Pour les responsables et décideurs, cette conscience est essentielle : minimiser les biais cognitifs induits par les représentations visuelles est une condition de la pertinence de la décision.
La nécessité d’ancrer la perception
Mais la portée de cette sémiologie est plus large encore.
Comme l’ont montré Saussure ou Barthes, les signes structurent la circulation des représentations collectives.
Nos sociétés sont saturées de graphiques, de cartes épidémiques, de courbes économiques ou climatiques : ils organisent un espace commun de perception.
La sémiologie graphique fournit ici une infrastructure invisible de la décision collective.
Elle n’est pas seulement un instrument descriptif, elle fédère des perceptions et aligne des imaginaires. Sans cet ancrage, la discussion publique perd sa cohérence.
À l’échelle individuelle, la psychologie cognitive éclaire pourquoi cette grammaire est efficace.
Les variables graphiques de Bertin exploitent nos capacités rapides de discrimination visuelle et d’orientation attentionnelle, telles que décrites par Kahneman.
Un contraste de couleur ou de taille se repère instantanément et oriente la décision.
Dans un contexte de crise, cette économie cognitive est précieuse : une carte claire de la propagation d’un virus ou un schéma bien conçu d’un réseau logistique défaillant peut permettre une réaction adaptée, là où une information textuelle saturée aurait paralysé l’action.
L’enjeu n’est pas de céder à l’urgence à agir, mais de préserver la lisibilité pour piloter la situation avec discernement.
Comme l’ont montré Saussure ou Barthes, les signes structurent la circulation des représentations collectives.
Nos sociétés sont saturées de graphiques, de cartes épidémiques, de courbes économiques ou climatiques : ils organisent un espace commun de perception.
La sémiologie graphique fournit ici une infrastructure invisible de la décision collective.
Elle n’est pas seulement un instrument descriptif, elle fédère des perceptions et aligne des imaginaires. Sans cet ancrage, la discussion publique perd sa cohérence.
À l’échelle individuelle, la psychologie cognitive éclaire pourquoi cette grammaire est efficace.
Les variables graphiques de Bertin exploitent nos capacités rapides de discrimination visuelle et d’orientation attentionnelle, telles que décrites par Kahneman.
Un contraste de couleur ou de taille se repère instantanément et oriente la décision.
Dans un contexte de crise, cette économie cognitive est précieuse : une carte claire de la propagation d’un virus ou un schéma bien conçu d’un réseau logistique défaillant peut permettre une réaction adaptée, là où une information textuelle saturée aurait paralysé l’action.
L’enjeu n’est pas de céder à l’urgence à agir, mais de préserver la lisibilité pour piloter la situation avec discernement.
Les cindyniques : une illustration parfaite de la force des graphiques de Bertin
Les cindyniques offrent enfin un cadre pour comprendre la portée de ces représentations dans le pilotage des dangers et des crises.
Elles distinguent le danger (propriétés intrinsèques d’un élément constituant une menace), le risque (confrontation, volontaire ou non, à ce danger, avec possibilité de bénéfice ou de dommage), et la vulnérabilité (propension d’un organisme à subir un endommagement en raison de ses fragilités).
Dans ce modèle, les représentations graphiques de Bertin deviennent des instruments pour rendre visibles les dangers, anticiper la matérialisation des risques et identifier les zones de vulnérabilité.
La valeur de la sémiologie graphique apparaît ici comme une technologie de visibilité des déformations qui affectent le cadre d’une organisation ou d’une société.
Dans un hypercube cindynique, elle aide à détecter les tensions internes, à prendre la mesure des pressions exercées et à représenter l’état de cohésion ou de fragilité. Elle ne se limite pas à illustrer des données, elle devient un outil d’alerte : un langage qui rend sensibles les tensions avant qu’elles ne se transforment en ruptures catastrophiques.
Les exemples récents abondent.
Pendant la pandémie, certaines cartes épidémiologiques ont tracé des frontières régionales qui ne correspondaient pas à la dynamique réelle de circulation du virus, induisant des décisions de confinement incohérentes.
Dans le monde de l’entreprise, des représentations financières ou RH trop simplifiées ont masqué des fragilités structurelles, conduisant à des plans d’action trompeurs.
À l’inverse, des visualisations conçues avec rigueur, tenant compte des limites et des biais, ont permis d’anticiper des ruptures de chaîne logistique ou de repérer à temps une fragilité organisationnelle.
Elles distinguent le danger (propriétés intrinsèques d’un élément constituant une menace), le risque (confrontation, volontaire ou non, à ce danger, avec possibilité de bénéfice ou de dommage), et la vulnérabilité (propension d’un organisme à subir un endommagement en raison de ses fragilités).
Dans ce modèle, les représentations graphiques de Bertin deviennent des instruments pour rendre visibles les dangers, anticiper la matérialisation des risques et identifier les zones de vulnérabilité.
La valeur de la sémiologie graphique apparaît ici comme une technologie de visibilité des déformations qui affectent le cadre d’une organisation ou d’une société.
Dans un hypercube cindynique, elle aide à détecter les tensions internes, à prendre la mesure des pressions exercées et à représenter l’état de cohésion ou de fragilité. Elle ne se limite pas à illustrer des données, elle devient un outil d’alerte : un langage qui rend sensibles les tensions avant qu’elles ne se transforment en ruptures catastrophiques.
Les exemples récents abondent.
Pendant la pandémie, certaines cartes épidémiologiques ont tracé des frontières régionales qui ne correspondaient pas à la dynamique réelle de circulation du virus, induisant des décisions de confinement incohérentes.
Dans le monde de l’entreprise, des représentations financières ou RH trop simplifiées ont masqué des fragilités structurelles, conduisant à des plans d’action trompeurs.
À l’inverse, des visualisations conçues avec rigueur, tenant compte des limites et des biais, ont permis d’anticiper des ruptures de chaîne logistique ou de repérer à temps une fragilité organisationnelle.
Une leçon claire
Penser les signes, aujourd’hui, c’est penser la capacité des sociétés et des organisations à réguler leur rapport au danger, au risque et à leur propre vulnérabilité.
La sémiotique n’est pas une spéculation abstraite, mais une grammaire de la régulation.
La séméiologie graphique de Jacques Bertin, relue dans la perspective des cindyniques, devient un instrument pour comprendre, anticiper et dépasser les tensions de notre contemporanéité.
Encore faut-il que décideurs et responsables se souviennent qu’aucune représentation n’est anodine, et que chaque choix graphique engage leur responsabilité
La sémiotique n’est pas une spéculation abstraite, mais une grammaire de la régulation.
La séméiologie graphique de Jacques Bertin, relue dans la perspective des cindyniques, devient un instrument pour comprendre, anticiper et dépasser les tensions de notre contemporanéité.
Encore faut-il que décideurs et responsables se souviennent qu’aucune représentation n’est anodine, et que chaque choix graphique engage leur responsabilité
A propos de l'auteur
Dr Jan-Cédric Hansen
Praticien hospitalier, expert en pilotage stratégique de crise, vice-président de GloHSA et de WADEM Europe, Administrateur de StratAdviser Ltd - http://www.stratadviser.com/

 Accueil
Accueil