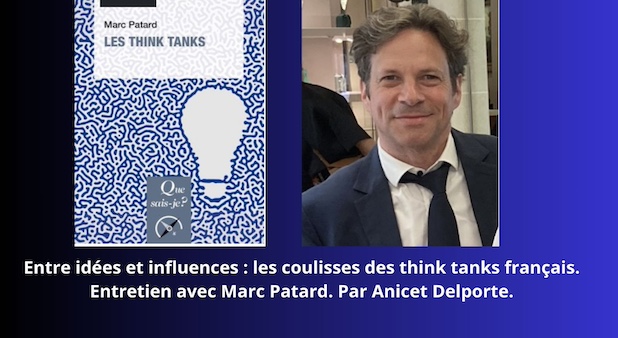Bonjour Marc Patard, merci d’être avec nous. Vous publiez dans la collection Que sais-je ? un ouvrage intitulé Think Tanks. Ces laboratoires d’idées influencent nos débats publics et nos politiques. Ensemble, nous allons découvrir leur rôle, leur histoire et leur impact.
Entretien pour Veille Magazine avec Anicet Delporte
Terra Nova, la Fondapol, L’IFRAP, ou encore Res Publica sont des think tanks : quelle traduction proposez-vous pour le terme « think tank » ?
MP : Pour ma part, et suite à mes travaux de recherche, je traduis « think tanks » par Instituts d’ingénierie politique. Clairement, les think tanks font de l’ingénierie politique au sens où ils conçoivent des réponses économiques et politiques aux questions que pose le contexte social et politique, alors que les partis politiques traditionnels peinent parfois à trouver des solutions.
Habituellement, les think tanks sont désignés comme des « laboratoires d’idées » ou des « groupes de réflexion ». Je souligne dans le livre que les think tanks inscrivent davantage leurs investigations dans la recherche de solutions pragmatiques à des questions socio-économiques que dans la recherche d’idées en général.
De la même manière, ils ne répondent pas – et ce n’est pas leur sujet – aux process académiques stricts d’une recherche de type universitaire qui s’étale sur des années et qui s’exprime en langage scientifique. Inversement, traduire les « think tanks » par « groupe de réflexion » est très réducteur car les think tanks produisent des études le plus souvent publiées et des recommandations concrètes, ce que ne font pas les groupes de réflexion qui relèvent souvent de l’entre-soi.
Habituellement, les think tanks sont désignés comme des « laboratoires d’idées » ou des « groupes de réflexion ». Je souligne dans le livre que les think tanks inscrivent davantage leurs investigations dans la recherche de solutions pragmatiques à des questions socio-économiques que dans la recherche d’idées en général.
De la même manière, ils ne répondent pas – et ce n’est pas leur sujet – aux process académiques stricts d’une recherche de type universitaire qui s’étale sur des années et qui s’exprime en langage scientifique. Inversement, traduire les « think tanks » par « groupe de réflexion » est très réducteur car les think tanks produisent des études le plus souvent publiées et des recommandations concrètes, ce que ne font pas les groupes de réflexion qui relèvent souvent de l’entre-soi.
Historiquement, peut-on dire de ces instituts d’ingénierie politique qu’ils viennent des Etats-Unis ?
MP : vous avez raison pour une part. En effet, après la Seconde Guerre mondiale, le concept de soft power s’est installé et les think tanks en sont l’illustration. Pour autant, je souligne dans mes ouvrages l’importance de la filiation française des sociétés savantes du XVIIIè siècle, des « Bureaux de l’esprit » comme l’on disait à cette époque et des Clubs des années 1960.
Il y a en France cette tradition d’une recherche parapolitique qui donne la possibilité aux intellectuels et à la société civile de prendre part au débat. Je crois que cette précieuse tradition ne doit pas être passée sous silence sous prétexte que le vocable de « think tank » est anglo-saxon. Autrement dit, la filiation des think tanks est double : française et anglosaxonne
Il y a en France cette tradition d’une recherche parapolitique qui donne la possibilité aux intellectuels et à la société civile de prendre part au débat. Je crois que cette précieuse tradition ne doit pas être passée sous silence sous prétexte que le vocable de « think tank » est anglo-saxon. Autrement dit, la filiation des think tanks est double : française et anglosaxonne
A combien peut-on estimer le nombre de think tanks dans le monde ?
Le chercheur américain James G. McGann estime à 12.000 le nombre de think tanks sur les cinq continents dans les années 2020. Pour autant, il est difficile de les compter avec exactitude puisqu’il n’existe pas de définition officielle du think tank, et qu’il n’est pas exagéré de dire que cet univers est très malléable.
Malgré l’observation minutieuse de ces organisations à travers le prisme de nombreux indicateurs, les contours d’un think tank ne sont pas toujours nets au sens où certaines organisations prétendent relever d’un think tank alors qu’elles s’en approchent seulement. Les contrastes entre think tanks sont saisissants. Ainsi, certains instituts d’ingénierie politique nord-américains comptabilisent plusieurs centaines de salariés, quand d’autres structures en France n’en n’auront qu’un par exemple.
L’ecosystème politique local compte beaucoup également dans la cartographie des think tanks. Ainsi, quelques pays où la liberté d’expression est plutôt régulée par le Parti officiel comptabilisent des think tanks : mais quelle est leur réelle marge de manœuvre ? Nous le voyons, l’univers des think tanks n’est ni homogène ni uniforme, bien au contraire. Cela dit, on peut, sans trop se tromper, comptabiliser une centaine de think tanks en France, le double pour l’Allemagne et plus de 400 pour le Royaume-Uni, alors que l’on en compte plus de 2000 aux USA.
De la même manière, les budgets varient considérablement : autour du million d’euros en France pour les cinq Fondations politiques (Jean Jaurès, Fondapol, ResPublica, Robert Schuman et Gabriel Péri) et plusieurs dizaines de millions de dollars aux USA (Rand, Heritage, Brookings). Mise à part l’IFRI notamment avec son équipe interne de chercheurs, l’IRIS, l’IDDRI, Montaigne et la FRS, la France reste l’un des parents pauvres en matière de nombre de think tanks, de périmètre, de budget et de considération par l’exécutif.
Malgré l’observation minutieuse de ces organisations à travers le prisme de nombreux indicateurs, les contours d’un think tank ne sont pas toujours nets au sens où certaines organisations prétendent relever d’un think tank alors qu’elles s’en approchent seulement. Les contrastes entre think tanks sont saisissants. Ainsi, certains instituts d’ingénierie politique nord-américains comptabilisent plusieurs centaines de salariés, quand d’autres structures en France n’en n’auront qu’un par exemple.
L’ecosystème politique local compte beaucoup également dans la cartographie des think tanks. Ainsi, quelques pays où la liberté d’expression est plutôt régulée par le Parti officiel comptabilisent des think tanks : mais quelle est leur réelle marge de manœuvre ? Nous le voyons, l’univers des think tanks n’est ni homogène ni uniforme, bien au contraire. Cela dit, on peut, sans trop se tromper, comptabiliser une centaine de think tanks en France, le double pour l’Allemagne et plus de 400 pour le Royaume-Uni, alors que l’on en compte plus de 2000 aux USA.
De la même manière, les budgets varient considérablement : autour du million d’euros en France pour les cinq Fondations politiques (Jean Jaurès, Fondapol, ResPublica, Robert Schuman et Gabriel Péri) et plusieurs dizaines de millions de dollars aux USA (Rand, Heritage, Brookings). Mise à part l’IFRI notamment avec son équipe interne de chercheurs, l’IRIS, l’IDDRI, Montaigne et la FRS, la France reste l’un des parents pauvres en matière de nombre de think tanks, de périmètre, de budget et de considération par l’exécutif.
Au-delà de leur origine, y a-t-il des missions spécifiques aux think tanks ?
Disons que les think tanks croisent des missions qui, traditionnellement, sont séparées.
L’expertise est le cœur de leur métier assorti de recommandations. L’intermédiation et les Relations publiques sont essentielles aussi à leurs missions. L’influence de la décision les occupe bien et la constitution d’un vivier d’un nouveau personnel politique les caractérise aussi.
Dans ce foisonnement d’activités, plusieurs univers professionnels peuvent y trouver leur compte : des experts bien sûr, des universitaires, des politiques, les milieux d’affaires mais aussi des journalistes.
L’expertise est le cœur de leur métier assorti de recommandations. L’intermédiation et les Relations publiques sont essentielles aussi à leurs missions. L’influence de la décision les occupe bien et la constitution d’un vivier d’un nouveau personnel politique les caractérise aussi.
Dans ce foisonnement d’activités, plusieurs univers professionnels peuvent y trouver leur compte : des experts bien sûr, des universitaires, des politiques, les milieux d’affaires mais aussi des journalistes.
Puisque vous mentionnez les journalistes, quel rapport, selon vous, entretiennent-ils avec les think tanks ?
Quelques think tanks connus, notamment dans le domaine des relations internationales, livrent des études très poussées avec des analyses consolidées. C’est une économie de temps substantielle désormais pour bon nombre de journalistes qui sont pris par le flux incessant de l’actualité. Dès lors, les think tanks deviennent des fournisseurs d’analyses aux journalistes, ce qui explique aussi l’omniprésence désormais des think tankers sur les plateaux de télévision ou radio : les uns gagnent en sources et contenus et les autres en visibilité : c’est du gagnant-gagnant !
Et quel rapport les partis politiques entretiennent-ils aujourd’hui avec ces instituts d’ingénierie politique ?
MP : Aujourd’hui, les partis politiques sont pour beaucoup asséchés : privés de Bureaux d’Etudes par souci d’économie, les partis se recentrent sur leur activité militante. Un responsable dans les organes décisionnels d’un parti me confiait qu’il se servait des analyses d’un think tank proche de sa famille politique pour les transformer en éléments de langage. On le voit, les think tanks ont réussi à se rendre indispensables au point d’avoir récupéré cette place autrefois occupée par les partis politiques qui vise à émettre des recommandations.
Dans mes ouvrages, j’arrive à cette idée que l’on assiste à une nouvelle division du travail politique : aux think tanks, les analyses et les recommandations, aux partis politiques, l’organisation de l’activité militante et électorale.
Dans mes ouvrages, j’arrive à cette idée que l’on assiste à une nouvelle division du travail politique : aux think tanks, les analyses et les recommandations, aux partis politiques, l’organisation de l’activité militante et électorale.
Situés au carrefour des stratégies électorales et des intérêts possibles de leurs financeurs, les activités des think tanks sont-elles encadrées ?
MP : Sur le plan juridique, leurs activités ne sont pas encadrées dans la mesure où le « think tank » n’est pas l’objet d’une définition législative ou jurisprudentielle. Le terme apparaît juridiquement en octobre 2024 dans une décision du Conseil d’Etat qui vient préciser que « les organismes de réflexion dits « think tanks » ne peuvent pas être considérés, par principe et en l’absence d’intérêt identifié, comme des représentants d’intérêts ». Pour éviter justement d’être pris au piège des « intérêts identifiés », un certain nombre de think tanks mettent en place des codes déontologiques et des chartes éthiques, notamment pour limiter le poids relatif de chacun des contributeurs financiers dans le poids global du budget. En réalité, on observe que certains think tanks introduisent dans leurs pratiques des outils de régulation d’ordre déontologique.
Vous concluez votre livre sur la question de la séparation entre lobbying et think tank avec les mots du cardinal de Retz, “on ne sort de l’ambiguïté qu’à son détriment” …
MP : Oui, je crois qu’il est important de poser les deux questions qui restent au cœur de l’activité des think tanks : celle de leur neutralité politique et celle de leur indépendance financière. Plus les think tanks seront précis et transparents sur cette question, plus il sera aisé d’établir une distinction nette entre think tank et lobbying.
Le lobbying travaille pour un intérêt identifié et il est rémunéré pour des prestations de portage d’intérêts. Inversement, le think tank met à disposition des décideurs publics des travaux d’analyse et des recommandations qui visent l’intérêt général. Reste à savoir si la notion « d’intérêt général » n’est pas une fiction créatrice…comme cela m’a d’ailleurs été confié par le responsable d’un think tank…
Le lobbying travaille pour un intérêt identifié et il est rémunéré pour des prestations de portage d’intérêts. Inversement, le think tank met à disposition des décideurs publics des travaux d’analyse et des recommandations qui visent l’intérêt général. Reste à savoir si la notion « d’intérêt général » n’est pas une fiction créatrice…comme cela m’a d’ailleurs été confié par le responsable d’un think tank…
Au chapitre “La place des think-tanks dans la démocratie”, vous mentionnez un calembour qui circula longtemps aux États-Unis : “Les décideurs se servent des résultats de la recherche appliquée comme les ivrognes des réverbères : pour l’appui qu’ils procurent plus que pour la lumière qu’ils apportent.”
MP : ce mot d’esprit permet de poser la question de l’usage que les décideurs font des travaux du personnel des think tanks que je nomme les « think tankers » : qu’en font-ils dans la réalité ? Utilisent-ils ces recommandations pour réinterroger leurs certitudes ou, au contraire, s’en servent-ils pour renforcer leurs convictions. C’est tout l’enjeu du sort réservé aux productions des think tanks dans le débat public : sont-elles des opportunités pour conduire à une réflexion ouverte et partagée ou constituent-elles des munitions pour réarmer un camp politique ? En tant que chercheur, je pose la question. L’observation montre que la seconde option est plutôt confirmée, et c’est ce qui est à l’origine de ce calembour.
Vous avez été professeur de philosophie durant le début de votre carrière, quel regard portez-vous sur l’existence des think tanks dans nos démocraties ?
MP : Clairement, on assiste au niveau national à une forme de professionnalisation de la recherche de solutions politiques : c’est le sens même de la démocratie qui est donc en voie de mutation. Au-delà de cette professionnalisation de la pensée politique, c’est à une privatisation de cette activité au cœur de la démocratie délibérative à laquelle on assiste.
Lorsque les Grecs de l’Antiquité ont inventé la démocratie, ils partaient du principe que la décision appartenait au peuple…enfin n’oublions pas que le « peuple » n’intégrait ni les femmes, ni les étrangers, ni les esclaves… Aujourd’hui, force est de constater qu’en dehors de l’exécutif et du Parlement, la décision est aussi préparée par des instances de droit privé, et ce, pour une part de plus en plus importante. Les fondamentaux de la décision publique à l’échelle nationale ont donc évolué mais sans que cela ne soit posé sur la table. Nous avons tous à l’esprit la Loi Le Chapelier de 1791 qui, dans l’esprit de la Révolution Française, interdisait les corporations car, justement, elles risquaient - pensait-on - de perturber la construction de la décision.
Aujourd’hui, les think tanks – en se tenant à distance des groupes d’intérêts - enrichissent le débat national par des argumentaires consolidés rationnellement la plupart du temps et contribuent à la reconstruction de l’agora. Dans le même temps, il convient d’interroger la légitimité démocratique des think tankers, ni élus, ni nommés par le pouvoir, et qui peuvent, pour certains, se loger dans une forme de lobbying intellectuel susceptible d’orienter la décision politique.
A la fois, les think tanks permettent de réinventer la politique et de faire de la politique autrement, et en même temps, ils constituent des instances privées et professionnalisées parallèles au circuit officiel. C’est cette ambiguïté qui fait leur richesse et leur fragilité, à l’image de la démocratie qui est à la fois bien installée et qui reste éminemment fragile…
Lorsque les Grecs de l’Antiquité ont inventé la démocratie, ils partaient du principe que la décision appartenait au peuple…enfin n’oublions pas que le « peuple » n’intégrait ni les femmes, ni les étrangers, ni les esclaves… Aujourd’hui, force est de constater qu’en dehors de l’exécutif et du Parlement, la décision est aussi préparée par des instances de droit privé, et ce, pour une part de plus en plus importante. Les fondamentaux de la décision publique à l’échelle nationale ont donc évolué mais sans que cela ne soit posé sur la table. Nous avons tous à l’esprit la Loi Le Chapelier de 1791 qui, dans l’esprit de la Révolution Française, interdisait les corporations car, justement, elles risquaient - pensait-on - de perturber la construction de la décision.
Aujourd’hui, les think tanks – en se tenant à distance des groupes d’intérêts - enrichissent le débat national par des argumentaires consolidés rationnellement la plupart du temps et contribuent à la reconstruction de l’agora. Dans le même temps, il convient d’interroger la légitimité démocratique des think tankers, ni élus, ni nommés par le pouvoir, et qui peuvent, pour certains, se loger dans une forme de lobbying intellectuel susceptible d’orienter la décision politique.
A la fois, les think tanks permettent de réinventer la politique et de faire de la politique autrement, et en même temps, ils constituent des instances privées et professionnalisées parallèles au circuit officiel. C’est cette ambiguïté qui fait leur richesse et leur fragilité, à l’image de la démocratie qui est à la fois bien installée et qui reste éminemment fragile…
Merci Marc Patard d'avoir partagé avec nous vos analyses.
A propos de l'auteur
Marc Patard est un politologue issu de Sciences Po, qui s’est imposé comme une voix éclairante sur le rôle des think tanks dans la vie politique française et internationale.
Son ouvrage de 2025 constitue une synthèse incontournable pour comprendre ces acteurs de l’influence et de l’expertise. Spécialiste des think tanks et des dynamiques d’influence dans la vie politique contemporaine. Il est l’auteur de l’ouvrage Les Think Tanks.

 Accueil
Accueil