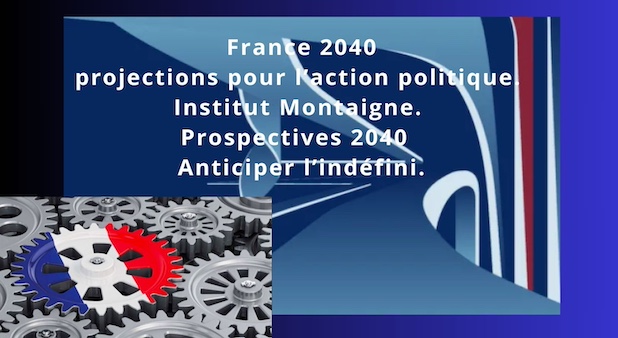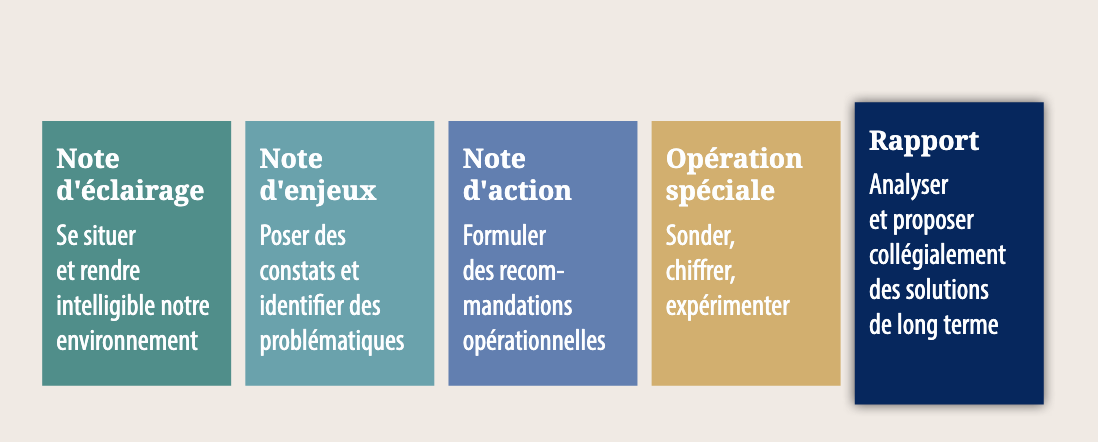Dépasser le rythme des cycles électoraux.
Il met en exergue l’interdépendance grandissante entre les enjeux – qu’il s’agisse de l’allongement de l’espérance de vie, de la transition énergétique, des ruptures technologiques ou des tensions internationales – et plaide pour une gouvernance interministérielle capable de synchroniser durablement décisions et anticipations.
Le rapport de l’Institut Montaigne met d’abord l’accent sur la fin de la gestion en silo, appelant à une orchestration interministérielle qui synchronise les politiques démographique, économique, environnementale, technologique et sécuritaire. Il vise à souligner le coût de l’inaction et à responsabiliser les acteurs publics, en ouvrant le champ du possible pour réconcilier vision à long terme et décisions immédiates
La solution magique n'est pas encore trouvée !
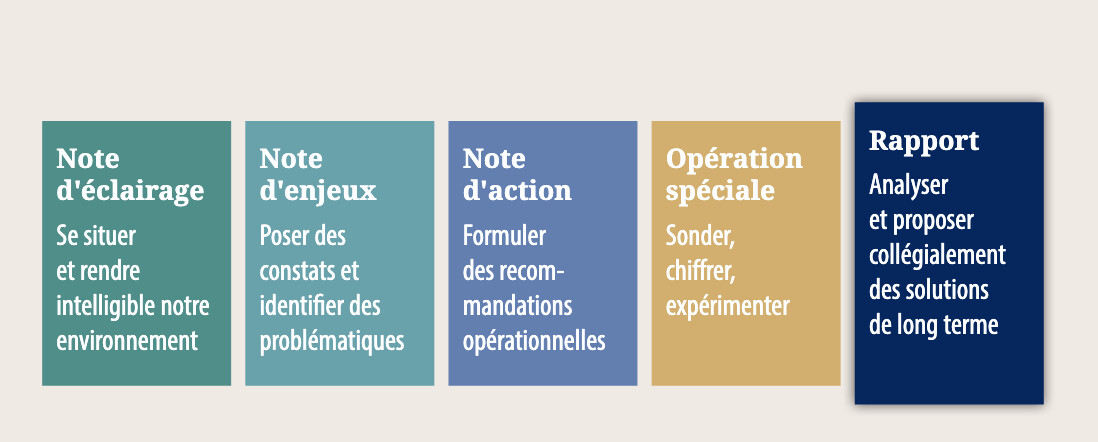
Au cœur de l’étude, cinq trajectoires possibles esquissent autant de visions contrastées de la France en 2040 : la poursuite de l’inaction qui amplifierait les fractures sociales, le repli souverainiste synonyme de désengagement européen, l’adoption de réformes timides confinant au statu quo, la mise en œuvre d’une rupture économique radicale aux conséquences sociales imprévisibles, ou enfin l’option décroissance qui verrait s’affirmer un modèle de vie plus frugal.
Aucun de ces chemins ne garantit, selon les auteurs, une prospérité partagée et résiliente.
Les auteurs rappellent en filigrane que la France doit préserver l’universalité de son modèle social, garantir l’égalité des chances, défendre la liberté d’entreprendre tout en assurant la prospérité collective. Ils insistent aussi sur la nécessité de maintenir la capacité à protéger nos intérêts stratégiques et la souveraineté des décisions publiques, valeurs fondamentales qui doivent orienter toutes les réformes à venir
Mesurer le coût de l'inaction
Il suggère aussi d’enrichir la veille stratégique par des narratifs prospectifs intégrant des indicateurs avancés – ratios de dépendance, émissions de gaz à effet de serre, indices de vulnérabilité territoriale – pour alimenter briefings et recommandations.
Enfin, les auteurs insistent sur l’importance d’un cycle de formation-action pour les décideurs, mêlant méthodes Delphi et simulations de crise, afin de renforcer la résilience sociétale et stimuler l’innovation collective.
Le rapport « France 2040 » n’est pas seulement un diagnostic. Cultiver une culture collective de l’anticipation
C’est un appel à la mobilisation des esprits stratégiques pour transformer l’incertitude en opportunité, repenser le contrat social et ancrer les choix politiques dans une vision à long terme. Face à un monde en rapide mutation, il offre aux professionnels de l’information stratégique une boîte à outils indispensable pour éclairer l’action publique et dessiner, dès aujourd’hui, le visage d’une France prête à relever les défis du siècle.
Le rapport France 2040 se distingue par une ambition rare et une vision à long terme qui invitent à repenser la gouvernance publique hors des cycles électoraux traditionnels. Sa méthode de backcasting et ses indicateurs avancés constituent des leviers solides pour anticiper les risques démographiques, climatiques et géopolitiques.
Cependant, plusieurs points méritent d’être nuancés : la mise en place d’une orchestration interministérielle butera sans doute sur des cloisonnements administratifs et un calendrier politique serré, tandis que le financement des mesures reste esquissé plutôt que détaillé. De plus, l’implication des citoyens et des collectivités territoriales gagnerait à être davantage formalisée pour légitimer les décisions et accélérer l’appropriation locale.
Auteurs
- Bruno Tertrais (coordinateur)
- Erwan Le Brasidec (rédacteur)
L’Institut Montaigne, fondé en 2000 par Claude Bébéar, est un think tank associatif indépendant (loi 1901) qui propose des solutions pour moderniser le modèle français au sein de l’Europe. Il intervient sur la cohésion sociale, les dynamiques économiques, l’efficacité de l’action publique et les coopérations internationales, en intégrant les enjeux technologiques, environnementaux et géopolitiques.
Depuis 2015, Henri de Castries en assure la présidence, Marie-Pierre de Bailliencourt en est la directrice (depuis 2022), et son budget de 7,2 M€ en 2021 repose sur le soutien de plus de 200 entreprises, sans financement public direct.

 Accueil
Accueil