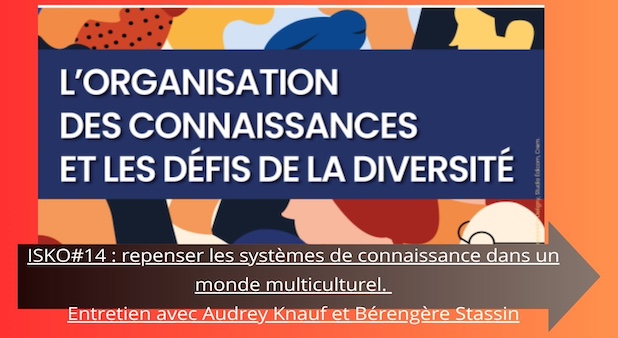La 14ème édition du colloque ISKO-France vient de fermer ses portes et a met en avant “l’organisation des connaissances et les défis de la diversité”. Pourquoi avoir choisi cet angle en 2025, et en quoi répond-il aux enjeux actuels de nos sociétés numériques et multiculturelles ?
Il s’agissait avant tout de s’inscrire dans la continuité du colloque précédent (ISKO-France 13, Lyon, 2023), qui a mis l’accent sur le fait que la production du savoir et l’organisation des connaissances ne sont ni « neutres » ni « universels », mais résultent d’une production socialement et historiquement située, sont façonnés par des structures sociales et épistémologiques.
En 2025, dans des sociétés à la fois numériques et multiculturelles, le défi est double : comprendre comment les technologies façonnent nos accès à la connaissance (à travers l’hyperdocumentation, la standardisation, la marchandisation des données, ou encore la reproduction et l’amplification de certains biais sexistes et racistes provoqués par les algorithmes), et comment y intégrer la pluralité des expériences, des pratiques et des cultures. Le colloque a montré que l’organisation des connaissances ne peut plus se limiter à une logique purement technique et méthodologique, elle doit devenir une pratique éthique et inclusive, au service d’un accès plus juste et partagé à la connaissance
En 2025, dans des sociétés à la fois numériques et multiculturelles, le défi est double : comprendre comment les technologies façonnent nos accès à la connaissance (à travers l’hyperdocumentation, la standardisation, la marchandisation des données, ou encore la reproduction et l’amplification de certains biais sexistes et racistes provoqués par les algorithmes), et comment y intégrer la pluralité des expériences, des pratiques et des cultures. Le colloque a montré que l’organisation des connaissances ne peut plus se limiter à une logique purement technique et méthodologique, elle doit devenir une pratique éthique et inclusive, au service d’un accès plus juste et partagé à la connaissance
Comment les travaux présentés à Isko14 peuvent-ils nourrir concrètement les pratiques des professionnels de l’information, de la veille et de l’intelligence économique ?
Des enseignements très concrets ont été apportés par les chercheurs, invitant à repenser les pratiques professionnelles sous plusieurs angles :
La réflexivité : comme l’a rappelé Olivier Le Deuff, la tentation d’une organisation toujours plus efficiente du savoir peut occulter sa dimension humaine et critique. Pour les veilleurs et analystes, cela signifie questionner les biais dans les sources et les outils, et maintenir une distance critique vis-à-vis des indicateurs produits par les algorithmes de traitement de l’information.
L’intelligence collective : les travaux de Yolande Maury ou d’Eric Lacombe montrent l’importance des espaces partagés, où le savoir se co-construit. Dans une démarche d’intelligence territoriale, cela se traduit par une logique de réseau et de coopération, où les utilisateurs deviennent contributeurs à part entière.
La contextualisation : Akila Nedjar-Guerre et Widad Mustafa El Hadi ont rappelé que tout savoir est situé. Pour les praticiens, cela implique de contextualiser l’information, comprendre d’où elle vient, qui la produit, à quelles logiques de pouvoir elle répond, afin d’éviter les angles morts et des formes d’exclusion ou d’invisibilisation de certains savoirs dans la prise de décision stratégique.
Ces apports renforcent une vision responsable et inclusive de la veille, où organiser la connaissance sert avant tout à donner du sens et un moyen de mieux comprendre et de partager.
La réflexivité : comme l’a rappelé Olivier Le Deuff, la tentation d’une organisation toujours plus efficiente du savoir peut occulter sa dimension humaine et critique. Pour les veilleurs et analystes, cela signifie questionner les biais dans les sources et les outils, et maintenir une distance critique vis-à-vis des indicateurs produits par les algorithmes de traitement de l’information.
L’intelligence collective : les travaux de Yolande Maury ou d’Eric Lacombe montrent l’importance des espaces partagés, où le savoir se co-construit. Dans une démarche d’intelligence territoriale, cela se traduit par une logique de réseau et de coopération, où les utilisateurs deviennent contributeurs à part entière.
La contextualisation : Akila Nedjar-Guerre et Widad Mustafa El Hadi ont rappelé que tout savoir est situé. Pour les praticiens, cela implique de contextualiser l’information, comprendre d’où elle vient, qui la produit, à quelles logiques de pouvoir elle répond, afin d’éviter les angles morts et des formes d’exclusion ou d’invisibilisation de certains savoirs dans la prise de décision stratégique.
Ces apports renforcent une vision responsable et inclusive de la veille, où organiser la connaissance sert avant tout à donner du sens et un moyen de mieux comprendre et de partager.
Les systèmes de classification et d’organisation des connaissances sont souvent perçus comme neutres. En quoi intégrer la diversité et l’inclusion change-t-il la manière de concevoir et d’utiliser ces systèmes ?
Les systèmes de classification et d’organisation des connaissances sont souvent perçus comme neutres, alors qu’ils reposent en réalité sur des choix implicites.
José Augusto Chaves Guimarães a en effet montré qu’ils sont imprégnés de biais, reposant sur des préjugés ou sur des exclusions de certains groupes sociaux, tels que les minorités religieuses, culturelles, sexuelles et de genre. Intégrer la diversité, c’est reconnaître que ces choix traduisent des rapports de pouvoir qui déterminent ce qui est rendu visible ou, au contraire, ce qui est invisibilisé dans les dispositifs d’accès à la connaissance. Ainsi, la mise en place d’une démarche inclusive en bibliothèque ne peut pas se limiter au développement de fonds spécialisés. Elle implique également une évolution des classifications et des langages documentaires : trouver les bons mots clés, éviter les termes stigmatisants ou réducteurs. Mais cette évolution ne peut se faire sans une mise en dialogue entre le savoir info-documentaire et professionnel des bibliothécaires et le savoir situé et communautaire des groupes minorisés ainsi que des associations qui les représentent.
Les interventions d’Akila Nedjar-Guerre et de Widad Mustafa El Hadi ont montré qu’il existe des « violences épistémologiques » : des savoirs minoritaires ou locaux sont exclus ou dévalorisés parce qu’ils ne rentrent pas dans les cadres normatifs des classifications occidentales. Repenser ces cadres, c’est admettre que les taxonomies doivent évoluer vers des modèles plus ouverts.
Dans la pratique, cela implique de concevoir des systèmes multilingues et multiculturels, de documenter les contextes de production des données et métadonnées et d’intégrer des approches collaboratives (comme la folksonomie) qui reflètent la pluralité des représentations du monde.
José Augusto Chaves Guimarães a en effet montré qu’ils sont imprégnés de biais, reposant sur des préjugés ou sur des exclusions de certains groupes sociaux, tels que les minorités religieuses, culturelles, sexuelles et de genre. Intégrer la diversité, c’est reconnaître que ces choix traduisent des rapports de pouvoir qui déterminent ce qui est rendu visible ou, au contraire, ce qui est invisibilisé dans les dispositifs d’accès à la connaissance. Ainsi, la mise en place d’une démarche inclusive en bibliothèque ne peut pas se limiter au développement de fonds spécialisés. Elle implique également une évolution des classifications et des langages documentaires : trouver les bons mots clés, éviter les termes stigmatisants ou réducteurs. Mais cette évolution ne peut se faire sans une mise en dialogue entre le savoir info-documentaire et professionnel des bibliothécaires et le savoir situé et communautaire des groupes minorisés ainsi que des associations qui les représentent.
Les interventions d’Akila Nedjar-Guerre et de Widad Mustafa El Hadi ont montré qu’il existe des « violences épistémologiques » : des savoirs minoritaires ou locaux sont exclus ou dévalorisés parce qu’ils ne rentrent pas dans les cadres normatifs des classifications occidentales. Repenser ces cadres, c’est admettre que les taxonomies doivent évoluer vers des modèles plus ouverts.
Dans la pratique, cela implique de concevoir des systèmes multilingues et multiculturels, de documenter les contextes de production des données et métadonnées et d’intégrer des approches collaboratives (comme la folksonomie) qui reflètent la pluralité des représentations du monde.
- Vous êtes à la fois universitaire et impliquée dans la formation de futurs professionnels (Master VSOC). Comment ce colloque contribue-t-il à rapprocher la recherche académique et les besoins opérationnels des organisations ?
Le colloque ISKO joue un rôle d’interface entre deux mondes : la recherche et la pratique. Pour les étudiants du Master VSOC (Veille Stratégique et Organisation des Connaissances) présents à Metz, ce fut une occasion rare d’assister à un véritable dialogue interdisciplinaire entre chercheurs mais aussi avec des praticiens.
Les étudiants ont pu se rendre compte que la veille et la gestion des connaissances ne sont pas seulement des outils stratégiques, mais aussi des dispositifs de médiation et de compréhension du monde. Le colloque ISKO a mis en lumière la nécessité de penser cette complexité et d’être sensible aux enjeux sociaux et culturels qui traversent notre société
Les étudiants ont pu se rendre compte que la veille et la gestion des connaissances ne sont pas seulement des outils stratégiques, mais aussi des dispositifs de médiation et de compréhension du monde. Le colloque ISKO a mis en lumière la nécessité de penser cette complexité et d’être sensible aux enjeux sociaux et culturels qui traversent notre société
Quelles suites espérez-vous donner à Isko14 ? Peut-on imaginer que ce colloque ouvre la voie à de nouvelles coopérations internationales ou à des projets concrets autour de l’organisation des connaissances ?
Le colloque Isko-France est organisé tous les deux ans. La quinzième édition devrait avoir lieu à l’Université de Strasbourg en 2027, mais pour l’heure la thématique n’est pas encore connue. Cependant, il est certain que cette nouvelle édition continuera d’explorer les enjeux contemporains de l’organisation des connaissances.
Un ouvrage réunissant une sélection des articles issus du colloque sera également publié.
Un ouvrage réunissant une sélection des articles issus du colloque sera également publié.
Peut-être une remarque plus personnelle, une recommandation, un rendez-vous, un ouvrage...

Pour approfondir la réflexion sur les limites et les biais des langages documentaires en bibliothèque, on peut recommander la lecture de l’ouvrage The Power to Name de Hope Olson. Cette chercheuse américaine en Information Science y montre comment les choix de classification et de terminologie dans les bibliothèques influencent la visibilité et l’accès aux connaissances.
À ce jour, cet ouvrage n’existe qu’en anglais, ce qui pourrait représenter une opportunité intéressante pour un projet de traduction destiné à rendre ces idées accessibles à un public francophone. Dans la même lignée, pour réfléchir aux questions de genre en bibliothèque, on peut recommander l’ouvrage collectif Agir pour l’égalité. Questions de genre en bibliothèque, coordonné par Florence Salanouve et publié aux Presses de l’Enssib. Cet ouvrage interroge la manière dont le genre éclaire diverses facettes du métier de bibliothécaire et comment il peut inciter à agir en faveur de l’égalité.
En matière de recommandation, il me semble essentiel de développer au quotidien, une véritable acculturation aux enjeux de l’inclusion, dans la création et la diffusion des contenus informationnels. J’invite notamment vos lecteurs à s’intéresser aux travaux récents de Nathalie Pinède, qui portent sur les problématiques de l’inclusion numérique.
Enfin, dans la continuité des réflexions relatives à la co-création et à l’organisation des connaissances, ainsi qu’à la valorisation des diversités, le champ des communs constitue un terrain d’exploration particulièrement fécond.
À ce jour, cet ouvrage n’existe qu’en anglais, ce qui pourrait représenter une opportunité intéressante pour un projet de traduction destiné à rendre ces idées accessibles à un public francophone. Dans la même lignée, pour réfléchir aux questions de genre en bibliothèque, on peut recommander l’ouvrage collectif Agir pour l’égalité. Questions de genre en bibliothèque, coordonné par Florence Salanouve et publié aux Presses de l’Enssib. Cet ouvrage interroge la manière dont le genre éclaire diverses facettes du métier de bibliothécaire et comment il peut inciter à agir en faveur de l’égalité.
En matière de recommandation, il me semble essentiel de développer au quotidien, une véritable acculturation aux enjeux de l’inclusion, dans la création et la diffusion des contenus informationnels. J’invite notamment vos lecteurs à s’intéresser aux travaux récents de Nathalie Pinède, qui portent sur les problématiques de l’inclusion numérique.
Enfin, dans la continuité des réflexions relatives à la co-création et à l’organisation des connaissances, ainsi qu’à la valorisation des diversités, le champ des communs constitue un terrain d’exploration particulièrement fécond.
Références :
- Olson, H. A. (2002). The Power to Name: Locating the Limits of Subject Representation in Libraries. Berlin : Springer.
- Salanouve, F. (dir.). (2021). Agir pour l’égalité. Questions de genre en bibliothèque. Villeurbanne : Presses de l’Enssib.
A propos de ....
Propos recueillis auprès de Bérengère Stassin et de Audrey Knauf, maitresses de conférences en sciences de l'information et de la communication à l’université de Lorraine, chercheuse au Crem et co-responsables scientifiques du colloque ISKO 14.

 Accueil
Accueil