Un cadre ultra-libéral propice à une expansion massive
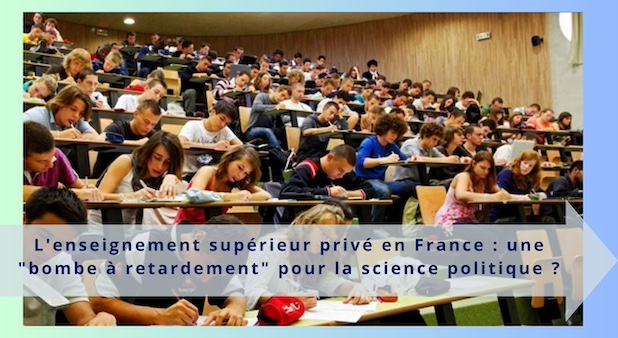
L'expansion du secteur privé dans l'enseignement supérieur français est sans précédent (source https://www.afsp.info/) .
La part des étudiants inscrits dans le privé a bondi de 14 % en 1998 à plus de 26 % en 2023, atteignant près de 790 000 étudiants. Cette progression s'est accélérée depuis 2013, avec une augmentation de +62,7 % des inscriptions dans le privé, contre seulement +9,6 % dans le public.
Ce dynamisme est favorisé par un cadre juridique "ultra-libéral" hérité de la loi Laboulaye de 1875, qui consacre la liberté de l'enseignement supérieur. L'ouverture d'un établissement privé ne requiert qu'une simple déclaration administrative, sans accréditation académique préalable, la seule contrainte étant l'interdiction d'utiliser l'appellation "université".
Un facteur clé de cette accélération est la loi Pénicaud de 2018, qui a "libéralisé l'apprentissage" et ouvert l'accès des écoles privées à des financements publics massifs via les Centres de Formation d'Apprentis (CFA). Entre 2018 et 2022, on estime qu'environ 40 milliards d'euros de fonds publics ont été alloués aux établissements privés, principalement via l'alternance.
En 2022, l'apprentissage a coûté 25 milliards d'euros aux finances publiques, "soit davantage que le budget de toutes les universités publiques réunies", avec 80% des apprentis du supérieur inscrits dans le privé. Ce financement indirect d'un marché éducatif concurrent est qualifié de "paradoxe".
Les modèles économiques et leurs "dérives systémiques"
La croissance du secteur privé est principalement portée par le "nouvel enseignement supérieur privé" à but lucratif, qui scolarise environ 450 000 étudiants en 2025. Trois modèles d'organisation dominent :
La part des étudiants inscrits dans le privé a bondi de 14 % en 1998 à plus de 26 % en 2023, atteignant près de 790 000 étudiants. Cette progression s'est accélérée depuis 2013, avec une augmentation de +62,7 % des inscriptions dans le privé, contre seulement +9,6 % dans le public.
Ce dynamisme est favorisé par un cadre juridique "ultra-libéral" hérité de la loi Laboulaye de 1875, qui consacre la liberté de l'enseignement supérieur. L'ouverture d'un établissement privé ne requiert qu'une simple déclaration administrative, sans accréditation académique préalable, la seule contrainte étant l'interdiction d'utiliser l'appellation "université".
Un facteur clé de cette accélération est la loi Pénicaud de 2018, qui a "libéralisé l'apprentissage" et ouvert l'accès des écoles privées à des financements publics massifs via les Centres de Formation d'Apprentis (CFA). Entre 2018 et 2022, on estime qu'environ 40 milliards d'euros de fonds publics ont été alloués aux établissements privés, principalement via l'alternance.
En 2022, l'apprentissage a coûté 25 milliards d'euros aux finances publiques, "soit davantage que le budget de toutes les universités publiques réunies", avec 80% des apprentis du supérieur inscrits dans le privé. Ce financement indirect d'un marché éducatif concurrent est qualifié de "paradoxe".
Les modèles économiques et leurs "dérives systémiques"
La croissance du secteur privé est principalement portée par le "nouvel enseignement supérieur privé" à but lucratif, qui scolarise environ 450 000 étudiants en 2025. Trois modèles d'organisation dominent :
- Les écoles indépendantes, souvent de petites structures "artisanales".
- Les groupes familiaux historiques, comme IONIS (30 000 étudiants).
- Les groupes financés par des fonds d'investissement (private equity), modèle "désormais prépondérant". Ces groupes fonctionnent par LBO (leverage buy-out), endettant les écoles rachetées pour financer leur expansion et misant sur une plus-value à la revente sous 5 à 7 ans. Ce modèle exige une "croissance continue des effectifs", ce qui "explique en partie l'agressivité du marketing et le foisonnement d'offres". Des conglomérats comme Galileo Global Education revendiquent 200 000 étudiants dans plus de 60 écoles et sont devenus de "véritables multinationales de l'enseignement supérieur".
Ces modèles engendrent des "dérives systémiques", notamment des "publicités mensongères, informations opaques ou trompeuses sur la reconnaissance des diplômes, programmes académiques au rabais, [et un] encadrement pédagogique instable". Un exemple frappant est celui d'une école de Galileo entassant "400 élèves dans un bâtiment prévu pour 300", avec un cynisme flagrant de la part du personnel.
La science politique, un "gisement de profit"
Bien que numériquement modeste, le secteur privé en science politique est en forte croissance et "hautement symbolique". En 2023, on estimait à 10 000 le nombre d'étudiants inscrits en science politique dans le privé, dont la moitié dans des écoles à but lucratif. Cette discipline attire les opérateurs privés pour plusieurs raisons :
- L'attractivité étudiante : les formations "sciences po" jouissent d'un "prestige diffus" auprès des lycéens, nourri par la réputation des IEP et l'attrait pour les carrières internationales, diplomatiques, politiques ou médiatiques.
- La sélectivité dans le public : alimente une "demande non satisfaite" de bacheliers n'ayant pas accès aux filières publiques sélectives.
- Le coût de production faible : ouvrir une formation en science politique ne requiert "ni équipements coûteux ni équipements techniques lourds". Un cadre du secteur a ironiquement confié : "la science po, c'est pas cher à produire et ça fait rêver, c'est le nouvel eldorado".
Quatre catégories d'acteurs privés opèrent dans ce domaine :
- Les extensions de grandes écoles de commerce (ex: HEC, ESSEC), développant des programmes de science politique de niveau master, souvent bien accrédités.
- Les écoles "caméléon" dans des groupes multi-filières (ex: OMNES/Inseec, Galileo), qui ouvrent des offres opportunistes, très professionnalisantes et souvent en misant sur l'apprentissage.
- Les écoles revendiquant la science politique comme spécialité (ex: ILERI, HEIP), qui se positionnent comme "l'équivalent privé des IEP" et utilisent des intitulés de diplômes trompeusement familiers ("licence", "bachelor of Arts", "master of Science").
- Les écoles à projet politique ou idéologique (ex: ISSEP de Marion Maréchal, École 18.06), créées pour former des étudiants selon des valeurs spécifiques (patriotiques, souverainistes, ultra-conservatrices), soulevant des questions de "pluralisme académique et de risques de propagande".
Le flou des diplômes et les stratégies de captation
La plupart des établissements privés lucratifs, notamment en science politique, adoptent une "stratégie de légitimation par mimétisme et distanciation du public". Ne délivrant pas de diplômes nationaux (licence, master), ils s'appuient sur :
- Le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), géré par le ministère du Travail, permettant d'afficher "reconnu par l'État" sans garantir une reconnaissance académique équivalente à un diplôme universitaire. Un titre RNCP ne confère pas les mêmes droits qu'un diplôme national (pas d'accès automatique aux concours administratifs, aux bourses CROUS, ni à la poursuite d'études facilitée).
- L'usage de termes anglo-saxons (bachelor, BBA, mastère, MBA, MSc) et l'usurpation de termes protégés (comme "licence" ou "Doctorate") en infraction avec le Code de l'Éducation, créant un "flou délibéré".
Le résultat de cette "asymétrie d'information" est édifiant : 42 % des lycéens pensent qu'un bachelor privé est un diplôme d'État et 60 % croient qu'un "mastère" privé équivaut à un master universitaire.
Les stratégies de recrutement sont "particulièrement offensives":
- Marketing tous azimuts : stands omniprésents, référencement agressif sur Internet, campagnes sur les réseaux sociaux avec des "étudiants ambassadeurs" vantant une vie de campus "fun et glamour".
- Rhétorique anti-Parcoursup et anti-fac : le privé se positionne comme une "alternative rassurante" face au "stress organisé" de Parcoursup, promettant "pas de sélection impitoyable ni d'attente angoissante, on vous accepte" (sous-entendu "tant que votre chèque est bon"). Les universités sont caricaturées comme "trop théoriques, trop générales, pas professionnalisantes, surchargées en amphi, avec grèves et cours annulées".
- Surreprésentation dans les salons d'orientation, où ils occupent le terrain avec des stands professionnels et du personnel commercial.
- Ciblage de publics spécifiques : les "Inès" (milieu aisé, résultats moyens, cherchant un diplôme "professionnalisant"), les "Solène" (brillantes, milieu modeste, attirées par l'alternance rémunérée, risquant un "plafond de verre"), et les "Enzo" (échec dans le public, cherchant une réorientation, souvent trompés sur la valeur du diplôme). La promesse de "réussite facilitée" est souvent une "fausse promesse", conduisant à la "désillusion de milliers d'étudiants captifs" et potentiellement à l'endettement.
Une régulation passive et des enjeux démocratiques majeurs
Un trait structurel de ces écoles est l'"extrême instabilité de leurs équipes pédagogiques", fonctionnant majoritairement avec des vacataires "sans possibilité de participer à la conception des programmes". Cette "externalisation de la pédagogie" minimise les coûts mais fragilise la transmission disciplinaire, aboutissant à de "la science politique sans science politique".
Face à ces dérives, la régulation des pouvoirs publics a été "longtemps" passive, oscillant entre "laissez-faire (voire la complaisance) et quelques coups de boutoir ponctuels". Le ministère de l'Enseignement supérieur (MESR) a fait preuve d'une "inertie et non-décision" historique. Le RNCP est le "principal (et quasi seul) filtre", mais ses critères portent sur l'employabilité et non les contenus académiques. Un projet de nouvel agrément par le MESR en 2023-2024 est "flou" et suscite le "scepticisme", risquant d'ajouter à la confusion des labels.
Le développement du secteur privé lucratif en science politique soulève des questions "cruciales" qui touchent aux "fondements socio-politiques de la formation des futurs citoyens":
- Logique marchande vs. Logique académique et civique : la science politique, visant l'étude critique du politique, est transformée en "produit commercial formaté par des impératifs de rentabilité". Le "market model produit des techniciens du politique, là où l'université cherche à former des esprits libres et éclairés", posant un "enjeu démocratique".
- Contradictions de l'État : l'État, tout en défendant le diplôme national, "alimente de fait la croissance du privé" par ses décisions budgétaires et législatives.
Les risques à long terme sont considérables:
- Affaiblissement du diplôme national et dilution de la lisibilité des qualifications.
- Vulnérabilité structurelle du modèle économique LBO : l'exigence de croissance continue des effectifs est insoutenable à long terme, notamment avec la baisse démographique des bacheliers prévue après 2030. Un "effondrement en chaîne – faillite de groupes, fermeture d'écoles, étudiants abandonnés en cours de cursus – ne relève plus de la science-fiction".
- Reproduction des inégalités et endettement des étudiants.
- Risque politique de "formatage idéologique" : la prolifération d'écoles privées "hors contrôle" peut ouvrir la voie à des "entreprises de formatage idéologique". La domination de l'idéologie managériale privilégie les compétences immédiates au détriment de la "réflexion critique ou fondamentale", ce qui est "toute la différence entre former des citoyens et former des exécutants".
En conclusion,
L'essor du privé est qualifié de "bombe à retardement". À court terme, il semble répondre à des intérêts divers, mais à long terme, les "coûts cachés risquent d'émerger : désillusion de milliers d'étudiants captifs, bulle éducative qui explosera quand la croissance ne sera plus au rendez-vous". Une "réaction forte et réfléchie s'impose" pour préserver la crédibilité des diplômes, l'égalité des chances et la vitalité intellectuelle. Faute de quoi, "on continuera d'abandonner une partie de la jeunesse aux sirènes d'un miroir aux alouettes académique, qui brille beaucoup pour finalement éclairer bien peu".

 Accueil
Accueil

