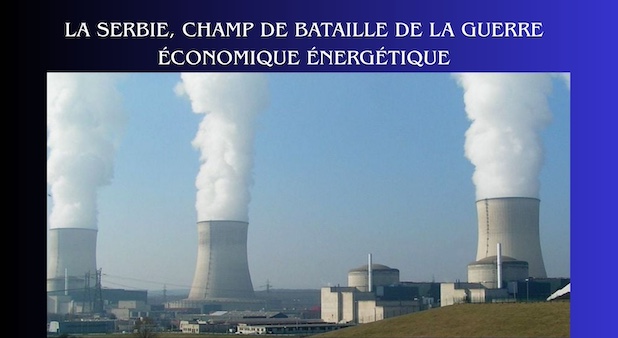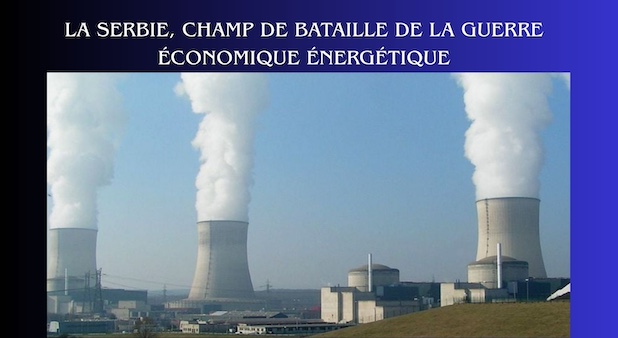
Redéfinir les rapports de force économiques et politiques dans les Balkans.
Les sanctions comme armes de guerre économique
Le 9 octobre, les États-Unis ont déclenché une offensive silencieuse mais redoutable : en ciblant NIS, société à capitaux majoritairement russes, Washington frappe directement l'un des derniers bastions énergétiques de Moscou en Europe. Ce geste stratégique s'est immédiatement traduit par la coupure des livraisons via l'oléoduc JANAF (Jadranski Naftovod), aussi appelé oléoduc Adria, et il traverse la Croatie pour alimenter la raffinerie serbe de Pančevo.en Croatie, menaçant de paralyser la seule raffinerie serbe.
Dans le vocabulaire de la guerre économique, il s'agit d'une attaque ciblée sur une ressource stratégique — en l'occurrence, l'énergie — dans le but d'affaiblir un maillon économique clé d'un adversaire ou d'un État partenaire jugé instable. Les États-Unis ne frappent pas seulement la Russie : ils exercent une pression directe sur Belgrade, l'obligeant à choisir entre dépendance énergétique et alignement politique
Patriottisme économique et dépendance stratégique
La crise met en lumière une asymétrie classique décrite par Christian Harbulot : lorsqu'un État n'a pas construit de patriotisme économique solide autour de ses infrastructures stratégiques, il devient vulnérable aux manœuvres extérieures. La Serbie dépend à 90 % de la Russie pour son approvisionnement en gaz et tire près de 12 % de ses recettes fiscales de NIS. Cette dépendance n'est pas neutre : elle constitue un levier de puissance exploitable par d'autres acteurs, qu'il s'agisse de Moscou ou de Washington.
En frappant cette dépendance, les États-Unis créent une brèche dans la souveraineté économique serbe. Ce type de manœuvre correspond à une guerre de position typique des stratégies économiques contemporaines : au lieu d'attaquer militairement, on coupe l'accès aux flux, on bloque les ressources, on rend le partenaire instable dépendant d'un choix forcé.
L'Europe comme terrain d'influence économique
La guerre économique moderne repose sur l'usage coordonné d'outils économiques, médiatiques et symboliques. Le cas serbe illustre parfaitement cette approche :
- Sanctions économiques : instrument principal de pression sur les ressources énergétiques.
- Infrastructures stratégiques : transformation des oléoducs en leviers géopolitiques.
- Pression diplomatique : forcer Belgrade à s'éloigner de Moscou sous couvert de choix économique.
- Narratif politique : valoriser la "liberté énergétique" comme élément de sécurité nationale européenne.
Cette stratégie s'appuie sur des mécanismes bien connus dans la doctrine de guerre économique : privation ciblée, isolement stratégique, renforcement de dépendances alternatives et normalisation politique.
La bataille pour le contrôle des flux
L'énergie est aujourd'hui au cœur des conflits géoéconomiques mondiaux.
Les flux pétroliers et gaziers déterminent non seulement la prospérité d'un pays, mais aussi sa capacité à résister aux pressions extérieures. En coupant l'accès de la Serbie au brut russe, Washington ne cherche pas simplement à affaiblir Moscou : il redessine les routes énergétiques régionales et impose une hiérarchie des dépendances.
Les alternatives évoquées par Belgrade — barges sur le Danube, transport ferroviaire ou routier — ne suffisent pas à compenser la perte de JANAF. L'offre croate de racheter NIS ajoute une dimension offensive à la manœuvre : elle vise à retirer une ressource stratégique à la sphère d'influence russe pour la replacer sous contrôle occidental.
Une manœuvre typique de guerre économique
Ce qui se joue ici relève moins de la logique du marché que d'une logique de puissance. Les sanctions ne sont pas une simple réaction juridique, mais une action planifiée dans une guerre économique structurée :
- Priver un acteur d'un actif stratégique.
- L'obliger à réorganiser en urgence son modèle énergétique.
- Forcer un réalignement politique sous contrainte économique.
Ce scénario correspond exactement à la notion de "guerre économique offensive" décrite par Christian Harbulot : l'usage de moyens économiques pour imposer des décisions politiques majeures à un État tiers.
Une guerre sans canons mais pas sans vainqueurs
Derrière la façade technique des sanctions, se cache un affrontement stratégique à haute intensité. La Russie risque de perdre l'un de ses derniers leviers énergétiques en Europe. Les États-Unis et leurs alliés consolident leur influence dans une zone historiquement sensible. Quant à la Serbie, elle se retrouve face à une décision existentielle : défendre une souveraineté économique déjà fragilisée ou s'aligner sur l'architecture énergétique occidentale.
Dans le langage de la guerre économique, c'est une bataille de contrôle des dépendances, et non un simple différend commercial. Ce type de conflit silencieux mais déterminant dessine les contours des rapports de force de demain — bien au-delà de la seule question énergétique.
A propos de ...
Giuseppe Gagliano a fondé en 2011 le réseau international Cestudec (Centre d'études stratégiques Carlo de Cristoforis), basé à Côme (Italie), dans le but d'étudier, dans une perspective réaliste, les dynamiques conflictuelles des relations internationales. Ce réseau met l'accent sur la dimension de l'intelligence et de la géopolitique, en s'inspirant des réflexions de Christian Harbulot, fondateur et directeur de l'École de Guerre Économique (EGE). Il collabore avec le Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R) (Lien),https://cf2r.org/le-cf2r/gouvernance-du-cf2r/ et avec l'Université de Calabre dans le cadre du Master en Intelligence, et avec l'Iassp de Milan (Lien).https://www.iassp.org/team_master/giuseppe-gagliano/
La responsabilité de la publication incombe exclusivement aux auteurs individuels

 Accueil
Accueil