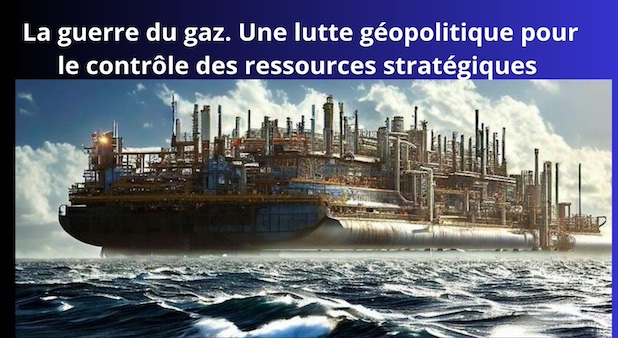
Un instrument de pouvoir et d'influence
Gazprom, le géant russe de l'énergie, ne s'est pas limité à vendre du gaz : il a tissé un réseau de dépendances qui lie les économies européennes aux pipelines venus de Sibérie. Cette dépendance a permis au Kremlin de peser dans les décisions politiques de pays comme l'Allemagne, l'Italie et la Hongrie.
Le projet Nord Stream 2 en est l'exemple le plus emblématique : une infrastructure qui devait doubler les flux de gaz vers l'Europe occidentale, mais qui s'est heurtée à une opposition farouche de Washington.
USA : affaiblir la position russe et verrouiller l'Europe
Mais cette offre cache des objectifs économiques et politiques clairs : affaiblir la position russe et verrouiller l'Europe dans une relation de dépendance avec les producteurs d'outre-Atlantique.
Au bord du blackout énergétique
Les sanctions imposées à la Russie ont contraint les Européens à se détourner rapidement du gaz russe, au prix d'une augmentation dramatique des prix de l'énergie. Dans le même temps, les exportations de GNL américain ont explosé, consolidant la position de Washington comme fournisseur alternatif.
Pourtant, cette transition est loin d'être indolore : les infrastructures européennes ne sont pas entièrement adaptées pour recevoir et stocker le GNL, et certains pays, comme l'Allemagne, ont dû accélérer des projets de terminaux flottants pour éviter un blackout énergétique.
Europe : retrouver une rélle et nouvelle autonomie stratégique.
Derrière la rhétorique des valeurs et de la liberté énergétique, une réalité s'impose : l'Europe n'est pas en train de se libérer de la dépendance, elle en change simplement la nature et l'origine. De l'Est, elle passe à l'Ouest. Mais à quel prix ? Les tensions sociales dues à l'explosion des factures énergétiques et les incertitudes industrielles montrent qu'un rééquilibrage énergétique ne peut être improvisé sans conséquences.
Dans ce contexte, il est évident que la guerre du gaz n'est pas un épisode ponctuel mais une bataille stratégique qui redéfinit l'ordre mondial. La maîtrise des flux énergétiques restera un facteur déterminant pour l'hégémonie globale, et l'Europe, prise en étau entre Moscou et Washington, devra tôt ou tard repenser son modèle pour retrouver une réelle autonomie stratégique.
A propos de Giuseppe Gagliano
Giuseppe Gagliano a fondé en 2011 le réseau international Cestudec (Centre d'études stratégiques Carlo de Cristoforis), basé à Côme (Italie), dans le but d'étudier, dans une perspective réaliste, les dynamiques conflictuelles des relations internationales. Ce réseau met l'accent sur la dimension de l'intelligence et de la géopolitique, en s'inspirant des réflexions de Christian Harbulot, fondateur et directeur de l'École de Guerre Économique (EGE).
Il collabore avec le Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R) (Lien),https://cf2r.org/le-cf2r/gouvernance-du-cf2r/ et avec l'Université de Calabre dans le cadre du Master en Intelligence, et avec l'Iassp de Milan (Lien).https://www.iassp.org/team_master/giuseppe-gagliano/
La responsabilité de la publication incombe exclusivement aux auteurs individuels.
Notes de la Rédaction. Redessiner l’avenir énergétique de la France : alliances, défis, contraintes

À mesure que la Commission européenne avance vers l’abandon des importations russes d’hydrocarbures d’ici 2027, la France s’attelle à une transformation énergétique qui, bien qu’ambitieuse, soulève des questions stratégiques majeures. Car se libérer d’une dépendance ne garantit pas pour autant une souveraineté véritable — surtout lorsque les nouvelles alliances, notamment avec Washington, réinstaurent d’autres formes de contraintes.
Dans l’urgence, Paris a multiplié les manœuvres techniques : le réseau de terminaux de regazéification permet une diversification rapide des sources de GNL, avec une hausse spectaculaire de 81 % des importations entre 2023 et 2024. Mais cette flexibilité cache un paradoxe. En misant massivement sur le gaz américain, la France s’expose aux fluctuations des prix sur les marchés mondiaux, à la pression des intérêts industriels outre-Atlantique et à la politique commerciale agressive de Washington, peu encline à envisager des concessions stratégiques pour ses partenaires européens.
La diplomatie énergétique, présentée comme le pilier d’une autonomie retrouvée, se heurte elle aussi à des limites. Si les relations avec l’Algérie, le Qatar ou l’Asie centrale offrent des perspectives intéressantes, la dépendance envers des régimes parfois instables ou peu transparents interroge sur la capacité réelle de sécurisation des flux. Quant aux partenariats transatlantiques, ils s’inscrivent dans un rapport de force déséquilibré, où les États-Unis dictent les termes commerciaux sans nécessairement tenir compte des impératifs de transition écologique européens.
Face à ces incertitudes, la transition énergétique interne — biométhane, hydrogène vert, électrification industrielle — peine à accélérer au rythme nécessaire. La Programmation pluriannuelle de l’énergie reste contrainte par des obstacles financiers, un déficit d’infrastructures adaptées, et une coordination insuffisante entre niveaux local, national et européen.
Enfin, la mutualisation européenne, si prometteuse sur le papier, semble incomplète dans sa mise en œuvre. L’achat groupé de gaz, le renforcement des stocks et le développement des interconnexions butent sur les divergences d’intérêts nationaux, le manque de volonté politique commune et l’absence d’un véritable leadership énergétique au sein de l’Union.
Ce tournant énergétique exige donc plus qu’un repositionnement technique ou une diplomatie opportuniste : il appelle une stratégie cohérente, émancipée des dépendances géopolitiques classiques et capable de construire une autonomie structurée sur le long terme. Pour les professionnels de l’information stratégique, l’enjeu est de scruter ce virage non pas à travers le prisme de la résilience proclamée, mais à celui des vulnérabilités ignorées — car le récit de l’indépendance ne doit pas masquer les lignes de fracture persistantes.

 Accueil
Accueil

