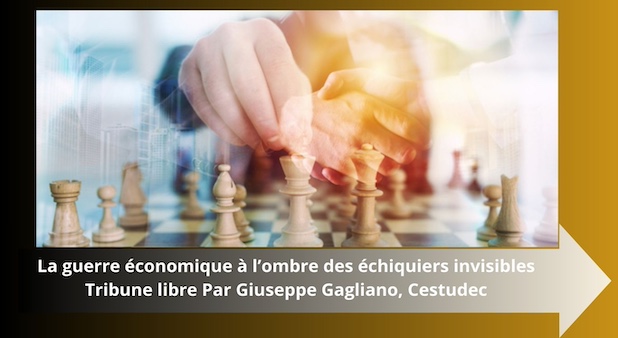Loin des projecteurs médiatiques, cette guerre économique mobilise des stratégies d’influence, des réseaux camouflés et une maîtrise de l’information qui échappent souvent aux regards. Christian Harbulot, avec sa rigueur habituelle, décortique les dynamiques historiques et contemporaines de cette guerre, tout en pointant les failles d’une Europe et d’une France encore à la traîne dans l’art du renseignement économique.
L’histoire est un guide précieux.
Dès le XIXe siècle, les conquêtes commerciales supplantent les ambitions territoriales.
L’Allemagne de Bismarck, en quête d’une place mondiale, mobilise ses acteurs économiques dans une logique géostratégique, tandis que le Japon de l’ère Meiji industrialise à marche forcée pour échapper à la colonisation occidentale.
Ces deux nations, vaincues en 1945, transforment leur énergie militaire en puissance économique, non pas par simple reconversion, mais parce que leur culture offensive était déjà ancrée. Ce n’est pas un hasard si, aujourd’hui, elles rivalisent avec les États-Unis sur l’échiquier économique.
"Leur succès ne repose pas sur un « laissez-faire » économique, mais sur une mobilisation collective, où l’État, les entreprises et les réseaux d’information s’entrelacent dans une stratégie concertée."
L’Allemagne de Bismarck, en quête d’une place mondiale, mobilise ses acteurs économiques dans une logique géostratégique, tandis que le Japon de l’ère Meiji industrialise à marche forcée pour échapper à la colonisation occidentale.
Ces deux nations, vaincues en 1945, transforment leur énergie militaire en puissance économique, non pas par simple reconversion, mais parce que leur culture offensive était déjà ancrée. Ce n’est pas un hasard si, aujourd’hui, elles rivalisent avec les États-Unis sur l’échiquier économique.
"Leur succès ne repose pas sur un « laissez-faire » économique, mais sur une mobilisation collective, où l’État, les entreprises et les réseaux d’information s’entrelacent dans une stratégie concertée."
Mais qu’est-ce qu’un échiquier invisible ?
C’est là que réside le cœur de la réflexion.
Ces arènes, où se jouent des affrontements économiques, échappent aux doctrines officielles des conflits. L'auteur cite le discours de Bill Clinton sur la sécurité économique, qui place les intérêts économiques américains au centre de la politique étrangère. Ce positionnement, peu relayé en France, révèle l’existence de rapports de force économiques tus dans les relations internationales.
Pourtant, la France, prisonnière d’une vision idéalisée du libre marché, peine à reconnaître ces dynamiques. Pourquoi ce silence ?
Il y voit l’emprise d’un discours dominant, qui présente la loi du marché comme une vérité universelle, divisant le monde en «bons» (ceux qui respectent les règles) et « méchants » (ceux qui les contournent). Cette dichotomie, simpliste, masque les manœuvres des puissances anglo-saxonnes, dont les cabinets d’audit, de conseil et de notation influencent les marchés mondiaux, souvent au service d’intérêts nationaux déguisés.
Ces arènes, où se jouent des affrontements économiques, échappent aux doctrines officielles des conflits. L'auteur cite le discours de Bill Clinton sur la sécurité économique, qui place les intérêts économiques américains au centre de la politique étrangère. Ce positionnement, peu relayé en France, révèle l’existence de rapports de force économiques tus dans les relations internationales.
Pourtant, la France, prisonnière d’une vision idéalisée du libre marché, peine à reconnaître ces dynamiques. Pourquoi ce silence ?
Il y voit l’emprise d’un discours dominant, qui présente la loi du marché comme une vérité universelle, divisant le monde en «bons» (ceux qui respectent les règles) et « méchants » (ceux qui les contournent). Cette dichotomie, simpliste, masque les manœuvres des puissances anglo-saxonnes, dont les cabinets d’audit, de conseil et de notation influencent les marchés mondiaux, souvent au service d’intérêts nationaux déguisés.
Le camouflage est l’arme des maîtres de cette guerre.
Comment les grandes puissances – États-Unis, Japon, Allemagne – orchestrent-elles leurs offensives ?
Les Américains adaptent des concepts militaires comme le C4I (Command, Control, Communication, Intelligence) au secteur privé.
Les Japonais s’appuient sur des réseaux hérités de l’ère Meiji, mêlant État, conglomérats et même yakuzas.
Les Allemands, eux, misent sur des fondations et instituts techniques, financés par les Länder et les entreprises, où d’anciens agents du BND se recyclent.
Ces dispositifs, souvent opaques, collectent une information majoritairement ouverte, mais c’est son exploitation stratégique qui fait la différence. Des tactiques subtiles sont mises en place : pressions diplomatiques pour décrocher un contrat, entrisme dans des organisations humanitaires pour prospecter des marchés, ou encore manipulation des normes pour dominer un secteur. L’exemple de M. Wenger, ce président d’université bavaroise qui dénonce les connivences au sein de l’économie allemande, illustre la sensibilité de ces rouages : sa croisade pour les petits actionnaires est perçue comme une menace nationale.
Les Américains adaptent des concepts militaires comme le C4I (Command, Control, Communication, Intelligence) au secteur privé.
Les Japonais s’appuient sur des réseaux hérités de l’ère Meiji, mêlant État, conglomérats et même yakuzas.
Les Allemands, eux, misent sur des fondations et instituts techniques, financés par les Länder et les entreprises, où d’anciens agents du BND se recyclent.
Ces dispositifs, souvent opaques, collectent une information majoritairement ouverte, mais c’est son exploitation stratégique qui fait la différence. Des tactiques subtiles sont mises en place : pressions diplomatiques pour décrocher un contrat, entrisme dans des organisations humanitaires pour prospecter des marchés, ou encore manipulation des normes pour dominer un secteur. L’exemple de M. Wenger, ce président d’université bavaroise qui dénonce les connivences au sein de l’économie allemande, illustre la sensibilité de ces rouages : sa croisade pour les petits actionnaires est perçue comme une menace nationale.
Face à cette guerre de l’ombre, l’Europe apparaît comme un terrain de jeu pour les géants américain et asiatique
Christian Harbulot déplore l’incapacité des Européens à s’organiser. Les rivalités franco-allemandes, héritées d’une histoire conflictuelle, freinent toute synergie.
Les Allemands excellent dans l’influence normative, comme lorsqu’ils imposent leurs standards pour les bornes de recharge électrique.
Les Français, eux, protègent jalousement leurs bastions, comme chez Airbus.
Ce manque de cohésion pénalise l’Union européenne, incapable de contrer les lobbies extra-européens ou la montée de l’illégalité économique. Pourtant, une lueur d’espoir émerge en 1994, lorsque la Commission européenne adopte le concept français d’intelligence économique. Une chance apparaît : structurer les échanges d’information, discipliner les États membres, et bâtir une politique économique commune. Mais cette ambition reste embryonnaire, entravée par des divergences politiques et culturelles.
Les Allemands excellent dans l’influence normative, comme lorsqu’ils imposent leurs standards pour les bornes de recharge électrique.
Les Français, eux, protègent jalousement leurs bastions, comme chez Airbus.
Ce manque de cohésion pénalise l’Union européenne, incapable de contrer les lobbies extra-européens ou la montée de l’illégalité économique. Pourtant, une lueur d’espoir émerge en 1994, lorsque la Commission européenne adopte le concept français d’intelligence économique. Une chance apparaît : structurer les échanges d’information, discipliner les États membres, et bâtir une politique économique commune. Mais cette ambition reste embryonnaire, entravée par des divergences politiques et culturelles.
Le renseignement, au cœur de cette guerre, doit lui aussi évoluer.
Trois mutations nécessaires sont identifiées.
D’abord, les politiques doivent intégrer le renseignement dans leurs décisions, abandonnant l’intuition pour une analyse informée des multiples échiquiers (géopolitique, économique, culturel).
Ensuite, les élites intellectuelles doivent dépasser la dichotomie entre connaissance (associée au progrès) et renseignement (lié à la raison d’État). L’exemple du test du SIDA, où la France gagne une victoire morale mais perd le bénéfice financier face aux Américains, illustre cruellement ce décalage.
Enfin, les services de renseignement doivent se réinventer : gérer l’explosion de l’information, privilégier les sources ouvertes, et collaborer avec le privé. L'auteur cite Robert Steele, qui prône un renseignement plus transversal et déclassifié, une idée jugée hérétique par les tenants du secret.
D’abord, les politiques doivent intégrer le renseignement dans leurs décisions, abandonnant l’intuition pour une analyse informée des multiples échiquiers (géopolitique, économique, culturel).
Ensuite, les élites intellectuelles doivent dépasser la dichotomie entre connaissance (associée au progrès) et renseignement (lié à la raison d’État). L’exemple du test du SIDA, où la France gagne une victoire morale mais perd le bénéfice financier face aux Américains, illustre cruellement ce décalage.
Enfin, les services de renseignement doivent se réinventer : gérer l’explosion de l’information, privilégier les sources ouvertes, et collaborer avec le privé. L'auteur cite Robert Steele, qui prône un renseignement plus transversal et déclassifié, une idée jugée hérétique par les tenants du secret.
La France, en particulier, souffre d’un retard culturel.
Ses institutions, cloisonnées et marquées par une culture régalienne, peinent à s’adapter à la guerre de l’information.
Les décideurs, formés à la gestion mesurable, négligent les affrontements indirects.
Christian Harbulot appelle à une nouvelle culture stratégique, inspirée des philosophies asiatiques comme le taoïsme, qui privilégient l’adaptation et la domination par l’influence plutôt que la destruction.
Le Japon, pionnier dans l’usage de l’information comme levier économique, est un modèle.
Les États-Unis eux-mêmes, avec le rapport Japan 2000, ont cherché à percer ce secret.
Les décideurs, formés à la gestion mesurable, négligent les affrontements indirects.
Christian Harbulot appelle à une nouvelle culture stratégique, inspirée des philosophies asiatiques comme le taoïsme, qui privilégient l’adaptation et la domination par l’influence plutôt que la destruction.
Le Japon, pionnier dans l’usage de l’information comme levier économique, est un modèle.
Les États-Unis eux-mêmes, avec le rapport Japan 2000, ont cherché à percer ce secret.
Faire face à une urgence : repenser le renseignement comme une fonction globale et collective, au service de la guerre économique du temps de paix.
Cette guerre, loin des champs de bataille traditionnels, se joue dans les réseaux, les normes, les contrats.
L’Europe, pour y survivre, doit surmonter ses divisions et adopter une intelligence économique digne de ses ambitions.
Sinon, elle restera un échiquier où d’autres imposent leurs règles.
L’Europe, pour y survivre, doit surmonter ses divisions et adopter une intelligence économique digne de ses ambitions.
Sinon, elle restera un échiquier où d’autres imposent leurs règles.
Giuseppe Gagliano a fondé en 2011 le réseau international Cestudec (Centre d'études stratégiques Carlo de Cristoforis), basé à Côme (Italie), dans le but d'étudier, dans une perspective réaliste, les dynamiques conflictuelles des relations internationales. Ce réseau met l'accent sur la dimension de l'intelligence et de la géopolitique, en s'inspirant des réflexions de Christian Harbulot, fondateur et directeur de l'École de Guerre Économique (EGE).
Il collabore avec le Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R) (Lien),https://cf2r.org/le-cf2r/gouvernance-du-cf2r/ et avec l'Université de Calabre dans le cadre du Master en Intelligence, et avec l'Iassp de Milan (Lien).https://www.iassp.org/team_master/giuseppe-gagliano/
La responsabilité de la publication incombe exclusivement aux auteurs individuels.

 Accueil
Accueil