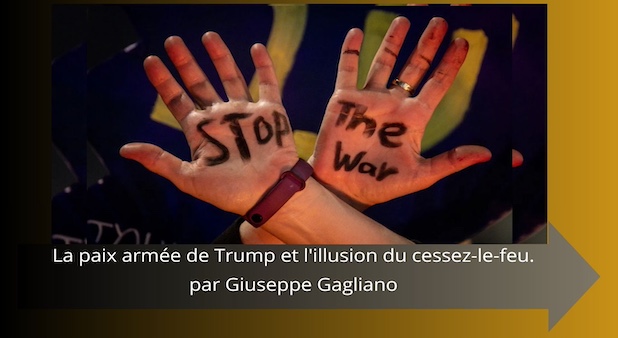
Le Moyen-Orient entre dans une nouvelle phase où la guerre préventive ne disparaît pas : elle change de forme, de langage et d'outils
Au Moyen-Orient, le mot "paix" n'a jamais été neutre. Chaque trêve, chaque cessez-le-feu, chaque négociation porte en elle la conscience que rien n'est jamais vraiment réglé : ce sont des équilibres précaires, réversibles, souvent imposés de l'extérieur. L'accord conclu par Donald Trump illustre parfaitement cette logique. Ce cessez-le-feu n'est pas une paix réelle : c'est une suspension temporaire des hostilités, un gel des lignes de front. Le bruit des bombes s'est arrêté, mais la logique stratégique qui les a rendues inévitables n'a pas été démantelée.
Derrière la signature américaine se cache une paix "de façade", où la doctrine de la guerre préventive n'est pas abandonnée mais mise en sommeil, prête à être réactivée au premier incident. Israël conserve une marge d'action unilatérale, l'Iran réorganise ses réseaux régionaux et l'Europe, une fois encore, regarde sans agir.
L'héritage de la guerre préventive
Pendant des années, la stratégie israélienne s'est articulée autour d'un principe simple et brutal : frapper avant d'être frappé. Cette doctrine s'est traduite par des assassinats ciblés, des frappes contre des positions iraniennes en Syrie, des opérations clandestines au Liban et à Gaza. Elle a permis d'empêcher ses adversaires de renforcer leurs capacités militaires, mais elle a aussi normalisé une guerre permanente à basse intensité, acceptée par une partie des capitales occidentales comme une "réalité régionale".
L'accord de Trump ne change pas cette logique : il la maquille. La rhétorique de la "prévention" se transforme en langage diplomatique calibré, mais la liberté d'action reste entière. Israël conserve le droit d'intervenir contre toute "menace émergente", tandis que les acteurs régionaux sont simplement invités à ne pas réagir de manière trop voyante. La paix devient une anesthésie, pas une solution.
Un terrain qui reste explosif
Sur le terrain, rien n'est réellement stabilisé. À Gaza, la crise humanitaire reste dramatique : la reconstruction avance au ralenti, sous contrôle politique et militaire. Au Liban, le Hezbollah n'a pas désarmé ; il a seulement mis ses opérations en veille pour des raisons tactiques. En Syrie, les frappes israéliennes ciblées continuent, dissimulées derrière une diplomatie qui parle "d'incidents limités".
L'Iran profite de cette pause pour renforcer ses routes logistiques, intensifier sa coopération avec la Russie et la Chine, et consolider une profondeur stratégique qui n'a pas été démantelée mais dispersée et rendue plus insaisissable.
Une Europe spectatrice
L'Europe n'est plus un acteur, mais un observateur. Jadis, elle revendiquait une "troisième voie" diplomatique ; aujourd'hui, elle subit les équilibres imposés par d'autres. L'accord de Trump en est une illustration parfaite : les Européens ont été informés, non consultés. Ils ont applaudi une paix sur laquelle ils n'ont eu aucune influence. Leur voix pèse peu face aux logiques énergétiques et sécuritaires dictées par Washington et Tel-Aviv.
Ce retrait diplomatique signe une marginalisation stratégique : l'Europe parle droit international tandis que d'autres décident quand le suspendre et quand le réactiver.
Un droit international vidé de sa substance
Cette paix armée repose sur une érosion profonde du droit international.
La guerre préventive, pourtant absente de tout cadre juridique, est devenue un outil accepté. Ce précédent dépasse largement le Moyen-Orient : demain, d'autres États pourront revendiquer le même "droit" pour attaquer de manière unilatérale. C'est la transformation d'une exception en habitude, avec pour conséquence une fragilisation systémique des règles mondiales.
La guerre préventive, pourtant absente de tout cadre juridique, est devenue un outil accepté. Ce précédent dépasse largement le Moyen-Orient : demain, d'autres États pourront revendiquer le même "droit" pour attaquer de manière unilatérale. C'est la transformation d'une exception en habitude, avec pour conséquence une fragilisation systémique des règles mondiales.
Dans ce contexte, la diplomatie ne règle pas les conflits : elle les gèle. Les négociations ne construisent pas la paix : elles aménagent des pauses.
Le silence arabe
Les capitales arabes ont encore une fois opté pour la prudence silencieuse. Face au drame de Gaza, à la puissance israélienne et aux pressions américaines, elles ont choisi l'immobilisme. Cette neutralité a un prix : elle laisse le champ libre à Israël et à l'Iran, qui fixent seuls les règles du jeu. En refusant de s'affirmer, elles s'effacent.
Trump, l'arbitre imparfait
Trump n'est pas un médiateur au sens classique : il est un arbitre intéressé. Son cessez-le-feu vise à renforcer la position américaine dans la région plutôt qu'à construire une paix durable. Washington impose ; les autres s'adaptent. Israël garde la liberté d'action, l'Iran gagne du temps, les pays arabes se taisent, l'Europe applaudit. Ce système repose sur une stabilité fragile, qui pourrait s'effondrer au premier incident majeur.
La France et la diplomatie absente
La France illustre cette défaite stratégique européenne. Autrefois capable de tenir une ligne indépendante, héritière de Charles de Gaulle, elle s'aligne aujourd'hui sur une vision importée. Les mots sont humanitaires, mais la politique est absente. Ni Paris ni Bruxelles ne disposent des leviers nécessaires pour peser dans la région.
Un équilibre instable et dangereux
Le cessez-le-feu imposé par Trump n'a pas apporté la paix. Il a figé les rapports de force : les acteurs armés restent armés, les alliances tactiques demeurent, les puissances extérieures dictent les règles. Le droit international reste suspendu, remplacé par le calcul militaire.
Cette "paix armée" n'est pas un nouvel ordre, mais une parenthèse dangereuse. Une trêve fragile dans laquelle chacun se prépare à la prochaine confrontation. Derrière le silence des armes s'accumulent tensions, rancunes et stratégies différées.
Le Moyen-Orient vit sous une paix qui n'en est pas une. Et dans ce vide diplomatique, la guerre préventive, loin d'avoir disparu, continue d'écrire les règles du jeu.
A propos de ...
Giuseppe Gagliano a fondé en 2011 le réseau international Cestudec (Centre d'études stratégiques Carlo de Cristoforis), basé à Côme (Italie), dans le but d'étudier, dans une perspective réaliste, les dynamiques conflictuelles des relations internationales. Ce réseau met l'accent sur la dimension de l'intelligence et de la géopolitique, en s'inspirant des réflexions de Christian Harbulot, fondateur et directeur de l'École de Guerre Économique (EGE).
Il collabore avec le Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R) (Lien),https://cf2r.org/le-cf2r/gouvernance-du-cf2r/ et avec l'Université de Calabre dans le cadre du Master en Intelligence, et avec l'Iassp de Milan (Lien).https://www.iassp.org/team_master/giuseppe-gagliano/
La responsabilité de la publication incombe exclusivement aux auteurs individuels.

 Accueil
Accueil
