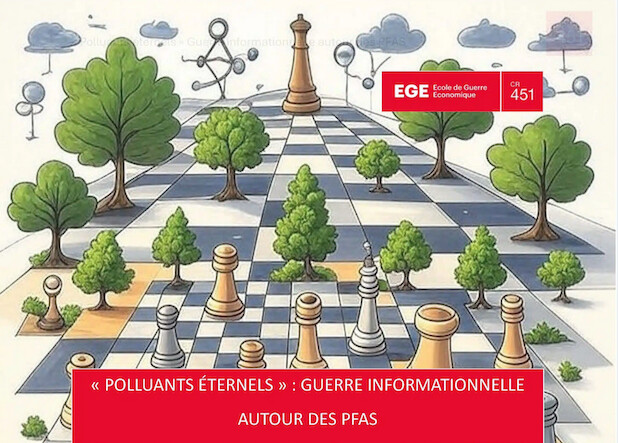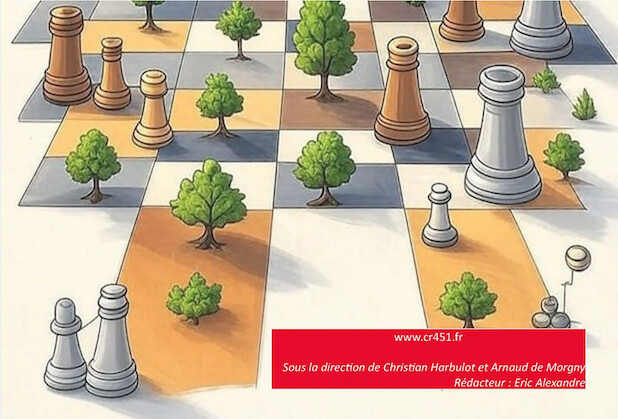Ce débat dépasse les seules considérations sanitaires ou scientifiques pour s’inscrire dans une dynamique de guerre cognitive structurée, mobilisant des outils d’influence, de manipulation et de captation narrative. Le présent article s’appuie sur les travaux du CR451 pour analyser cette confrontation selon une grille d’intelligence stratégique, en croisant les dimensions de désinformation, d’encerclement cognitif, de capture institutionnelle et de régulation normative
Le cadrage militant et la conquête de l'opinion
Le succès du camp anti-PFAS repose sur une stratégie d’influence particulièrement cohérente, structurée autour d’un triptyque : simplification, dramatisation et amplification. Le terme « polluants éternels » a permis une reconfiguration sémantique puissante : alors que les PFAS désignent une famille de plus de 10 000 molécules, dont seules certaines présentent des risques avérés, le discours militant les a réunies sous une même dénomination anxiogène. Cette opération de cadrage (framing) a été déterminante pour imposer un récit commun dans l’espace public.
La dramatisation s’est traduite par des analogies historiques et sanitaires (amiante, cancers, empoisonnement), générant un effet d’urgence émotionnelle.
Le troisième pilier, l’amplification, s’est opéré via une boucle médiatique pernicieuse : contenus militants et journalistes → relais médiatiques → reprise politique → intégration législative. Des figures comme Camille Etienne, des ONG comme Générations Futures ou des consortiums comme le Forever Pollution Project ont occupé une place centrale dans la « viralisation » des contenus, grâce à une hybridation efficace entre militantisme, journalisme d’enquête et influence numérique.
La dramatisation s’est traduite par des analogies historiques et sanitaires (amiante, cancers, empoisonnement), générant un effet d’urgence émotionnelle.
Le troisième pilier, l’amplification, s’est opéré via une boucle médiatique pernicieuse : contenus militants et journalistes → relais médiatiques → reprise politique → intégration législative. Des figures comme Camille Etienne, des ONG comme Générations Futures ou des consortiums comme le Forever Pollution Project ont occupé une place centrale dans la « viralisation » des contenus, grâce à une hybridation efficace entre militantisme, journalisme d’enquête et influence numérique.
Une communication industrielle en décalage
En réaction, les industriels visés – Arkema, Téfal, Veolia – ont opté pour une stratégie de communication classique, essentiellement technique et défensive. Celle-ci s’est révélée inadaptée au niveau de conflictualité informationnelle atteint. La mobilisation de données scientifiques, de distinctions moléculaires ou d’arguments techniques n’a pas résisté à la puissance émotionnelle du cadrage adverse. La communication « corporate » a également souffert d’un défaut d’incarnation : pas de figures identifiables, pas de récit cohérent, et peu de réponse directe aux attaques subies.
En outre, certains angles d’attaque ont été négligés : la question du financement des ONG, les effets de l’écoanxiété, l’instrumentalisation du principe de précaution ou encore la non-prise en compte des usages industriels essentiels des PFAS. Cette absence de contre-offensive narrative a contribué à installer durablement la perception d’un « lobby industriel toxique », dans un scénario proche du mythe de David contre Goliath inversé.
En outre, certains angles d’attaque ont été négligés : la question du financement des ONG, les effets de l’écoanxiété, l’instrumentalisation du principe de précaution ou encore la non-prise en compte des usages industriels essentiels des PFAS. Cette absence de contre-offensive narrative a contribué à installer durablement la perception d’un « lobby industriel toxique », dans un scénario proche du mythe de David contre Goliath inversé.
Capture institutionnelle et victoire normative
Un des constats majeurs du rapport du CR451 est l’occurrence d’une capture institutionnelle. Ce phénomène désigne l’adoption par des institutions publiques d’un cadrage discursif issu du militantisme. Dans le cas des PFAS, l’expression « polluants éternels » a été utilisée officiellement par les ARS, certaines DREAL, et par la ministre de la Transition écologique alors que l’ agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) utilise l’expression « produits chimiques persistants ». Ce lexique, non scientifique, a donc pénétré le langage réglementaire. L’alignement des institutions sur un vocabulaire émotionnel marque une rupture avec la neutralité attendue du discours public.
La loi de février 2025, votée à la suite de cette séquence informationnelle, confirme cette dynamique. Elle consacre non seulement l’interdiction progressive des PFAS, mais aussi la légitimation d’un récit militant devenu hégémonique. En cela, la victoire du camp anti-PFAS n’est pas seulement juridique ou environnementale : elle est avant tout narrative et cognitive. Les industriels, relégués dans une position défensive, ont été dépossédés de leur capacité à structurer l’agenda symbolique du débat.
La loi de février 2025, votée à la suite de cette séquence informationnelle, confirme cette dynamique. Elle consacre non seulement l’interdiction progressive des PFAS, mais aussi la légitimation d’un récit militant devenu hégémonique. En cela, la victoire du camp anti-PFAS n’est pas seulement juridique ou environnementale : elle est avant tout narrative et cognitive. Les industriels, relégués dans une position défensive, ont été dépossédés de leur capacité à structurer l’agenda symbolique du débat.
Vers un deuxième acte à l’échelle européenne
L’européanisation du conflit constitue la prochaine étape de cette guerre informationnelle. À travers des mécanismes de coordination transnationale (notamment le Forever Pollution Project), les ONG entendent répliquer leur stratégie dans d’autres États membres et influencer les processus de normalisation communautaire. L’objectif affiché : une interdiction totale des PFAS dans l’Union européenne, incluant les produits aujourd’hui exemptés (comme les ustensiles de cuisine).
Ce déplacement du champ de bataille vers Bruxelles s’accompagne d’un repositionnement des relais d’influence : pétitions transnationales, mobilisation des eurodéputés, interpellation de la Commission. Le modèle français, perçu comme une victoire, devient la base d’un effet de cliquet stratégique. Le narratif militant y est mobilisé comme levier d’influence sur des régulateurs parfois distants du terrain scientifique mais sensibles à la pression symbolique et médiatique. Alors qu’un processus d’évaluation des risques et effets est en cours au sein de l’agence européenne des produits chimiques depuis 2021.
Ce déplacement du champ de bataille vers Bruxelles s’accompagne d’un repositionnement des relais d’influence : pétitions transnationales, mobilisation des eurodéputés, interpellation de la Commission. Le modèle français, perçu comme une victoire, devient la base d’un effet de cliquet stratégique. Le narratif militant y est mobilisé comme levier d’influence sur des régulateurs parfois distants du terrain scientifique mais sensibles à la pression symbolique et médiatique. Alors qu’un processus d’évaluation des risques et effets est en cours au sein de l’agence européenne des produits chimiques depuis 2021.
Conclusion
Le cas PFAS constitue un exemple paradigmatique de guerre informationnelle appliquée à un sujet environnemental et technico-réglementaire. La confrontation n’a pas eu lieu sur le terrain de la science, mais sur celui de la représentation collective. Les ONG ont su imposer une grille d’interprétation émotionnelle, structurée et efficace, face à des industriels désarmés dans un combat où l’information est l’arme principale. L’encerclement cognitif, la capture institutionnelle et l’amplification médiatique ont permis une reconfiguration des rapports de force, consacrant la prééminence du récit sur la donnée brute.
Ce cas impose aux entreprises comme aux décideurs publics une remise en question de leurs stratégies informationnelles. Dans un monde où les normes sont de plus en plus forgées dans l’opinion avant de l’être dans les lois, maîtriser les outils de l’influence cognitive devient une compétence stratégique centrale.
Ce cas impose aux entreprises comme aux décideurs publics une remise en question de leurs stratégies informationnelles. Dans un monde où les normes sont de plus en plus forgées dans l’opinion avant de l’être dans les lois, maîtriser les outils de l’influence cognitive devient une compétence stratégique centrale.
Lien vers le rapport
Le CR451 est le Centre de Recherche Appliquée de l’École de Guerre Économique (EGE), fondé en janvier 2022.
Dirigé par Christian Harbulot, expert en intelligence économique, le CR451 se concentre sur l’étude des conflits informationnels, de la guerre économique et des rapports de force géopolitiques. Il vise à développer des grilles de lecture innovantes pour comprendre les dynamiques de puissance modernes, notamment face à l’influence des GAFAM et aux nouvelles formes de confrontation économique.
Le centre mène des recherches appliquées, organise des séminaires, produit des podcasts et publie des études de cas.

 Accueil
Accueil