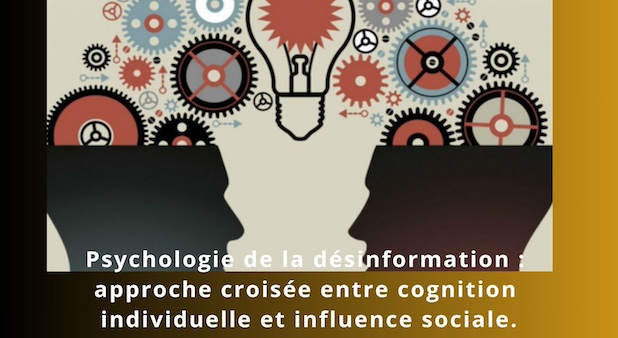Les émotions jouent également un rôle déterminant dans ce processus. Peur, anxiété ou indignation peuvent exacerber la crédulité et amplifier la viralité de certains messages, en particulier dans des contextes marqués par l’incertitude. Mais au-delà des biais individuels, c’est tout un ensemble de dynamiques collectives qui vient soutenir l’adhésion aux récits manipulés : pression sociale, polarisation des opinions ou autorité supposée renforcent la légitimité apparente de certaines idées au sein des groupes. L’attachement identitaire, conjugué à la dissonance cognitive, explique pourquoi certaines croyances persistent malgré les faits.
Enfin, les auteurs insistent sur le rôle stratégique que peuvent jouer les minorités actives. Grâce à leur cohérence et leur persévérance, elles sont en mesure d’orienter l’opinion publique, parfois au détriment d’une majorité silencieuse.
Licence : https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.frCroiser les apports de la psychologie sociale et cognitive permet ainsi de dépasser les simples approches correctives et d’envisager une riposte plus robuste. Renforcer l’esprit critique, cultiver le doute raisonné et promouvoir une véritable éducation aux médias s’imposent comme des leviers essentiels pour contrer durablement l’impact de la désinformation.
Le rôle des biais cognitifs dans la réception et la diffusion de fausses informations
Dans un contexte d’inondation informationnelle, notre cerveau fait appel à des schémas de pensée automatiques – biais cognitifs et heuristiques – pour gérer la surcharge, au prix d’erreurs de jugement et de distorsions mémorielles.
Ces raccourcis, indispensables au quotidien, se retournent contre nous quand ils sont exploités pour manipuler l’opinion : le biais de confirmation, l’ancrage ou l’effet de simple exposition, renforcés par les algorithmes des réseaux sociaux, favorisent la propagation de récits fallacieux. Mieux comprendre ces mécanismes et renforcer l’esprit critique par l’éducation aux médias constituent des pistes essentielles pour contenir la désinformation.
Mémoire fragile, croyances tenaces : pourquoi les fausses informations persistent ?
Si la théorie classique attribue cet effet au seul sentiment de familiarité, des recherches plus récentes soulignent l’intervention d’un mécanisme de remémoration : au fil des expositions répétées, nous avons parfois l’impression de « nous souvenir » d’une information, alors même que cette mémoire est façonnée par la répétition elle-même. Cette double influence – fluence cognitive et faux sentiment de souvenir – rend la désinformation particulièrement tenace et complique la correction des idées fausses.
Pour contrer l’effet de vérité illusoire, il ne suffit pas de rappeler la réalité : il faut encourager un examen critique des sources et adopter des stratégies pédagogiques qui réveillent notre esprit d’analyse (questions factuelles, vérification croisée, mise en perspective historique). En misant sur un traitement cognitif plus approfondi, on limite l’emprise de la simple répétition et on renforce notre capacité collective à résister aux idées trompeuses.
Formation de faux souvenirs : entre reconstruction mnésique et désinformation
La mémoire humaine reconstruit les souvenirs plutôt que de les enregistrer fidèlement, ce qui la rend sujette aux faux souvenirs nés de la confusion, de l’imagination ou de l’influence d’autrui. Les recherches de Loftus ont démontré que les suggestions post-événement et la répétition de récits biaisés altèrent notre souvenir des faits, un phénomène d’autant plus critique à l’ère de la désinformation massive.

Les émotions telles que la peur, l’anxiété et l’indignation morale façonnent profondément la manière dont nous recevons et relayons l’information, qu’elle soit vraie ou fabriquée. Les techniques de prévention sanitaire ou de sécurité routière ont depuis longtemps exploité l’appel à la peur pour capter l’attention et encourager un changement de comportement, mais ce même levier se retourne en un puissant outil de manipulation lorsqu’il est détourné au service de la désinformation.
En période de crise, l’incertitude et la confusion amplifient ce phénomène : face à une menace perçue, notre attention se focalise sur les éléments anxiogènes, notre esprit critique s’amenuise et le biais de confirmation renforce nos craintes préexistantes. L’entourage, les autorités ou les médias accentuent alors le sentiment de vulnérabilité, nourrissant des boucs émissaires, exacerbant les préjugés et favorisant la xénophobie.
La persuasion par la peur dépend néanmoins de la croyance en l’efficacité des réponses proposées : lorsque nous jugeons pouvoir agir face au danger, ces messages sont plus convaincants, mais dès que la menace paraît inévitable, ils suscitent déni, minimisation ou passivité. Les recherches montrent que l’intensité émotionnelle peut primer sur la qualité des arguments ; les récits dramatiques et sensoriels, relayés massivement sur les réseaux sociaux, s’ancrent plus facilement dans la mémoire et échappent aux corrections factuelles.
Comprendre ces mécanismes est indispensable pour contrer la propagation des contenus trompeurs : il s’agit de concevoir des communications informatives qui offrent des solutions crédibles, stimulent l’analyse rationnelle et résistent à l’attrait émotionnel des messages anxiogènes.
Vous l'avez compris !
La désinformation n’est pas seulement une question de contenus douteux, c’est avant tout un phénomène social profondément ancré dans nos dynamiques collectives. Les individus, souvent sans s’en rendre compte, ajustent leur comportement et leurs opinions pour se conformer à leur entourage.
Ce besoin d’appartenance pousse chacun à suivre la majorité, même lorsque celle-ci a manifestement tort, comme l’ont montré les célèbres expériences de Solomon Asch. Cette conformité est renforcée par l’influence de figures perçues comme crédibles ou autoritaires, et par le désir d’éviter le rejet. L’autorité, en effet, peut parfois suffire à faire taire le jugement moral, comme l’a mis en lumière Stanley Milgram dans ses travaux sur l’obéissance. Ajoutons à cela l’effet de halo qui, à partir d’un seul trait perçu comme positif, amène à accorder à une personne une confiance bien plus large que justifiée.
L’adhésion à une information ne repose donc pas uniquement sur sa véracité, mais sur des repères sociaux, émotionnels et identitaires. Lorsqu’un message vient heurter des croyances profondes, la réaction peut être de le rejeter non pas parce qu’il est faux, mais parce qu’il menace une cohésion interne précieuse. La dissonance cognitive, décrite par Festinger, explique ce malaise face à l’inconfort de l’incertitude. À ce moment-là, la rationalité ne sert plus à chercher la vérité, mais à défendre un récit qui protège l’image de soi et celle du groupe. La résistance à l’information vérifiée peut donc relever d’un réflexe identitaire plutôt que d’une mauvaise analyse.
Dans ce paysage, les minorités actives ont un rôle décisif. Bien que numériquement faibles, leur cohérence et leur persistance leur permettent de bousculer les normes établies. En exploitant les ressorts émotionnels et les mécanismes viraux des réseaux sociaux, elles imposent des récits alternatifs au sein d’une majorité souvent passive. Cette dernière, même si elle adhère aux faits, s'engage peu dans leur défense, laissant ainsi le terrain libre à ceux qui, animés par des convictions profondes, redessinent les lignes du débat public.
Auteurs
Mohamed Amine Belka est analyste en stratégie économique et doctorant en Sciences de l'information et de la communication (SIC) à l’Université de Lorraine (CREM – équipe PRAXIS). Ses travaux portent sur les stratégies d’influence des entreprises de la BITD face à la concurrence internationale. Il intervient sur les enjeux de souveraineté industrielle, d’intelligence économique et de sécurisation des chaînes de valeur. Il a également occupé des fonctions de coordination territoriale, de pilotage de projets et de management des risques. Son parcours allie expertise managériale, action publique et accompagnement des entreprises. Il est membre de la commission « manipulations de l’information » de l’IE IHEDN. Ses travaux croisent SIC, management stratégique et politiques industrielles.
Tara de Condappa est docteure en psychologie sociale, chercheuse associée au CURAPP-ESS (Centre Universitaire de Recherches sur l'Action Publique et le Politique Épistémologie & Sciences Sociales) et au CRP-CPO (Centre de Recherche en Psychologie : Cognition, Psychisme et Organisation). Professionnelle engagée, elle conçoit, pilote et évalue des projets à fort impact humain et social. Elle intervient à l’interface entre recherche, action publique et coopération internationale. Son parcours pluridisciplinaire croise psychologie, sciences sociales et politiques publiques. Elle développe des approches transversales pour penser et transformer les pratiques.
Thibault Renard est expert en intelligence économique, prospective et anticipation du risque numérique. Jusqu’à fin 2019, il a occupé le poste de responsable de l’intelligence économique à CCI France, l’établissement national chargé de fédérer et d’animer les Chambres de commerce et d’industrie. Il a précédemment été en poste à la Mission économique de l’Ambassade de France en Autriche. Il est par ailleurs administrateur au Syndicat français de l’intelligence économique (Synfie), senior advisor au CyberCercle, et responsable de la commission « manipulations de l’information » de l’IE-IHEDN, qui réunit une vingtaine d’experts spécialisés dans ce domaine.

 Accueil
Accueil