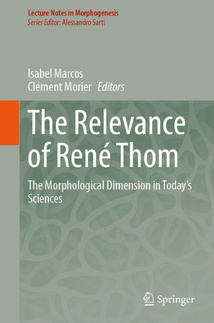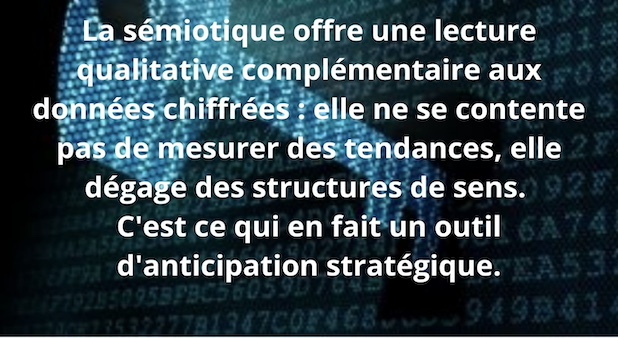
Votre article explore le rôle fondamental de la sémiotique dans la prospective. Comment cette discipline, habituellement associée à l'étude des signes et des langages, peut-elle servir d'outil d'anticipation pour décrypter les tendances émergentes et les mutations sociétales ?
Chaque mutation sociale, culturelle ou technologique se traduit d'abord par une transformation du sens : de nouveaux mots apparaissent, des récits se répandent, des images deviennent virales. Ces phénomènes, que l'on pourrait considérer comme marginaux, sont en réalité les premiers signaux de bifurcations profondes.
La sémiotique permet précisément d'identifier ces « signaux faibles » inscrits dans les structures. Elle rend visibles les structures d'imaginaire qui orientent les comportements collectifs.
Prenons deux exemples récents — je me rappelle déjà, dans les années 1990, lorsque j'ai commencé mon doctorat à Aarhus, au Danemark :
- On percevait déjà l'émergence de discours écologiques autour du zéro déchet : au départ marginal, ce mouvement a fini par modifier les politiques publiques, les modes de consommation et même les stratégies des grandes entreprises. Le Danemark est devenu pionnier dans ce domaine.
- La diffusion des récits autour de la machine intelligente se faisait déjà sentir dans mon centre de recherche en linguistique : bien avant que ChatGPT ou MidJourney ne soient massivement utilisés, la sémiotique anticipait cette tendance, en repérant dans les discours spécialisés les signes d'une révolution cognitive et culturelle. Mon centre est d'ailleurs devenu par la suite un centre en sémiotique et cognition.
Dans les deux cas, la sémiotique offre une lecture qualitative complémentaire aux données chiffrées : elle ne se contente pas de mesurer des tendances, elle dégage des structures de sens. C'est ce qui en fait un outil d'anticipation stratégique.
Vous parlez de la sémiotique comme métalangage. Pouvez-vous préciser ?
Pourtant, ces disciplines communiquent en permanence : elles expriment des valeurs, organisent des récits collectifs, structurent des identités. La sémiotique agit comme une méta-structure : elle permet de voir comment un objet, un espace ou une politique prend sens. C'est ce qui la rend indispensable à la prospective.
Si l'on veut anticiper, il ne suffit pas d'accumuler des données. Il faut comprendre comment ces données deviennent signifiantes pour une société, comment elles s'intègrent dans un imaginaire collectif.
Prenons un cas concret : la conception des « smart cities ». Derrière l'accumulation technologique, il existe un récit dominant, celui de la ville rationalisée, pilotée par des données.
Mais la sémiotique nous aide à voir qu'il existe aussi d'autres récits concurrents : la ville écologique, la ville régénérative, la ville solidaire. Chacun de ces récits mobilise des signes (mots, images, objets urbains) qui orientent déjà des choix politiques et économiques.
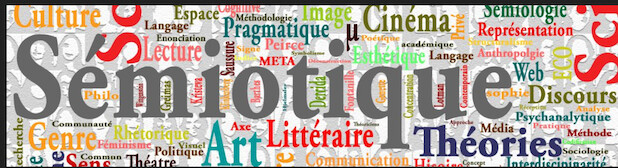
Pourriez-vous donner une définition de la sémiotique dans ce cadre ?
Elle s'intéresse à la manière dont les sociétés produisent, transforment et partagent du sens.
Trois caractéristiques me semblent importantes :
1. Elle ne se limite pas à décrire : elle propose des scénarios interprétatifs.
2. Elle n'analyse pas seulement les signes isolés, mais les configurations globales (discours, récits, systèmes symboliques).
3. Elle est opérationnelle : elle peut accompagner des stratégies de communication, de design, de politique publique.
Dans ma propre expérience, j'ai appliqué la sémiotique à des domaines très variés : de l'aviation commerciale (Air France) à la presse (Libération), en passant par l'urbanisme et le design. Dans tous ces cas, il s'agissait de détecter comment les signes circulaient, se transformaient, et pouvaient être orientés vers des futurs possibles.
Vous insistez sur la sémiotique dynamique et la morphogenèse. Que faut-il entendre par là ?
Appliquée à la sémiotique, cette approche permet de comprendre :
- comment un imaginaire se transforme, ·
- comment une société bascule d'un équilibre à un autre,
- comment une crise peut devenir génératrice de nouvelles formes. Par exemple, la pandémie de COVID-19 n'a pas seulement été un événement sanitaire. Elle a transformé en profondeur nos récits sur le travail, la mobilité, la solidarité. La sémiotique morphogénétique permet de modéliser ces basculements sémiotiques.
L'innovation est au cœur de vos exemples. Comment la sémiotique la traite-t-elle ?
Prenons deux exemples :
- L'iPhone, en 2007. Ce lancement n'a pas seulement introduit un nouveau téléphone portable. Il a réinventé notre rapport à l'écran, au geste tactile et à la mobilité. L'objet est devenu l'interface centrale d'une nouvelle expérience culturelle : regarder, communiquer, consommer, se géolocaliser. Ce fut d'abord une révolution sémiotique – un bouleversement du sens et des usages – avant même d'être une prouesse technologique.
- Les énergies renouvelables. Leur succès ne s'explique pas seulement par leur efficacité énergétique. Elles portent un imaginaire de régénération, de responsabilité et de futur durable. Investir dans le solaire ou l'éolien, ce n'est pas seulement produire de l'électricité, c'est adhérer à une vision du monde où l'énergie est associée à la vie, au cycle naturel, à une promesse de continuité pour les générations futures.
Concrètement, quelle méthodologie la sémiotique propose-t-elle pour la prospective ?
1. Repérer les différences pertinentes : identifier ce qui fait saillance, ce qui attire l'attention et modifie le sens.
2. Hiérarchiser les niveaux de signification : distinguer les dimensions affectives, narratives, symboliques.
3. Construire des scénarios sémiotiques : imaginer les trajectoires possibles à partir des tensions identifiées.
4. Détecter les bifurcations : repérer les seuils critiques où un système peut basculer vers un autre état.
Cette approche peut s'appliquer à des secteurs très différents : l'économie, la culture, la politique, mais aussi l'écologie. Dans mes recherches, j'ai par exemple utilisé cette méthode pour analyser les projets urbains « régénératifs », qui cherchent à intégrer biodiversité, participation citoyenne et économie circulaire.
Vous proposez un concept de « grammaire morphogénétique des futurs ». En quoi diffère-t-elle des grammaires traditionnelles ?
La grammaire morphogénétique, au contraire, formalise le changement. Elle ne décrit pas ce qui est, mais ce qui peut advenir. Elle s'appuie sur trois principes : ·
- Les catastrophes élémentaires de Thom, qui modélisent les bifurcations. ·
- L'éco-sémiotique de Per Aage Brandt, qui insiste sur l'intégration des dimensions biologiques, sociales et symboliques.
- La notion de tension : ce sont les tensions (économiques, écologiques, culturelles) qui préparent les transformations.
Appliquée à l'intelligence économique, cette grammaire permet de lire les crises non seulement comme des menaces, mais comme des occasions d'émergence. Elle aide à transformer l'incertitude en stratégie.
Vous mobilisez la pensée de René Thom. En quoi sa théorie des catastrophes enrichit-elle la prospective ?
Cela va à l'encontre d'une vision linéaire du progrès. Pour la prospective, c'est une leçon précieuse : l'avenir n'est pas une extension mécanique du présent, mais une série de bifurcations.
Prenons l'exemple des transitions énergétiques. On pourrait croire qu'elles se feront progressivement. En réalité, elles sont jalonnées de seuils critiques : raréfaction du pétrole, accélération du dérèglement climatique, innovations disruptives dans le stockage. La théorie des catastrophes permet d'anticiper ces points de basculement et d'en comprendre leur structures morphologiques.
Dans un monde en mutation, comment la sémiotique peut-elle éclairer les choix des décideurs et enrichir l'intelligence décisionnelle ?
1. En éclairant les choix : elle révèle les logiques symboliques qui sous-tendent une décision.
2. En devenant un levier stratégique : elle transforme les « signaux faibles » en scénarios lisibles.
3. En enrichissant la veille stratégique : elle introduit une dimension qualitative, sensible, qui échappe aux seules données quantitatives.
Je dirais que la sémiotique aide les décideurs à « voir autrement » : à percevoir dans les discours, les récits, les symboles, les germes de futurs possibles.
Une remarque plus personnelle, un conseil de lecture, un rendez-vous à recommander ?
Je formulerais deux remarques.
La première est qu'il me semble urgent de replacer le sens au cœur de la décision. Nous vivons un moment où les indicateurs purement quantitatifs peinent à rendre compte de la complexité des crises sociales, culturelles et écologiques. Or, la sémiotique – et plus particulièrement la sémiotique dynamique inspirée par René Thom – constitue une véritable boîte à outils pour affronter ces défis. Elle permet de penser les bifurcations, d'anticiper les ruptures, mais aussi de relier les transformations techniques aux imaginaires symboliques et aux conditions écologiques qui les sous-tendent.
Il faut rappeler que de nombreuses entreprises recourent déjà à la sémiotique, parfois de manière discrète, pour se différencier sur le marché. J'ai moi-même travaillé dans ce cadre, mais j'ai choisi depuis plusieurs années de limiter cet usage aux décisions écologiques, urbanistiques et sociales.
Un exemple est ma participation, entre 2016 et 2020, à un projet COST sur les théories du complot. Avec plusieurs collègues sémioticiens, nous avons analysé les mécanismes narratifs et symboliques de ces récits, afin de mieux en identifier les logiques et d'en limiter les effets (conspiracytheories.eu).
Un autre exemple, plus marquant encore, est le projet que j'ai dirigé dès 2016 avec Clément Morier, sous la forme d'un séminaire de recherche autour de la pensée de René Thom, avec la collaboration des disciples directs de thom. Ce travail a abouti à la publication de trois ouvrages collectifs :
- Marcos, I., & Morier, C. (Eds.). (2024). The relevance of René Thom: The morphological dimension in today's sciences. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-54982-3
Nous y proposons une synthèse des recherches menées entre 2016 et 2024, notamment dans l'introduction (What if Science Thought? The Relevance of René Thom or Introducing Topology into Today's Sciences). J'y ai également présenté un travail développé avec le psychanalyste Carlos Farate, où nous avons appliqué la sémiotique thomienne à la création d'une psychanalyse territoriale appliquée à la salpêtrière. Ce texte s'appuie sur une recherche de longue haleine (1996–2015), menée en collaboration avec l'urbaniste en chef du projet Paris Rive Gauche, visant à analyser les conflits inscrits dans les formes urbaines et à explorer des voies de résolution par une lecture morphodynamique.
- Marcos, I., & Morier, C. (Eds.). (2024). La Part de l'Œil, 38: Esthétiques du vivant / René Thom et la morphogenèse, en dialogue (pp. 169–249). Bruxelles: La Part de l'Œil. ISBN: 978-2-9301746-0-0
Cet ouvrage rassemble une réflexion plus philosophique et artistique sur la morphogenèse, mettant en dialogue sciences, arts, la philosophie et sémiotique dynamique.
- Marcos, I., & Morier, C. (2023). Centenaire de René Thom (1923-2023) : hommage sémiotique et morphodynamique. Estudos Semióticos, 19(1), i–xxviii. São Paulo.
https://revistas.usp.br/esse/article/view/210388
En somme, oui : la sémiotique peut devenir un levier stratégique pour accompagner les grandes transformations de notre époque, à condition de l'aborder comme une science du sens en mouvement, et non comme un simple décryptage des discours.
Scientifique de formation et adepte de l’interdisciplinarité, Isabel Marcos s’appuie sur les travaux de René Thom et Per Aage Brandt pour dépasser la séparation entre sciences exactes et sciences humaines. Elle défend une vision où chaque individu vit simultanément dans trois mondes : naturel, socioculturel et intime.
Elle fait partie du Comité Exécutif de l'Association Internationale de Sémiotique (IASS) : https://iass-ais.org/officers/executive-committee/.
Isabel Marcos, architecte et sémioticienne, docteure en sémiotique et en sciences de la communication, est une figure internationale de la sémiotique visuelle, auteure de nombreux ouvrages.

 Accueil
Accueil