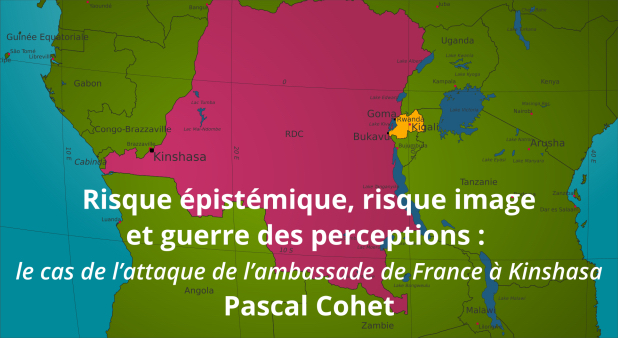
Kinshasa, 28 janvier 2025 : attaque de l’ambassade de France
Les rapports Muse et Duclert
L’Élysée avait pour sa part commandé un rapport analogue à un groupe d’historiens sous la direction de Vincent Duclert, ce qui devait permettre de solder la question du rôle de la France et permettre un rapprochement diplomatique dans un contexte d’éviction de l’influence française en Afrique francophone, principalement dû aux opérations informationnelles russes.
Une grille de lecture "ethniciste" ?
Soit il est reproché au gouvernement français d’avoir analysé la situation en fonction de facteurs ethno-culturels, ce qui révèlerait un problème de perception du fait naturel : seuls les acteurs qui n’ont jamais vécu en Afrique peuvent nier le rôle crucial du fait ethno-culturel sur le continent.
Soit il est reproché d’avoir favorisé les Hutus au détriment des Tutsis, ce qui ne serait en particulier pas compatible avec le fait que la France promouvait les accords d’Arusha, dont l’arithmétique favorisait les Tutsis. Ce que, incidemment, l’analyse cindynique identifie précisément comme l’un des facteurs de déclenchement du génocide.
Une couverture médiatique superficielle
Si le rapport Duclert présente des problèmes, Vincent Duclert a par ailleurs pour sa part loué la légitimité politique du FPR dans les médias, ce qui, outre le fait que cela revient à légitimer la violence des groupes armés sur le continent, n'est pas compatible avec ce qui est décrit dans le rapport, ni même d'ailleurs avec ce que dit Paul Kagamé lui-même, puisqu'il a reconnu qu'il n'aurait pas pu accéder au pouvoir par des élections. Les médias n'ont pas proposé de lecture critique : il aurait fallu analyser les 900 pages du rapport et les 900 pages de celui de la mission d'information Quilès, entre autres. Mais quelle est l'entreprise médiatique qui accorderait à un journaliste le temps de lire deux ou trois mille pages de rapports ou d'articles universitaires.
L’endossement d’une responsabilité états-unienne
Ce que le rapport Duclert ne décrit pas, c’est qu’avec l’effondrement soviétique, les États-unis revoient à la baisse leur politique d’intervention au service du maintien de la paix, ce qui est formalisé dans une directive classifiée et mis en œuvre à l’ONU par Madeleine Albright, qui bloque systématiquement les velléités d’opérations de maintien de la paix au Rwanda.
Bill Clinton déclarera ainsi le 25 mai 1994 que les intérêts des États-Unis n’étaient pas suffisamment en jeu pour qu’ils interviennent dans des conflits ethniques comme au Rwanda, puis, le 28 mai, que les États-Unis ne pouvaient pas envoyer des troupes chaque fois qu’il y avait des troubles civils ou que les valeurs américaines étaient “offensées par la misère humaine”.
En résumé : si le rapport Duclert conclut à une responsabilité française, dans les faits, c’est la France qui est finalement intervenue pour faire cesser le génocide, alors que l’administration Clinton avait d’abord bloqué une intervention de l’ONU, puis l’intervention africaine qui devait permettre de pallier ce premier blocage. Admettre la conclusion du rapport Duclert revient à imposer à la France d’endosser une responsabilité états-unienne. Si cela ne pouvait en soi que dégrader l’image de la France en Afrique et de surcroît alimenter les opérations informationnelles russes, se baser sur cette conclusion pour amorcer un rapprochement diplomatique avec le régime de Paul Kagamé ne pouvait qu’aggraver la situation.
Au second ordre : la non perception de la perception africaine du régime rwandais
Si le cas du rapport Duclert illustre la dangerosité des postures positivistes et la nécessité de l’évaluation du risque épistémique dans tout processus de décision politique, ce processus est aussi soumis à un risque informationnel : dans un contexte de guerre des perceptions ciblant l’image de la France en Afrique, il aurait été nécessaire d’évaluer comment un rapprochement diplomatique avec le régime rwandais pouvait y être perçu, donc d’évaluer comment ce régime y est perçu.
Or, en pratique, l’opinion qu’ont nombre d’Africains de Paul Kagamé est particulièrement négative : le dirigeant rwandais est vu comme "un serpent", et ceux qui ont eu l’occasion d’aller au Rwanda témoignent y avoir observé une "population terrorisée’. C’est pourquoi un rapprochement avec le Rwanda ne pouvait qu’être mal perçu, mais encore fallait-il que cette information parvienne à Paris.
D’où la question plus générale de la perception de l’Afrique qu’ont les diplomates : parfois, certains s’intéressent à ce que les expats peuvent transmettre, et s’aperçoivent qu’aucun de leurs services ne peut leur apporter une telle profondeur d’éclairage. Et certains ont sincèrement envie d’approfondir leur connaissance de l’Afrique, mais cela nécessite des années d’initiation, d’innombrables discussions avec des amis sous les manguiers ou au bord de la lagune, et mille expériences improbables que le respect de l’étiquette leur interdit.
A propos de Pascal Cohet
Pascal Cohet est le concepteur des Cindyniques Relativisées, qui permettent une approche transversale, transdisciplinaire, trans-sectorielle, trans-culturelle, trans-domaines des situations complexes, où les problématiques de risque, conflit et développement sont intriquées.
Sa démarche s’appuie sur une diversité de domaines parcourus: architecture réseaux, neurosciences, société de l’information, relations institutionnelles et influence législative. Il considère les réalités opérationnelles comme incontournables lors des démarches de conceptualisation, et l’extension des concepts et modélisations cindyniques qu’il propose repose notamment sur son expérience de l’Afrique de l’Ouest et de la lutte informationnelle.
IFREI.ORG
Epistemic Risk, Reputational Risk and Perception WarfareThe case of the French embassy attack in Kinshasa
Summary in English
Perceptions of relations between France and Rwanda, particularly following a controversial diplomatic rapprochement, are identified as a major cause of the protests. The text also critiques media coverage of these reports and the epistemic and informational risks associated with French diplomatic decision-making in Africa.

 Accueil
Accueil