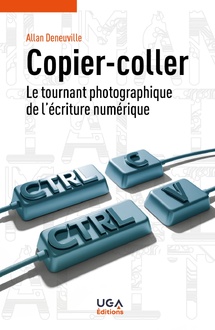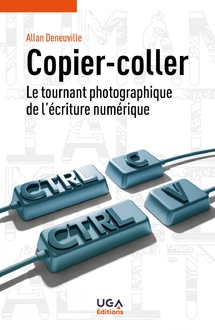DC : Allan , votre dernier livre Copier-coller : le tournant photographique de l’écriture numérique propose une analyse inédite d’un geste que beaucoup considèrent comme banal. Pourquoi avoir choisi ce sujet ?
AD : Ce qui m’a paru intéressant, c’est que le copier-coller est un geste que nous faisons tous, plusieurs fois par jour, sans vraiment y prêter attention. J’aime travailler sur ces pratiques tellement quotidiennes et banales qu’elles deviennent invisibles.
Depuis plusieurs années, je m’intéressais à l’histoire et à l’anthropologie de l’écriture. En littérature, on étudie souvent les textes comme s’ils étaient de pures idées, sans considérer l’acte même d’écrire. Or, le copier-coller est un geste assez singulier : c’est le seul qui permette d’écrire sans même avoir lu ce qu’on écrit. Quand j’écris à la main ou que je tape au clavier, mon corps s’implique dans une temporalité et des gestes qui font que le texte me traverse. Avec un simple CTRL + C / CTRL + V, je peux transférer sur un nouvel espace n’importe quel texte du monde, y compris dans une langue que je ne comprends pas. Je me suis donc demandé ce que cela révélait de l’évolution de l’écriture à l’ère numérique.
Bien que l’écriture soit un champ largement exploré par la recherche, le copier-coller n’avait jusqu’ici fait l’objet que de quelques articles, mais jamais d’un ouvrage de fond qui prenne cet outil à bras-le-corps.
Depuis plusieurs années, je m’intéressais à l’histoire et à l’anthropologie de l’écriture. En littérature, on étudie souvent les textes comme s’ils étaient de pures idées, sans considérer l’acte même d’écrire. Or, le copier-coller est un geste assez singulier : c’est le seul qui permette d’écrire sans même avoir lu ce qu’on écrit. Quand j’écris à la main ou que je tape au clavier, mon corps s’implique dans une temporalité et des gestes qui font que le texte me traverse. Avec un simple CTRL + C / CTRL + V, je peux transférer sur un nouvel espace n’importe quel texte du monde, y compris dans une langue que je ne comprends pas. Je me suis donc demandé ce que cela révélait de l’évolution de l’écriture à l’ère numérique.
Bien que l’écriture soit un champ largement exploré par la recherche, le copier-coller n’avait jusqu’ici fait l’objet que de quelques articles, mais jamais d’un ouvrage de fond qui prenne cet outil à bras-le-corps.
DC : Vous parlez d’“archéologie des médias” du copier-coller. Pouvez-vous nous en dire plus ?
AD : L’archéologie des médias est un champ pluridisciplinaire où se croisent historiens, artistes, philosophes, théoriciens de la littérature et bien d’autres encore. Tous s’intéressent à l’évolution des médias et à ce qui subsiste d’eux dans le temps. Nous vivons entourés de médias : certains existent depuis des millénaires, comme l’écriture ; d’autres depuis plus d’un siècle, comme la photographie ou le phonographe ; d’autres encore depuis seulement quelques décennies, comme l’ordinateur, ou quelques années, comme le smartphone. L’histoire des médias est donc à la fois longue et discontinue : certains disparaissent, mais laissent des traces et rendent possibles de nouvelles inventions.
Dans mon livre, je consacre un chapitre entier à cette archéologie du copier-coller. J’y retrace les dispositifs et outils qui l’ont précédé et rendu possible, en montrant que cette archéologie n’est intelligible que si l’on prend en compte à la fois l’histoire de la copie manuscrite et celle de la photographie.
Dans mon livre, je consacre un chapitre entier à cette archéologie du copier-coller. J’y retrace les dispositifs et outils qui l’ont précédé et rendu possible, en montrant que cette archéologie n’est intelligible que si l’on prend en compte à la fois l’histoire de la copie manuscrite et celle de la photographie.
DC : Vous évoquez aussi l’impact du copier-coller sur la société numérique. Quels sont les enjeux majeurs selon vous à titre individuel, mais aussi collectif ?
AD : Les enjeux sont considérables, aussi bien dans les pratiques d’écriture quotidiennes que dans le partage de l’information ou l’autorité intellectuelle. Quand on sait, par exemple, que 69 % des articles publiés par les grands médias en ligne sont du simple copier-coller, comme l’ont montré Julia Cagé, Nicolas Hervé et Marie-Luce Viaud, que les scandales de plagiat se multiplient dans le milieu académique, et que nous peinons à transmettre aux étudiants l’importance d’écrire par eux-mêmes à une époque où il est si facile de copier un texte — y compris produit par un agent conversationnel qui lui-même réutilise d’autres textes —, on mesure l’ampleur du problème. C’est précisément pour cela qu’il me paraît essentiel de réfléchir à ces outils : en tant qu’outils «photographiques » (c’est la thèse centrale de mon livre), ils bouleversent en profondeur notre rapport à l’écriture et au savoir, dans un contexte où les textes que nous produisons ne sont plus toujours destinés à être lus, mais à circuler et fonctionner au sein d’un écosystème documentaire.
DC : Votre livre aborde également la poésie et l’appropriation. Comment le copier-coller influence-t-il la création artistique ?
AD : Les liens entre création et appropriation sont très nombreux. On pense bien sûr au geste inaugural de Duchamp avec son urinoir, mais il existe toute une histoire de la copie et de l’appropriation comme forme d’art — l’exposition Copistes actuellement au Centre Pompidou-Metz en témoigne. En poésie, ces pratiques sont également marquantes : Lautréamont a intégré de nombreux extraits de journaux dans Les Chants de Maldoror, et Blaise Cendrars a publié Kodak à partir d’un autre texte.
Pour ma part, j’ai cherché à faire dialoguer deux traditions d’appropriation textuelle contemporaines : la tradition états-unienne, avec les poètes objectivistes et l’« uncreative writing », et la tradition française, avec des figures comme Emmanuel Hocquard ou Franck Leibovici.
Pour ma part, j’ai cherché à faire dialoguer deux traditions d’appropriation textuelle contemporaines : la tradition états-unienne, avec les poètes objectivistes et l’« uncreative writing », et la tradition française, avec des figures comme Emmanuel Hocquard ou Franck Leibovici.
DC : Avez-vous l’avis ou le regard de spécialistes du cerveau. Le copier-coller touche-t-il le fonctionnement du cerveau, « le rend-il paresseux » ?
AD : Je reste assez sceptique face aux approches cognitivistes qui insistent sur la prétendue paresse intellectuelle qu’engendrerait tel ou tel outil. L’histoire montre que chaque nouveau média, lorsqu’il apparaît, suscite des réactions polarisées : d’un côté les techno-optimistes, qui y voient une révolution majeure, et de l’autre les techno-pessimistes, qui y perçoivent une menace pour la civilisation. Le cinéma, à ses débuts, a été accusé de rendre les femmes hystériques ; les jeux vidéo, plus récemment, ont été associés aux tueries de masse ; et si l’on remonte à l’Antiquité, Socrate lui-même dénonçait déjà l’écriture, qu’il jugeait responsable d’affaiblir la capacité à penser par soi-même.
Plutôt que de s’arrêter à ces jugements cognitifs, je crois qu’il faut s’intéresser à ce qui se joue socialement dans l’usage de ces outils.
Plutôt que de s’arrêter à ces jugements cognitifs, je crois qu’il faut s’intéresser à ce qui se joue socialement dans l’usage de ces outils.
DC : En conclusion, quel message souhaitez-vous transmettre, à vos lecteurs et plus largement aux professionnels et institutions ?
AD : Je pense que les opérations d’écriture méritent d’être interrogées en profondeur, car elles constituent le socle de tout le système informationnel qui structure notre société. Les grands enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui peuvent être éclairés, voire reconfigurés, si l’on prend au sérieux la manière dont ces opérations fonctionnent et influencent nos modes de production et de circulation du savoir.
Biographie
Allan Deneuville est maître de conférences à l’Université Bordeaux Montaigne, où il enseigne les sciences de l’information et de la communication. Ses recherches portent sur les mutations de l’écriture à l’ère numérique, les pratiques de recherches OSINT, et les enjeux géopolitiques du numérique brésilien.
Il est cofondateur du groupe de recherche et création Après les réseaux sociaux et responsable du pôle Recherche de l’association Open Facto, dédiée aux investigations en sources ouvertes. Membre des comités de rédaction des revues Multitudes et La Revue Documentaires , il a publié plusieurs articles et ouvrages sur les pratiques numériques. Copier-coller : Le tournant photographique de l’écriture numérique est son dernier ouvrage.
Il est cofondateur du groupe de recherche et création Après les réseaux sociaux et responsable du pôle Recherche de l’association Open Facto, dédiée aux investigations en sources ouvertes. Membre des comités de rédaction des revues Multitudes et La Revue Documentaires , il a publié plusieurs articles et ouvrages sur les pratiques numériques. Copier-coller : Le tournant photographique de l’écriture numérique est son dernier ouvrage.
Caractéristiques
| ISBN : 2377475361 Nombre de pages : 286 Format : 14,00 x 21,50 x 2,10 cm SKU : 5719242 |

 Accueil
Accueil